Pour sa dernière création en tant que directeur du Théâtre de l’Odéon, et première à la tête de sa nouvelle compagnie Pour un moment, Stéphane Braunschweig livre une version trop sage et policée du chef-d’oeuvre de Tchekhov.
L’image est belle, de celles qui revêtent en temps réel la force du symbole. Tandis qu’il vient saluer à l’issue de la première représentation de La Mouette, Stéphane Braunschweig se voit remettre un bouquet de fleurs des mains de Julien Gosselin. Bientôt suivi d’une accolade, ce geste tout en élégance n’a rien d’anodin et vaut passage de témoin entre l’ancien et le nouveau directeur du Théâtre de l’Odéon. Face à son successeur, Stéphane Braunschweig, qui n’a pas souhaité briguer de troisième mandat à la tête de l’institution parisienne et a craint, un temps, que cette nouvelle création ne puisse voir le jour pour des raisons financières, affiche un certain, et inhabituel, visage teinté d’émotion, liée, en toute logique, au sentiment qu’une page est en train de se tourner, voire qu’un chapitre est en train de se refermer. Et l’on regrette alors que cette aventure longue de huit années s’achève de la sorte, sur cette note par trop terne, avec cette Mouette qui n’aura jamais trouvé assez d’élan pour véritablement prendre son envol.
Coutumier du théâtre de Tchekhov dont il a, au cours des trente dernières années, monter La Cerisaie, Les Trois Soeurs et, plus récemment, Oncle Vania, l’artiste l’est tout autant de ce texte qu’il avait déjà visité en 2001 alors qu’il dirigeait le Théâtre national de Strasbourg. Comme il en a l’habitude, Stéphane Braunschweig fonde cette seconde mise en scène du chef-d’oeuvre tchékhovien sur un concept scénographique à première vue juste et puissant : après l’énorme bassin d’eau de Nous pour un moment, le podium en bi-frontal d’Iphigénie, le tapis de feuilles géant de Jours de joie, l’impressionnante forêt d’Oncle Vania et l’immense flaque de sang d’Andromaque, pour ne citer que ses dernières réalisations, il installe toute l’intrigue de La Mouette dans le petit théâtre de Konstantin, comme si elle procédait entièrement de lui. Dans les premières encablures de la pièce, la communauté de spectatrices et spectateurs réunie pour observer le spectacle écrit et conçu par le jeune auteur et metteur en scène se retrouve alors à la porte du rideau de fer, cantonnée au proscenium, et unie par une attitude nonchalante, presque désabusée, qui trahit le peu d’entrain que toutes et tous, à commencer par Arkadina, ont à assister à ce qui se prépare derrière cette austère paroi. Comme si tout était condamné d’avance.
Tandis que le début de la représentation est annoncé, le lourd mur se met en branle et laisse place à un espace crépusculaire et dépouillé, constitué de quelques pierres, de tas de sable et du cadavre d’une barque, tels les vestiges d’un ancien lac, celui qui, dans la pièce de Tchekhov, borde la maison d’Arkadina, mais qui apparaît désormais à sec. Invités à s’allonger au sol pour profiter de cette expérience théâtrale qui se revendique hors des sentiers battus, Macha, Trigorine et consorts ne tardent pas à voir Nina s’élever dans les airs pour porter la poésie furieuse de Treplev. Souvent traitée par les metteurs en scène avec une condescendance digne d’Arkadina, la pièce de Konstantin est, au contraire, représentée avec le plus de sérieux possible par Stéphane Braunschweig. Foisonnant, échevelé, son texte parvient avec une clarté presque nouvelle et, dans sa façon de décrire un monde futur en ruines, où « les hommes, les lions, les aigles et les coqs de bruyère, les cerfs aux vastes bois, les araignées, les poissons muets qui vivent dans l’eau, les étoiles de mer et tous ceux que l’oeil ne pouvait voir » se seraient éteints, ne peut que résonner avec la sixième extinction de masse que nous connaissons.
À ceci près que, contrairement à la forêt d’Oncle Vania, ce décor, une fois la représentation de Konstantin interrompue par les persiflages d’Arkadina, prend la forme d’un carcan que Stéphane Braunschweig peine à habiter et à faire vivre – ou maladroitement, comme lorsqu’il fait descendre une collection de mouettes du plafond –, et dont il se débarrasse, même, durant tout le troisième acte. Surtout, le metteur en scène semble croire que cet espace se suffit à lui-même pour irriguer la totalité de la pièce de Tchekhov. Las, au fil des scènes qui s’égrènent, force est de constater que cette Mouette manque d’une lecture singulière et d’un parti-pris dramaturgique suffisamment puissant. Rapidement, l’ensemble paraît trop sage, trop lisse, trop policé, presque asséché, à l’image de l’ancien lac qui lui sert de camp de base. Si le texte tchékhovien, magnifié par la traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan, tient bon, son habituelle brillance littéraire s’avère ternie et, en tendant l’oreille, on peut remarquer qu’il se trouve à bon nombre d’endroits largement sous-exploité par Stéphane Braunschweig, comme si le metteur en scène s’était contenté d’en être le passeur et n’avait pas cherché à en fouiller le coeur, pourtant battant.
Dès lors, il devient compliqué de ressentir les tourments et les élans qui animent et font vibrer les personnages, jusqu’à leur combustion. D’autant que, sur le plateau, les comédiennes et les comédiens, habituels ou nouveaux venus dans la troupe du metteur en scène, apparaissent, pour l’immense majorité d’entre eux, un peu décontenancés, au-delà de leur jeu particulièrement vert au soir de la première. Si certains, tels Boutaïna El Fekkak, Jules Sagot et Denis Eyriey – symbole, lui aussi, d’un passage de témoin pour être l’un des fidèles comédiens de Julien Gosselin –, s’en sortent un tantinet mieux que d’autres dans leurs rôles respectifs de Macha, Treplev et Trigorine, toutes et tous peinent, à l’exception de quelques trop rares et éphémères moments, à donner aux personnages de Tchekhov tout le relief qu’ils méritent. Handicapés par l’absence de direction claire et d’orientation précise de Stéphane Braunschweig, ils semblent flotter dans des costumes un peu trop grands pour eux et se complaire en terrain neutre. Au sortir, une interrogation s’impose alors à notre esprit : et si, en regard des performances pétries d’originalité ou des artistes qui prennent les textes à bras-le-corps, ce type de théâtre, qui se plaît à dérouler les classiques sans prise de risque majeur ni étincelles, avait vécu ? Pour lui aussi, il est possible, et probable, qu’une page se tourne, voire qu’un chapitre se referme.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
La Mouette
d’Anton Tchekhov
Traduction André Markowicz, Françoise Morvan
Mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig
Avec Sharif Andoura, Jean-Baptiste Anoumon, Boutaïna El Fekkak, Denis Eyriey, Thierry Paret, Ève Pereur, Lamya Regragui Muzio, Chloé Réjon, Jules Sagot, Jean-Philippe Vidal
Collaboration artistique Anne-Françoise Benhamou
Collaboration à la scénographie Alexandre de Dardel
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumière Marion Hewlett
Son Xavier Jacquot
Maquillage, coiffures Émilie Vuez
Assistant à la mise en scène Jean Massé
Réalisation du décor Atelier de construction de l’Odéon-Théâtre de l’EuropeProduction Compagnie Pour un moment
Coproduction Odéon-Théâtre de l’Europe
Avec le soutien du Cercle de l’OdéonLa compagnie Pour un moment est conventionnée par le ministère de la Culture – DGCA.
Durée : 2h20
Odéon-Théâtre de l’Europe, Paris
du 7 novembre au 22 décembre 2024


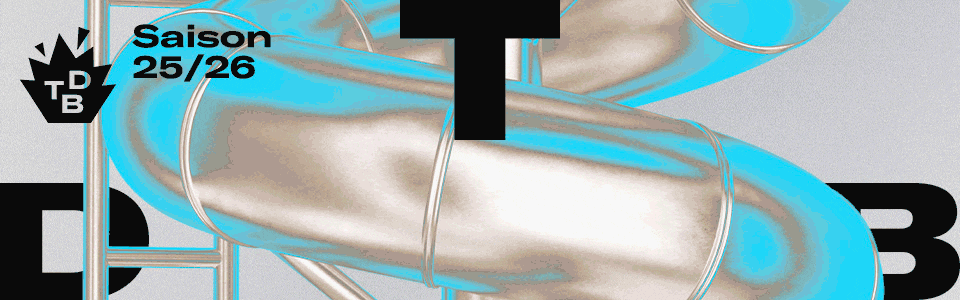


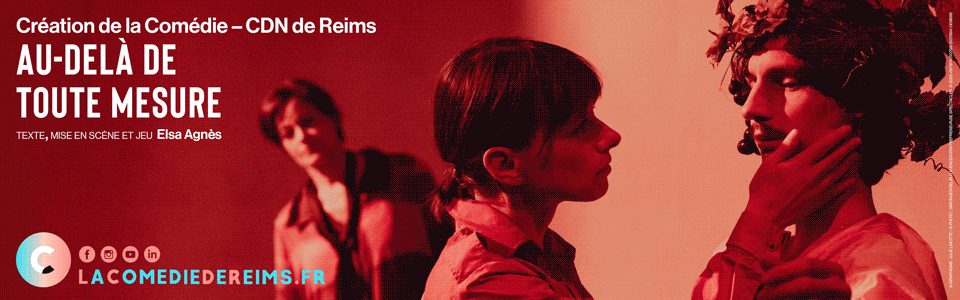


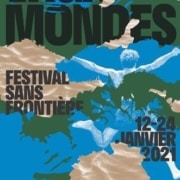





Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !