Au-delà de rares promesses tenues et de quelques coups d’éclat, tels l’Hommage à Gisèle Pelicot rendu avec force par Milo Rau et Le Soulier de Satin donné dans la Cour d’honneur, la 79e édition du Festival d’Avignon, où la langue invitée, l’arabe, s’est trop peu fait entendre, aura manqué d’audace dans ses choix de programmation et de radicalité dans ses propositions.
Sur le papier, tout était clair comme de l’eau de roche, et pourtant, il aura fallu attendre la toute dernière semaine du Festival d’Avignon, qui s’achève ce samedi 26 juillet sur un taux de fréquentation dépassant les 98%, pour que son directeur, Tiago Rodrigues, se rende à l’évidence et reconnaisse, à l’occasion de la conférence de « pré-bilan », qu’il aurait « voulu avoir plus de théâtre en langue arabe » lors cette 79e édition. Contrairement à l’anglais et à l’espagnol, qui avaient eu les honneurs de la manifestation au cours des deux dernières années, la langue invitée du cru 2025 n’aura été en lien qu’avec 30% de la programmation, reconnaît désormais le metteur en scène. Un déficit d’autant plus criant, et symbolique, qu’il arrive au plus mauvais moment, à l’heure où, de l’autre côté de la Méditerranée, le désastre humanitaire enduré par la population de la Bande de Gaza s’est, durant les trois semaines qui viennent de s’écouler, accru de jour en jour. Arguant de « contraintes de programmation » et promettant que deux spectacles de théâtre en langue arabe initialement prévus cette année seront présentés l’an prochain, Tiago Rodrigues a, semble-t-il, voulu se raccrocher aux branches. Au-delà de quelques éphémères manifestations à caractère événementiel, tels le concert-hommage à la chanteuse Oum Kalthoum, La Voix des femmes, organisé dans la Cour d’honneur du Palais des Papes, et une sensible « célébration poétique de la langue arabe » intitulée Nour, le directeur du Festival d’Avignon a condamné, dans un bref communiqué publié le 2 juillet, le « massacre de Gaza » et s’est associé à la « Nouvelle Déclaration d’Avignon », prononcée sur la place du Palais des Papes dix jours plus tard, pour dénoncer « les massacres orchestrés par l’État israélien à Gaza et dans les territoires occupés » ; mais, d’un point de vue artistique, le mal était fait.
Car, exception faite des quelques bribes captées lors du magnétique When I Saw the Sea d’Ali Chahrour et du plus problématique Laaroussa Quartet conçu par Selma & Sofiane Ouissi, il aura fallu attendre le cinquième jour du Festival pour que l’arabe entre véritablement, mais discrètement, en scène et s’installe au centre du plateau, et de la dramaturgie, du délicat Chapitre quatre de Wael Kadour, donné au sein du petit écrin du Jardin de la Vierge du Lycée Saint-Joseph, dans le cadre de la première série de Vive le sujet ! Tentatives, avec le très instructif Un spectacle que la loi considérera comme mien d’Olga Dukhovna comme solide acolyte. À sa suite, seuls l’un des volets du Radio Live d’Aurélie Charon (Nos vies à venir) et le confus Yes Daddy des Palestiniens Bashar Murkus et Khulood Basel, présents pour la troisième fois en terres avignonnaises, auront mis l’une des langues arabes au coeur de leur réacteur. Pis, les autres artistes inclus par le Festival dans ce « focus », à l’image de Mohamed Toukabri et son trop fragile Every-Body-Knows-What-Tomorrow-Brings-And-We-All-Know-What-Happened-Yesterday, de Radouan Mriziga et sa belle exploration dansée des zones désertiques, Magec / the Desert, de Bouchra Ouizguen et son chaotique They Always Come Back et, surtout, de Tamara Al Saadi, qui présentait son bouleversant Taire, après sa création en janvier dernier au Théâtre de la Criée, sont toutes et tous solidement implantés en Europe depuis de nombreuses années. Preuve, s’il en fallait une, que le Festival d’Avignon, guidé par ses amitiés – la quasi-totalité des chorégraphes présents ayant, de façon remarquable, été formés par l’école de danse P.A.R.T.S. d’Anne Teresa De Keersmaeker, elle-même programmée avec son amusant BREL, co-créé avec le jeune Solal Mariotte – et ses relations étroites avec d’autres manifestations internationales, comme le Festival TransAmériques, n’a pas su jouer son rôle essentiel de tête chercheuse, et n’a, contrairement à certains de ses homologues, pas cru bon de franchir la Méditerranée pour mettre en lumière le travail d’artistes du Maghreb, d’Égypte, du Proche et du Moyen-Orient, qui, en ces temps plus que troublés, en auraient pourtant eu singulièrement besoin.
En lieu et place de toute prise de risques, cette 79e édition a surtout préféré miser sur des valeurs considérées comme sûres – sans pour autant, et de façon étonnante, poursuivre son compagnonnage avec des artistes qui ont fait ses beaux soirs lors des moutures précédentes, à l’instar de Carolina Bianchi et de Miet Warlop, qui, cette année, lui ont préféré le Kunstenfestivaldesarts de Bruxelles et le Festival d’Automne à Paris pour présenter leur dernière création –, mais qui, pour l’essentiel, ont déçu. À commencer par Thomas Ostermeier, dont le retour à Avignon après dix ans d’absence s’est soldé par un échec, celui de sa mise en scène du Canard Sauvage, beaucoup trop apathique pour faire tourner à plein régime la mécanique ibsénienne, Gwenaël Morin, dont le projet au long cours Démonter les remparts pour finir le pont a débouché sur une version sans saveur des Perses d’Eschyle, Samuel Achache et son hasardeux opéra Les Incrédules, Némo Flouret et ses Derniers Feux en forme de pétard mouillé, Mette Ingvartsen et son vain Delirious Night, Frédéric Fisbach et sa sage adaptation du Petit Pays de Gaël Faye, mais aussi, dans une moindre mesure, par Amrita Hepi et son trop référencé Rinse et par Marlene Monteiro Freitas. Trop lointainement inspiré des Mille et Une Nuits et peu à son aise dans la Cour d’honneur du Palais des Papes où il était présenté en ouverture, son NÔT a laissé plus d’une spectatrice et plus d’un spectateur sur sa faim, en regard du panache de ses créations passées. À l’image d’un festival qui, dans sa globalité, s’est avéré en manque d’audace et de radicalité, à l’exception notable des trois séries de Vive le sujet ! Tentatives qui, grâce au talent d’Olga Dukhovna, Wael Kadour, Yasmine Hadj Ali, Solène Wachter et Suzanne de Baecque, ont confirmé le rôle de précieux laboratoire de ce programme conduit avec la SACD, les deux patrons du théâtre européen, Tiago Rodrigues et Milo Rau, l’ont, de leur côté, joué respectivement en mode mineur, avec deux formes modestes aux fortunes diverses : le décevant La Distance, programmé durant trois semaines à l’Autre Scène du Grand Avignon, à Vedène, et le plus stimulant La Lettre, présenté en itinérance et, pour l’essentiel, à l’extérieur des remparts.
En mal de réelles découvertes, y compris du jeune artiste grec d’origine albanaise Mario Banushi et de son MAMI, dont le sacre un peu trop annoncé a pu occasionner quelques déceptions, ce 79e Festival d’Avignon a néanmoins pu compter, pour redresser la barre, sur quelques coups d’éclat qui marqueront sans doute son histoire, comme le troublant Hommage à Gisèle Pelicot orchestré d’une main de maître – mais seulement le temps d’une soirée – par Milo Rau et l’intense Soulier de Satin mis en scène par Éric Ruf, qui, après sa création l’hiver dernier à la Comédie-Française, a permis à la langue de Claudel de briller, à nouveau, sous le ciel avignonnais, et certains moments de grâce. Au-delà de la présence trop furtive du Théâtre du Radeau et de ses deux ultimes, et sublimes, création Item et Par autan, et de l’éruptif Sommet de Christoph Marthaler, le pas de deux facétieux et émouvant de Mohamed El Khatib et Israel Galván, malicieusement intitulé Israel & Mohamed, a fait plus qu’honneur aux artistes dûment installés, tout comme l’ovniesque Fusées de Jeanne Candel, seul rescapé d’une programmation jeune public réduite, cette année, à peau de chagrin, et le truculent Coin Operated de Jonas&Lander. Également porteurs d’espoir, l’envoûtant Nexus de l’adoration de Joris Lacoste, le sublime Prélude de Pan de Clara Hédouin, le saisissant One’s own room Inside Kaboul de Caroline Gillet et Kubra Khademi et le plus tranchant Affaires familiales d’Émilie Rousset auront, chacun à leur endroit, réussi à tenir leurs promesses. Reste à savoir si, à l’occasion de sa 80e édition, où, en forme de nouveau défi, le coréen fera office de langue invitée, le Festival d’Avignon réussira à renouer avec l’audace qui a présidé à sa création, ou s’il restera enferré dans la recherche de ce consensus confortable où, aujourd’hui, il paraît se complaire.
Vincent Bouquet, pour l’équipe de sceneweb – www.sceneweb.fr





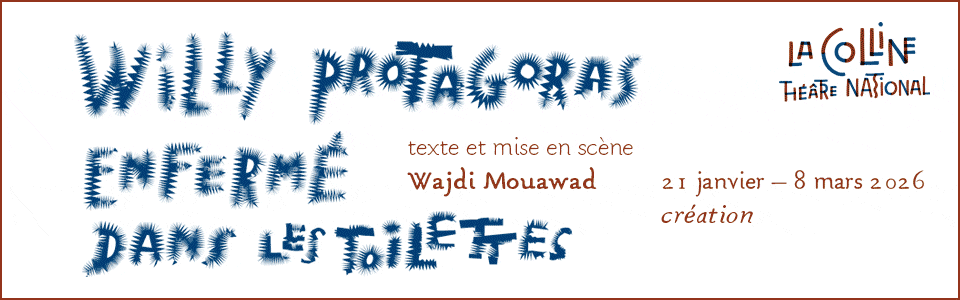








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !