Le metteur en scène Stéphane Braunschweig poursuit son compagnonnage fructueux avec l’auteur norvégien Arne Lygre et s’empare, avec délicatesse et élégance, de sa dernière pièce où, au long d’histoires de vie entremêlées, l’humanité refait surface.
C’est un lieu calme et paisible, à l’abri du tumulte du monde. Un endroit méconnu, pensent-ils, propice à la réflexion, aux confidences et aux rendez-vous, discrets de préférence. En ce jour d’automne, ce petit coin de terre, coincé entre un cimetière et une rivière, est recouvert de feuilles mortes qui pourraient, comme les souvenirs et les regrets, se ramasser à la pelle. Au milieu de ce tapis ocre et flamboyant, trône un banc d’une belle et élégante simplicité, à l’image des femmes et des hommes qui, les uns après les autres, vont venir s’y asseoir. La plupart ne se connaissent pas, mais tous ont en partage bien plus qu’ils ne le croient, à commencer par cette irrésistible appétence pour la joie qui leur permet de garder la tête hors de l’eau et d’espérer qu’un jour, peut-être celui-ci, l’horizon s’éclaircira et donnera l’occasion à un nouveau printemps de naître.
Parmi eux, il y a d’abord cette « mère » et cette « sœur » venues pour retrouver leur fils et frère, Aksle – seul personnage, avec son conjoint David, à être gratifié d’un prénom par Arne Lygre. Entre elles, l’ambiance est à la fête, celle des retrouvailles, mesurées, mais sincères, émaillées de déclarations d’amour réciproques, de reproches à peine voilés et de confessions nécessaires : tandis que la mère crache sur sa belle-famille et se lamente, à demi-mot, de ne pas voir suffisamment ses enfants, sa fille lui avoue qu’elle ne pourra, de son côté, jamais en avoir. Alors qu’Aksle se fait attendre, elles sont, à leur grand dam, rejointes par un « voisin » qui a accordé un « dernier rendez-vous » à son « ex-femme », puis par une « veuve » et deux « orphelins de père » venus apprécier le lieu de sépulture choisi par leur récent défunt. Au gré des discussions que les uns et les autres entretiennent, se met en place un jeu de résonances subtiles qui, sans qu’ils s’en aperçoivent vraiment, tissent des fils entre les vies de ces inconnus, et les transforment en communauté liée par une même humanité, bientôt mise – littéralement – sens dessus-dessous par l’arrivée d’Aksle et l’annonce de sa décision, ferme et définitive, de « disparaître ».
En fin connaisseur d’Arne Lygre, dont il a déjà monté Jours souterrains (Tage Unter), Je disparais, Rien de moi et Nous pour un moment, Stéphane Braunschweig sait parfaitement que son écriture n’a besoin d’aucun surplus de mise en scène pour que sa mécanique dramaturgique produise ses effets. Armé d’une langue simple, celle du quotidien, et de phrases directes qui, si elles semblent parfois achopper, disent en réalité beaucoup avec peu de mots, le dramaturge norvégien dévoile ses personnages par effet rebond – grâce à la franchise de ces inconnus qui n’ont rien à perdre – et transforme autrui en accoucheur de soi, de ses doutes, de ses maux, de ses regrets, de ses manquements aussi qu’il est parfois difficile de voir sans autre forme de miroir. Au-delà de l’aspect ludique du procédé, qui pousse dans une chasse aux ressemblances et aux dissonances intellectuellement stimulante, voire jouissive, cette porosité des vies, à mi-chemin entre Anton Tchekhov et Jon Fosse, s’avère lumineuse dans sa façon de créer un front commun contre l’instabilité de l’existence et la multiplicité des pertes qui, quoi qu’il arrive et qui que l’on soit, la jalonnent – celles d’un amour, d’un parent, d’un frère ou d’un enfant.
D’autant que, dans la construction de son espace scénographique comme dans sa direction d’acteurs, Stéphane Braunschweig procède avec une élégance, une délicatesse et une bonté qui renforcent encore la douceur qui nimbe ces Jours de joie. Là où Arne Lygre plonge habituellement ses personnages dans des situations extrêmes – une noyade, un accident, un viol… –, il les confronte cette fois à des événements relativement communs qui permet aux comédiens de les modeler davantage à leur main, et de les rapprocher de nous. De Virginie Colemyn, subjugante en mère et femme duale, tantôt fière, tantôt brisée, à Pierric Plathier, aussi troublant en fils fuyant qu’en amoureux délaissé, tous parviennent, malgré une seconde partie un peu moins tenue, à entretenir cette dynamique de courte échelle où les uns et les autres prennent soin des uns et des autres, sans en avoir toujours pleinement conscience. Epaulés par l’humour et la tendresse savamment distillés par le dramaturge norvégien, ils réussissent alors à convertir la douleur des relations brisées en tremplin vertueux pour, espèrent-ils, s’offrir un avenir meilleur.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Jours de joie
d’Arne Lygre
Mise en scène et scénographie Stéphane Braunschweig
Avec Virginie Colemyn, Cécile Coustillac, Alexandre Pallu, Pierric Plathier, Lamya Regragui Muzio, Chloé Réjon, Grégoire Tachnakian, Jean-Philippe Vidal
Traduction française Stéphane Braunschweig, Astrid Schenka
Collaboration artistique Anne-Françoise Benhamou
Collaboration à la scénographie Alexandre de Dardel
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumière Marion Hewlett
Son Xavier Jacquot
Maquillages/coiffures Emilie Vuez
Assistante à la mise en scène Clémentine VignaisProduction Odéon-Théâtre de l’Europe
Avec le soutien du Cercle de l’Odéon et de l’Ambassade Royale de NorvègeJours de joie d’Arne Lygre est publié à L’Arche éditeur.
Durée : 2h20
Odéon Berthier
Du 20 avril au 5 mai 2024


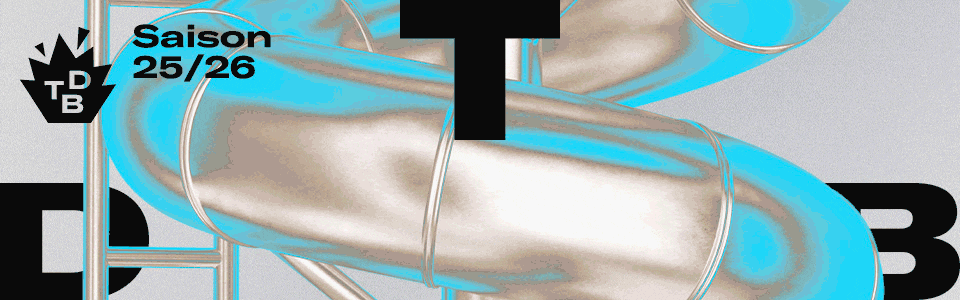


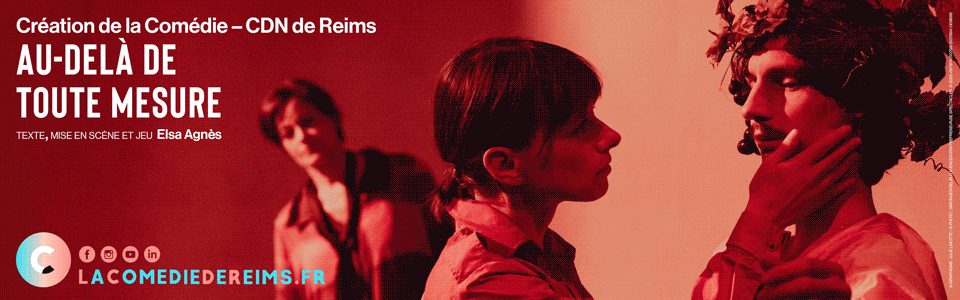








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !