Train d’union entre deux éditions biennales du festival Sens Interdits, Contre-Sens s’achève ce week-end à Lyon. À cette occasion, Patrick Penot, qui a fondé cette manifestation importante consacrée au théâtre international de « l’urgence », passe les rênes aux membres de son équipe pour que vive ce festival si fragile et vif à la fois. Retour sur quinze années d’une aventure éclairante qui a mis en lumière des populations malmenées et leur façon de faire théâtre.
C’était le 13 juin dernier, Patrick Penot tenait sa dernière conférence de presse et présentait Contre-Sens. Il trouvait une formule qui résume si bien les quinze années qu’il a passé à la tête du festival Sens Interdits : « On n’a pas l’impression qu’on change le monde avec ça [le festival, NDLR], mais on a la certitude qu’on prend en compte les changements du monde ». Ce samedi 26 octobre, il vient de boucler, à 75 ans, une équipée unique qui aura permis au public de Lyon et de sa métropole – mais aussi plus largement français, voire européen grâce aux tournées portées par le festival – de découvrir des artistes qui fabriquent ce qu’il a appelé un « théâtre de l’urgence », sous-titré « mémoires, identités, résistances ». Souvent, les compagnies invitées venaient de territoires soumis à de violents conflits, ou appartenaient à des minorités mal intégrées à leur pays, quand elles n’étaient pas franchement rejetées, à l’image des Mapuches chiliens. La parole, les plateaux ont aussi été donnés à celles et ceux qui cherchent et fouillent avec les outils du théâtre, qui tentent d’éclairer le monde.
Patrick Penot imagine ce festival à l’occasion de la candidature de Lyon au titre de Capitale européenne de la culture 2013. C’est Marseille qui gagne, mais il maintient son projet, qui s’adosse alors fortement au Théâtre des Célestins dont il assure, à l’époque, la codirection avec Claudia Stavisky. Ce natif du Berry, qui a beaucoup travaillé à l’international – Instituts français d’Athènes, de Vienne, de Varsovie (en deux temps, avant et après la chute du Mur), Centre culturel français de Milan – et à Paris, au Théâtre de l’Athénée, a rejoint Lyon en 2003, et va rapidement, deux fois par saison, programmer du théâtre non francophone, comme la Dinguerie tropicale du Polonais Grzegorz Jarzyna, alors qu’il se fait encore rare sur les bords du Rhône et de la Saône. En 2009, lors de la première édition de Sens Interdits, la Croatie, la Russie, la Turquie et l’Afghanistan sont présents dans différents lieux de la ville, partenaires de la première heure, comme le Théâtre du Point du Jour – Michel Raskine et André Guittier en sont alors les directeurs.
Au fil des années – huit éditions les années impaires et deux temps forts nommés Contre-Sens en 2022 et 2024 –, ce sont des liens très forts qui vont se développer avec des artistes en lutte, et même en fuite. C’est le cas avec Tatiana Frolova et son groupe du théâtre KnAM qui seront de toutes les éditions à partir de 2011 jusqu’à proposer, en ce mois d’octobre 2024, selon les mots de Patrick Penot, « une (re)présentation impromptue et individualisée – mais tout à fait collective – par chaque membre du groupe de la distance entre l’endroit qu’ils ont laissé et là, avec le chant, la musique, des bricolages ». Toutes et tous ont quitté leur Sibérie une fois la guerre à l’Ukraine déclarée. À Lyon, souvent aux Célestins, où Tatiana Frolova est désormais artiste associée, elle a présenté pas moins de huit spectacles – et même neuf en comptant sa collaboration avec les élèves de l’ENSATT ! Une œuvre. Fouillant dans sa mémoire, ses archives, exhumant des photos, de la matière, avec ses acolytes, elle fait théâtre de ce que cela a été d’être soviétique, puis russe, sans compromission et avec une rectitude épatante. Dans Une guerre personnelle en 2011, elle disait déjà le désastre qu’était la politique de Vladimir Poutine. À l’avenant, Martha Górnicka a, elle aussi, parcouru le festival depuis 2011, bien avant d’être intronisée dans la Cour d’honneur d’Avignon l’été dernier. Et de clore Contre-Sens au TNP avec ce coup de poing qu’est Mothers. A Song for Wartime.
Un festival menacé
Tout au long de ces quinze années, les résistances ont aussi été magistralement portées par des artistes de la jeune génération qui ont pu, en s’exprimant par le théâtre, regarder le lourd héritage sanguinaire laissé par leurs parents, qu’ils et elles soient chiliens, palestiniens ou égyptiens, comme le travail de Paula González Seguel sur le peuple mapuche dans Ňi pu tremen, puis Trewa, ou de l’acteur Roberto Farias dans la pièce Acceso du cinéaste Pablo Larraín sur les violences sexuelles subies dans un centre de réinsertion pour mineurs, héritage de Pinochet. Ils et elles ont tracé une voie de réparation. C’était également le cas pour Villa + Discurso de Guillermo Calderón, dans lequel trois jeunes filles discutaient pour savoir s’il fallait faire de la Villa Grimaldi – un lieu d’exactions au Chili – un musée ou un terrain vague, avant de donner la parole à Michelle Bachelet. Il y eut aussi le petit miracle de L’Histoire terrible mais inachevée de Norodom Sihanouk, roi du Cambodge, pièce en deux volets de quatre heures chacun, en khmer, menée avec une vitalité inouïe par des circassiennes de l’école cambodgienne de Battambang. Sous la direction de Georges Bigot et Delphine Cottu, elles prolongeaient ainsi la mise en scène d’Ariane Mnouchkine de 1985.
« C’est non », martèle souvent, comme un gimmick comique, Patrick Penot à ses interlocuteurs. C’est peut-être sa résistance enjouée à lui, qui a vécu derrière le rideau de fer aux heures sombres de Jaruzelski en Pologne, et qui ne s’interdit jamais rien, surtout pas de rajouter un spectacle à la volée, comme le très délicat Mimoun et Zatopek de Vincent Farasse en ouverture de Contre-Sens le 12 octobre. La veille pourtant, malgré le fait que cette manifestation fasse partie de la sélection de « festivals incontournables » de la région Auvergne-Rhône-Alpes, celle-ci ne présentait pas le dossier de demande de subvention lors de sa commission permanente, et n’a donc pas eu à se prononcer ce jour-là, comme en juin. Ce sont 30 000 euros que le festival n’a pas obtenus cette année – 50 000 euros pour les années impaires –, se voyant contraint, pour limiter le lourd déficit de l’exercice qui s’annonçait, de se retirer de l’accord de co-accueil envisagé avec le Théâtre de la Croix-Rousse de trois représentations de Los diás afuera de Lola Arias, déjà invitée lors de l’édition 2013 avec le plus réussi El año en que nací. « C’est la première fois depuis 2009 que Sens Interdits ne peut tenir ses engagements artistiques », communique alors le festival. La Ville de Lyon, comme la Métropole, maintiennent leurs soutiens, mais jusqu’à quand dans ce contexte de restriction des budgets des collectivités territoriales ? Pour l’heure, ce sont les membres de l’équipe qui prennent la succession du fondateur, faute de pouvoir créer et financer un nouveau poste de direction – Patrick Penot ayant toujours été bénévole.
Cette fragilité est d’autant plus déplorable que cet événement est à tel point en prise avec les maux du monde qu’il est régulièrement percuté par l’actualité. On se souvient, en 2011, de Jalila Baccar et Fadhel Jaïbi n’assistant qu’à la première des deux dates de Yahia Yaïch Amnesia, car ils rejoignaient la Tunisie afin de voter librement pour la première fois de leur vie, Ben Ali ayant été chassé du pouvoir par le peuple. L’an dernier, le Palestinien Ahmed Tobasi présentait And Here I Am, onze jours après l’attaque terroriste du 7-Octobre et alors que les premières bombes de l’armée israélienne s’abattaient sur la bande de Gaza. La ville de Choisy-le-Roi le déprogrammait ; Sens Interdits s’est acharné à le jouer. Au-delà même de ces carambolages, le festival s’impose également comme le terreau de nouvelles façons de regarder des codes européocentrés heureusement malmenés.
Une filiation avec les artistes rwandais
Au-delà des près de 150 spectacles programmés par Patrick Penot, Sens Interdits ce sont aussi de longues rencontres avec les artistes, des collaborations avec des écoles – le Conservatoire de Lyon, l’ENSATT, l’ENS Lyon, l’École de la Comédie de Saint-Étienne, celle de Lausanne… –, une webradio, des ateliers, des projections vidéo – comment se remettre des 5h30 de Rwanda 94 présentée il y a quelques jours ? –, des concerts – comme celui d’Ül Kimvn –, et désormais une collection de dix titres dans la maison d’édition L’Espace d’un instant – parmi lesquels les textes de la Franco-Turque Sultan Ulutaş Alopé, de la Roumaine Anca Bene et de la Malienne Jeanne Diama. D’autres échos se font avec la manifestation, à l’instar du profond entretien-fleuve de Carole Karemera mené par le président de l’association du festival, Olivier Neveux, dans le numéro 253 de Théâtre/Public, la revue qu’il coordonne. L’actrice belgo-rwandaise a été invitée plusieurs fois par Patrick Penot, notamment pour We call it love, spectacle très fort, en bi-frontal, qui donnait la parole à une mère ayant perdu mari et enfant lors du génocide rwandais et apportant à manger en prison au meurtrier de son fils abandonné. Dans la même veine, Hate Radio de Milo Rau avait été programmé lors de l’édition précédente, en 2015 ; et Génération 25 de Hope Azeda et Yannick Kamanzi a poursuivi, cette année, cette filiation avec les artistes rwandais.
En salle, en rue, dans des espaces clos ou ouverts, de jour ou de nuit, la Libanaise Chrystèle Khodr – Titre provisoire en 2017, Augures en 2021, Ordalie en 2023 –, le Camerounais Zora Snake et la compagnie Garniouze – Rictus en 2015 et Ce que j’appelle oubli en 2023 – ont modelé ce festival, ponctué aussi par la venue du maître Matthias Langhoff et sa Mission d’Heiner Müller, sur un plancher bancal, époustouflant de modernité à propos d’un soulèvement avorté d’esclaves sous l’ère napoléonienne. Deux ans auparavant, en 2015, une partie du Raoul Collectif, le Nimis Groupe, proposait Ceux que j’ai rencontrés ne m’ont peut-être pas vu et interrogeait sans détour, avec des sans-papiers au plateau, le fonctionnement de l’agence Frontex, « bras armé de l’UE ». La même histoire. Une filiation.
À l’heure de passer la main, parmi ces multiples rencontres, Patrick Penot se remémore celle avec C’était un samedi de la metteuse en scène, autrice et traductrice Irène Bonnaud. « Dans les petites formes, au plus proche de ce qu’on a eu envie faire, il y a eu ce spectacle sur la déportation d’une petite communauté grecque juive romaniote avec des figurines en terre cuite, une des choses les plus bouleversantes que j’ai vues sur la Shoah », dit-il à propos de cette pièce qui a joué dans des salles plus ou moins grandes – à Bourgoin, Caluire, Bron… – et plus ou moins dédiées au théâtre – centre de résistance et de la déportation. À l’image d’un festival poli par son directeur pour sortir des chemins balisés et laisser place à celles et ceux qui sont invisibilisés.
Nadja Pobel – www.sceneweb.fr





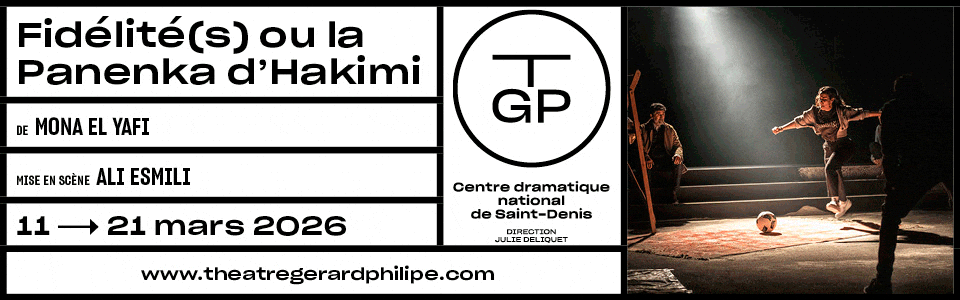



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !