La directrice du Théâtre de l’Atelier et le directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin, et désormais des Bouffes Parisiens, instillent une bonne dose de spectacles nés dans le théâtre public au coeur de la programmation de leurs maisons privées. Décryptage d’un fonctionnement hors des sentiers battus.
Vos programmations respectives au Théâtre de l’Atelier d’un côté, et à la Porte Saint-Martin et aux Bouffes Parisiens de l’autre, sont fondées sur des reprises de spectacles issus du théâtre public – par exemple, cette saison, Illusions perdues ou Clôture de l’amour pour le premier ; La vie et la mort de Jacques Chirac, roi des Français, Les Idoles ou La tendresse pour les deux derniers – ou sur des créations qui pourraient s’en rapprocher. Est-ce une volonté, pour vous, de brouiller la traditionnelle frontière entre théâtre public et théâtre privé ?
Rose Berthet : Le Théâtre de l’Atelier a toujours occupé une place singulière dans la sphère des théâtres privés. Dès sa création par Charles Dullin en 1922, il s’est imposé comme un lieu de recherche et d’exigence, d’une certaine façon, déjà, à la frontière entre public et privé. Je n’ai rien inventé et ne fais que m’inscrire dans le prolongement de cette histoire. Auparavant, le théâtre public était peut-être plus réticent à jouer des oeuvres dans le théâtre privé, mais tout le monde se rend bien compte aujourd’hui qu’une telle dynamique est intéressante pour les artistes, comme pour les spectatrices et les spectateurs. On prouve que l’on peut remplir nos salles sans faire du gros boulevard et les artistes apprécient d’aller à la rencontre d’autres publics.
Jean Robert-Charrier : Je ne me vois pas du tout comme un porte-étendard mu par la volonté de brouiller une quelconque frontière. Ma seule volonté est de produire des spectacles exigeants et intéressants. Or, force est de constater que le privé a un peu perdu en la matière et que les créations les plus pertinentes se trouvent actuellement dans le public. Il y aura toujours une guerre entre le théâtre public et le théâtre privé. Je ne cherche pas à réconcilier les deux, et je pense même que cette confrontation peut être saine. Dans son histoire, la Porte Saint-Martin avait déjà connu des reprises de pièces nées dans le théâtre public, notamment les mises en scène du Tartuffe de Roger Planchon et d’Antoine Vitez à la fin des années 1970 – une époque où la frontière était sans doute un peu plus poreuse entre ces deux mondes. Quand j’ai commencé à inviter Joël Pommerat, tout le monde m’est tombé dessus en disant : « Ça ne s’est jamais fait ! ». En réalité, ça s’était déjà fait, mais de manière peut-être plus opportuniste, sans pensée de production suffisamment globale et cohérente.
R.B. : Je cherche effectivement moins à brouiller les pistes qu’à répondre à une réelle exigence artistique. En revanche, j’ai bien conscience que nous ne pourrons jamais remplacer le théâtre public, notamment à l’endroit du travail qu’il mène sur les territoires, mais aussi en matière de médiation ou d’éducation artistique et culturelle.
J.R.-C. : Avec ces reprises, il faut quand même noter que nous donnons l’opportunité aux artistes de jouer sur des séries beaucoup plus longues et d’avoir accès à un public plus ouvert.
Comment opérez-vous vos choix ? Existe-t-il des spectacles plus compatibles avec le théâtre privé que d’autres ?
J.R.-C. : Je pense que nous allons, l’un comme l’autre, voir beaucoup de spectacles et que nos choix se font de manière assez instinctive, vers des spectacles qui nous touchent, avec une note populaire.
R.B. : Comme nous avons une forte contrainte économique liée aux recettes de billetterie, les spectacles que nous programmons doivent pouvoir toucher un public assez large. Il y a beaucoup de pièces que je vois, que j’adore, mais que je ne pourrai jamais programmer à L’Atelier.
J.R.-C. : Lorsqu’on se lance dans une série de soixante représentations, comme c’est notre cas, on sait qu’on pourra compter sur un fond de spectateurs venus du théâtre public, mais qu’il faudra enclencher le bouche-à-oreille de façon beaucoup plus large pour remplir. Quelqu’un comme Joël Pommerat, par exemple, a une vraie aura dans le public, mais est quasiment inconnu dans le privé. Les directeurs du privé n’ont, pour l’immense majorité d’entre eux, pas vu ses spectacles, et les spectateurs habitués au privé ne le connaissent pas davantage.
Comment le théâtre public réagit-il lorsque vous allez toquer à sa porte pour reprendre l’une de ses créations ?
R.B. : Je rencontre pour ma part peu de réticences, au contraire. Parfois, j’ai pu avoir des discussions avec des metteurs en scène qui, en première intention, m’ont dit : « Jouer dans le privé ?! Jamais ! ». Et puis, après plusieurs échanges, ils ont finalement accepté et m’ont même remerciée après coup pour cette opportunité.
J.R.-C. : Nous avons en réalité plus affaire à des compagnies en direct qu’à des institutions. Or, elles ont tellement besoin de jouer qu’elles acceptent souvent volontiers. Une telle collaboration est avant tout le fruit d’une relation de personne à personne. Il y a quelques années, j’avais entendu une interview d’Alain Françon où il crachait sur le théâtre privé. Aujourd’hui, il vient très régulièrement à la Porte Saint-Martin car il n’a pas l’impression de jouer dans le « théâtre privé ». Lorsque j’ai commencé, il y a huit ans, c’était plus difficile par rapport aux compagnies, aux théâtres nationaux, aux publics. Quand nous avons repris Cendrillon de Joël Pommerat, on a mis plusieurs semaines à remplir. Au fil des années, la situation a évolué et, aujourd’hui, c’est plein tout de suite.
R.B. : Je crois que nous avons tous les deux une vraie liberté car nous ne sommes pas soumis à un cahier des charges strict. Finalement, nous sommes parfois davantage directeurs artistiques que certains directeurs du théâtre public.
J.R.-C. : Ce qui pourrait nous guetter, et nous menacer, c’est une certaine forme de snobisme dans lequel nous ne devons absolument pas tomber – malgré l’étiquette qu’on nous colle assez facilement du côté du théâtre privé.
Comment parvenez-vous à résoudre l’équation économique qui s’impose à vous, alors que, contrairement au théâtre public, vous ne bénéficiez d’aucune subvention ?
J.R.-C. : Nous n’avons pas de subventions publiques directes, mais nous pouvons malgré tout compter sur la garantie de déficit de l’Association pour le soutien du théâtre privé (ASTP) qui agit comme un matelas financier si jamais l’exploitation d’un spectacle ne se passe pas comme nous l’avions prévue.
R.B. : Il est vrai que l’ASTP réduit un peu les risques et que son soutien m’a permis, par exemple, de produire Together de Denis Kelly et Les Enfants de Lucy Kirkwood au cours des saisons passées. Le modèle économique de L’Atelier repose sur l’alternance à 19 heures et à 21 heures qui nous permet, je crois, de fidéliser les publics, notamment à l’occasion de cycles, comme celui que nous préparons autour de Jean-Luc Lagarce à la fin de la saison. Par ailleurs, comme nous devons penser à la billetterie, nous jouons absolument tous les jours.
J.R.-C. : De notre côté, nous avons vu notre bénéfice fondre comme neige au soleil, et il est certain que nous gagnerions mieux notre vie en programmant un seul gros boulevard qui occuperait toute la saison. Pour autant, malgré une maison très coûteuse et une grille tarifaire moins élevée que dans d’autres théâtres privés – le prix moyen de la place payée est de 35 euros, contre 60 euros chez certains de nos homologues du privé –, nous sommes bénéficiaires tous les ans. Nos actionnaires nous laissent la liberté de programmer. Ce ne sont pas des mécènes, mais, si le bilan est positif, nous faisons ce que nous voulons. Malgré tout, il faut savoir faire des concessions en permanence, et accepter, parfois, de louer la salle pour certaines productions ou certains événements. Quand Frédéric Franck dirigeait le Théâtre de la Madeleine et le Théâtre de l’Oeuvre, il faisait un travail de programmation formidable, mais il n’a pas voulu faire ces concessions et il s’est planté économiquement.
R.B. : À L’Atelier aussi, nous louons la salle pour accueillir d’autres productions, mais je veille toujours à ce qu’il y ait un goût, voire une certaine cohérence avec le reste de la saison.
Comment réagissent les spectatrices et les spectateurs du privé, peu habitués, par essence, aux productions du théâtre public ?
J.R.-C. : Cette dynamique nous permet de renouveler naturellement nos publics structurellement vieillissants car je remarque que plus les spectacles sont exigeants, plus les spectatrices et les spectateurs sont jeunes.
R.B. : Pour renforcer ce constat que j’observe aussi à L’Atelier, je tiens à conserver les places à 10 euros pour les moins de 26 ans, et cela fonctionne. Pour un spectacle comme Fin de partie, la saison dernière, il y avait au moins une trentaine ou une quarantaine de jeunes dans la salle, chaque soir, à la fin de l’exploitation.
J.R.-C. : Face au travail de quelqu’un comme Joël Pommerat, c’est très visible. On distingue tout de suite celles et ceux qui sont des habitués du genre, et qui ont peut-être déjà vu certains de ses spectacles par le passé, et le public du théâtre privé, subjugué, qui n’a jamais vu ça de sa vie. Dans une manifestation comme le Festival d’Anjou, c’est encore plus criant. Les spectatrices et les spectateurs étaient habitués à voir François Berléand et Pierre Arditi depuis 40 ans, et tout à coup, on arrive avec Ça ira (1) Fin de Louis. Et on remarque, alors, que le public n’attendait que ça.
Propos recueillis par Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr


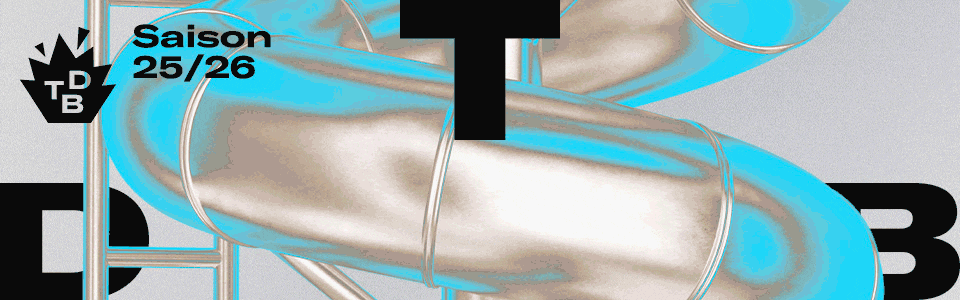


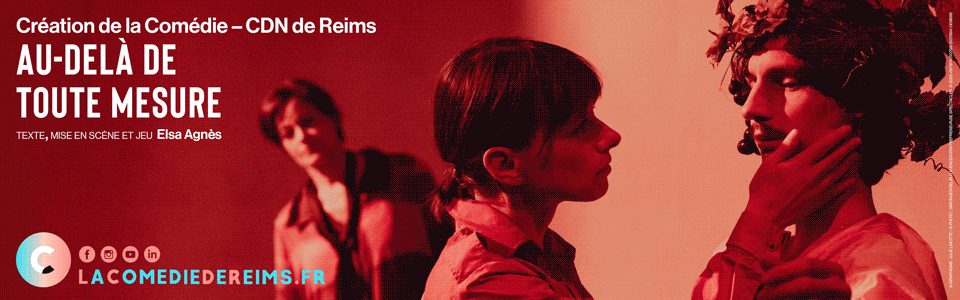








Charles Dullin est né en 1885 ! peut-être a-t-il pris la direction du Théâtre de l’Atelier en 1922 ?
Bonjour Agnès,
Merci beaucoup pour votre vigilance. Une malheureuse faute de frappe avait effectivement transformé 1922 en 1822…
Bien à vous,
L’équipe de sceneweb
En quoi est ce audacieux de ne pas prendre le risque de la production et de rediffuser et faire de l’argent en masse sur les risques du public ?