Dans une forme proche du stand-up, Vincent Dedienne plonge avec fougue et tendresse, sous la direction de Johanny Bert, dans le Journal de l’écrivain, et dessine, en même temps que son portrait, le paysage à la fois bouillonnant et ravagé d’une époque.
Tout commence avec la voix d’une dame que l’on devine âgée. À travers les mots qu’elle prononce, elle brosse le portrait d’un petit garçon pas tout à fait comme les autres, à la sensibilité si peu commune qu’elle irrite les jeunes gens qui croisent son chemin – « la gentillesse… », se désespère-t-elle, dans un léger soupir. À son égard, comme en témoigne son ton – qui trompe rarement –, elle éprouve une tendresse infinie, un amour filial, pourrait-on dire, celui d’une aïeule pour un descendant à protéger, celle d’une grand-mère pour son petit-fils. Ce petit-fils, c’est Jean-Luc Lagarce que Vincent Dedienne s’empresse, à la suite de cette introduction, de venir incarner. Au pas de course, littéralement. Comme si le temps était compté, et qu’il pouvait, à tout moment, venir à manquer. Veste de costume noire, haut noir, élégant pantalon en cuir noir, lui aussi, le longiligne comédien se met alors à tourner les pages du Journal de l’écrivain, à égrener ces dates, ces faits, ces gestes, et surtout ces pensées, que l’auteur a, entre 1977, l’année de ses 20 ans, et 1995, l’année de sa mort, patiemment et ardemment consignés. Assise à ses côtés, la dessinatrice Irène Vignaud se charge, à l’aide d’une tablette et d’un stylet numériques, de l’animation graphique. Quelques dates, quelques noms, quelques corps, et surtout de beaux visages, apparaissent alors sur le rideau de fils qui encadre le comédien, et retracent, en les illustrant façon BD, plus d’une vingtaine d’années d’existence.
« Il ne m’est jamais rien arrivé », prétendait Lagarce ; et pourtant, cette vie courte, trop courte, il l’a menée tambour battant, n’hésitant pas à brûler la chandelle par les deux bouts. Au rythme des morts qu’il compile – celles, pêle-mêle, de Michel Foucault, Simone Signoret, Coluche, Copi, Robert Mapplethorpe, Bernard-Marie Koltès ou Jacques Demy –, lui file à 100 à l’heure, entre projets théâtraux, dont il ne se gargarise jamais, avec sa compagnie, le Théâtre de la Roulotte, rapports aussi rares que compliqués avec une famille un peu trop tradi à ses yeux, et surtout des rencontres, le plus souvent fugaces, mais néanmoins intenses, avec des hommes, beaucoup d’hommes, dans une villa, au Jardin des Tuileries ou sous un porche lyonnais. Si, à une ou deux exceptions près, il a rarement été question d’amour avec eux, il a toujours été question de tendresse et de plaisir, charnel, sensuel, sexuel, mais aussi de liberté, folle liberté, dont Lagarce était épris. Sauf que le Sida a tout fait chavirer. Il a d’abord rôdé, à bas bruit, fauchant une ou deux connaissances, invitant le préservatif dans la danse, rendant les rapports plus compliqués ; et puis, il a tout balayé sur son passage, a emporté des amis, des amants, des idoles, jusqu’à s’incruster dans le corps de l’écrivain qui a appris, après un simple rendez-vous à l’hôpital Cochin, que ses jours étaient désormais comptés. En même temps que son portrait, c’est bien un monde, son monde, notre monde, dont Lagarce dépeint l’effondrement progressif.
Cette matière littéraire, avec laquelle il est visiblement plus à l’aise que le rôle de Louis qu’il incarne, en parallèle, dans Juste la fin du monde, Vincent Dedienne l’a précisément sélectionnée, et se l’est joliment appropriée jusqu’à la transformer en belle matière à jouer. Dans un face-à-face avec le public presque intégralement statique, à la manière d’un stand-up, et malgré un déroulé chronologique qu’il parvient à pimenter, le comédien réussit à faire reluire les différentes facettes de l’homme Jean-Luc Lagarce, tour à tour, et parfois tout à la fois, mélancolique et grivois, passionné et passionnel, désiré et désirant, mais également bravache, y compris et surtout avec la mort qui le menace. Si le fond de l’air corrompu par l’arrivée du Sida est lourd, lui n’est jamais grave, et ses traits d’esprit, repris avec autant de finesse que d’appétit par celui qui porte ses mots, font mouche, traduisant un sens de l’humour pour le moins décapant. Cette traversée, le comédien la mène, malgré tout, avec la délicatesse, le souci et le respect – qui ne tombe jamais dans la révérence – de ceux qui, visiblement, sont familiers de ce qu’on a appelé – de manière un peu générique – la « littérature du Sida », dont Hervé Guibert, que Lagarce admirait, constitue l’une des figures de proue.
En même temps qu’un hommage touchant à l’auteur, l’acteur s’attache aussi à dessiner, en filigrane, le paysage d’une époque en voie de disparition, mais bouillonnante, où, pour reprendre le tandem entre Eros et Thanatos, les pulsions de vie, forcément fougueuses, répondent aux pulsions de mort, nécessairement tragiques. Tout se passe comme si, à travers lui, à travers eux, Louis pouvait enfin se confier, auprès du plus grand nombre, sur cette sphère où il évolue, sur sa vie, sur ses amours, sur ses tourments que Juste la fin du monde ne lui avait pas permis d’exposer à son seul entourage. Pour ce faire, Vincent Dedienne n’est pas seul, et Johanny Bert, qui a conçu la scénographie et le met en scène, lui apporte un soutien discret, mais sensible, notamment quand le comédien se retrouve avec une marionnette à taille humaine, et d’un blanc immaculé, entre les bras, symbole de ces corps que l’on étreint toujours, même s’ils sont dévastés par la maladie – et qui ne sont pas sans faire écho à ceux que l’on a pu voir, notamment, dans 120 battements par minute de Robin Campillo, ou dans les séries Angels in America et It’s a Sin. Alors quand, reprenant l’un des derniers élans de plume de Lagarce, Vincent Dedienne assure, dans un sourire, « Je vais bien, je disparais, mais je vais bien », il devient difficile, derrière le sourire miroir, de ne pas sentir l’émotion s’inviter sur nos visages.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Il ne m’est jamais rien arrivé
d’après le Journal de Jean-Luc Lagarce (Les Solitaires Intempestifs)
Mise en scène, scénographie et direction d’acteur Johanny Bert
Assistante à la mise en scène Lucie Grunstein
Adaptation et interprétation Vincent Dedienne
Dessinatrice au plateau Irène Vignaud
Création lumières Robin Laporte
Création silhouette Amélie Madeline
Costumes Alma BousquetProduction Théâtre de l’Atelier
En partenariat avec le Théâtre de RometteDurée : 1h
Vu en janvier 2025 au Théâtre de l’Atelier, Paris
Nouveau Théâtre Besançon, CDN de Franche-Comté
le 28 janvier 2026MA Scène nationale, Montbéliard
le 29 janvierThéâtredelaCité, CDN Toulouse Occitanie
du 1er au 5 févrierThéâtre Ducourneau, Agen
le 7 févrierThéâtre de l’Atelier, Paris
du 12 février au 8 marsThéâtre de Lorient, CDN
le 14 févrierEspace Michel-Simon, Noisy-le-Grand
le 17 févrierThéâtre de la Croix-Rousse, Lyon
du 4 au 6 juin





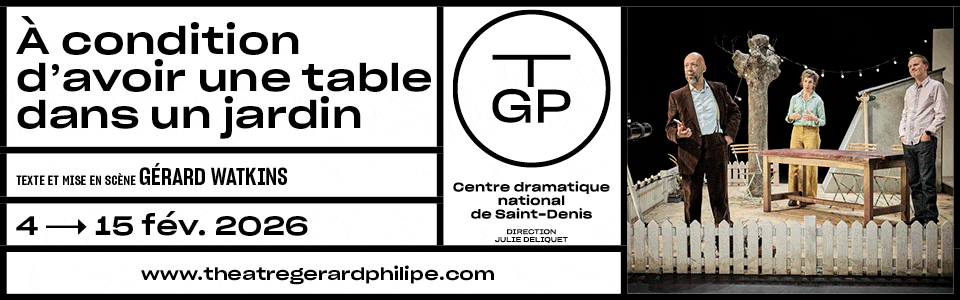







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !