Laure Werckmann fait ses débuts au Théâtre du Peuple de Bussang, dans les mises en scène de Philippe Berling, puis au sein du collectif d’acteurs La Compagnie d’Edvin(e), dirigé par Eric Ruf. Elle co-pilote pendant trois ans le Festival Actuelles et crée sa propre compagnie, la Compagnie Lucie Warrant. Elle adapte l’autobiographie de Nastassja Martin, Croire aux fauves, au TJP CDN Strasbourg-Grand Est.
Avez-vous le trac lors des soirs de première ?
Oui ! Les soirs de premières et les autres soirs. Bien sûr, la première a quelque chose de très singulier. C’est la naissance d’une œuvre ; c’est le regard porté par le public pour la première fois qui la fait exister dans sa totalité, qui la révèle, la fait résonner enfin ; c’est un trac qui mêle des sentiments très ambivalents, comme pour les grandes étapes de l’existence : de l’inquiétude à l’impatience, de la crainte à la joie, de la sourde fatigue à l’intense excitation.
Comment passez-vous votre journée avant un soir de première ?
Tout dépend des spectacles. Il m’est arrivé d’avoir à modifier des choses le jour même et donc d’avoir à faire ce qu’on appelle des « raccords », un temps de répétition où il s’agit de réajuster, par exemple, du texte ou une scène. Et puis, il arrive aussi que la première soit un temps sacralisé destiné à ce que le travail se dépose. Dans ce cas, il faut laisser la vie quotidienne reprendre ses droits pour avoir suffisamment de détente.
Avez-vous des habitudes avant d’entrer en scène ? Des superstitions ?
Pour chaque spectacle, au fur et à mesure des répétitions, un rituel singulier s’invente, sans que je le décide préalablement. Il va répondre au besoin spécifique de l’ouvrage. Certains spectacles commandent, par exemple, d’être là longtemps à l’avance pour le maquillage ou le costume, et cela a forcément des conséquences sur le rituel qui se compose. Pour Croire aux fauves, je ne sais pas encore, mais je vois poindre des nécessités d’échauffement et de préparation pour le maquillage, les perruques et les postiches.
Première fois où vous vous êtes dit « Je veux faire ce métier » ?
Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours voulu faire ce métier, toujours. Je pourrais l’accrocher à un souvenir : l’enterrement de mon arrière-grand-mère. Je ne me souviens plus de l’âge que j’avais, j’étais très petite, peut-être 5 ou 6 ans. Je l’aimais bien, mais je ne la connaissais pas vraiment. Elle était très vieille avec des rides très profondes. Je lui aurais donné 100 ans. Je n’arrivais pas à parler avec elle. Elle était toujours assise dans le coin d’une pièce à observer. Elle était toujours vêtue de noir. Elle ne disait rien la plupart du temps, et les quelques rares fois où je l’ai entendue parler, c’était en alsacien.
Elle m’impressionnait. Elle me fascinait. Le jour de son enterrement, j’ai eu l’impression d’une continuité. Elle n’était plus assise, mais allongée. Elle continuait à ne pas parler. Elle était toujours en noir, toujours impassible, comme la gardienne d’un secret, très impliquée, engagée. On la mettait en terre. Et ça semblait bien pour elle, beau. Je n’étais pas triste. J’étais contente d’être là pour savoir où elle se tiendrait désormais. Puis, j’ai vu tout le monde pleurer. Je voulais être avec les autres aussi. Alors j’ai pleuré. Je voulais me relier, comprendre un petit bout de ce que les autres vivaient, être avec eux. Peut-être que le théâtre a un peu à voir avec ça, oscillant entre l’incitation à vivre avec les autres et la sympathie à l’égard de celles et ceux qui ne sont plus parmi nous.
Premier bide ?
Un spectacle militant que nous avions créé enfants, avec ma soeur et ma cousine. On voulait sauver la paix, en obligeant tout le monde à penser comme nous !
Première ovation ?
À 15 ans, La souriole. Un solo que j’ai écrit adolescente et que j’ai joué avec le club théâtre de mon lycée. Une jeune fille atteinte de la maladie du sourire raconte toute sa difficulté d’exister. Aucun médicament, que des malentendus.
Premier fou rire ?
Au centenaire du Théâtre du Peuple de Bussang. Nous jouions une pièce de son fondateur, Maurice Pottecher, Le lundi de la Pentecôte, où deux familles s’affrontent lors d’un traditionnel pique-nique. Dans la mise en scène de Philippe Berling, les familles étaient distinguées grâce au maquillage génial de Cécile Kretschmar – la créatrice des maquillages de Croire aux fauves, c’est là que nous nous sommes rencontrées. Les uns avaient des moustaches ou des sourcils très fournis, les autres des nez et des oreilles très rouges. Et je crois que nous n’avons pas fait une représentation normalement, je veux dire sans un fou rire qu’il fallait calmer.
Premières larmes en tant que spectatrice ?
1980 de Pina Bausch. J’avais ce sentiment profond et puissant de vouloir en faire partie, d’être avec elles et eux. Je ne voulais pas que ça s’arrête.
Première mise à nu ?
Au sens propre : Les belles endormies du bord de scène, le deuxième spectacle de La Compagnie d’Edvin(e) fondée par Eric Ruf. Eric est venu me demander si j’étais d’accord d’ouvrir le spectacle avec la danse nue d’une jeune femme libre derrière un rideau de tulle noir. Libre des regards, libre de son corps. C’était délicat, pudique et surtout plein de joie. Comme une peinture lointaine qui s’animait d’un puissant élan vital. Au sens figuré : la vie et le théâtre constituent un éternel jeu de cache-cache. Alors, quand est-ce qu’on se découvre le plus reste une question en suspens.
Première fois sur scène avec une idole ?
J’ai débuté à 17 ans et j’ai appris grâce aux autres, avec les autres. Ainsi, mes partenaires ont d’abord été des idoles, avant que j’admette que ça n’était pas la meilleure façon de faire alliance.
Première interview ?
Tard, car j’évitais tant que je pouvais ! J’ai longtemps cru que je ne pouvais pas parler à la première personne du singulier.
Premier coup de cœur ?
Les coups de cœur, j’avance avec. Difficile de me rappeler du premier. Croire aux fauves est un sacré, un immense coup de cœur.





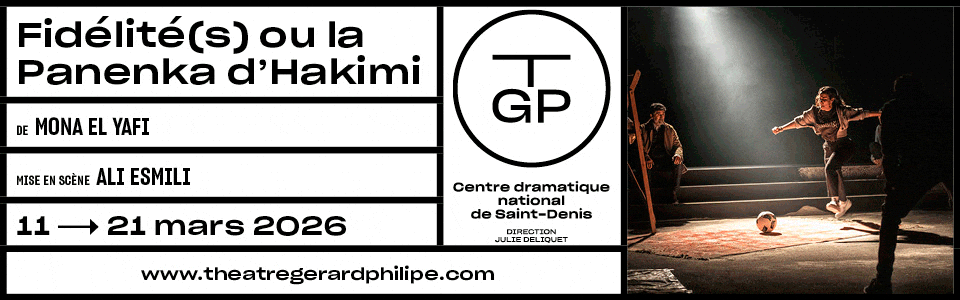








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !