Entre création et reconstitution, un programme mixte donné au Palais Garnier célèbre et revisite l’héritage du chorégraphe et danseur avant-gardiste Vazlav Nijinski.
S’il est un événement qui a permis d’ouvrir, non sans tapage et ostentation, la voie de la modernité musicale et chorégraphique, c’est bien celui de la création du Sacre du printemps par les Ballets russes de Serge Diaghilev sur la musique abrasive d’Igor Stravinsky. Sa première représentation parisienne, donnée le 29 mai 1913, au Théâtre des Champs-Elysées, avenue Montaigne, reçue par nombre de sifflements, de hurlements, fut l’objet d’un scandale qui demeure gravé dans les mémoires de ses contemporains comme dans l’histoire de l’art mais qui n’a laissé que peu de traces. C’est la raison pour laquelle depuis plusieurs décennies, est entrepris un travail de recherches, disons archéologiques, dans les archives du spectacle, les photographies, les dessins, les articles de presse, les notes et les témoignages qui sont parvenus pour aboutir à la reconstitution la plus fidèle possible des décors et des costumes, conçus à l’époque de la création par le peintre Nicolas Roerich, et de la chorégraphie.
La version actuellement proposée au Palais Garnier a été confiée à Dominique Brun, chorégraphe spécialisée dans la recréation de titres du répertoire historique du XXe siècle. Cet objet de belle facture paraît nécessairement dépassée pour notre époque, voire même inoffensif au regard des revisites successives de l’ouvrage souvent empreintes de violence, d’érotisme et de sauvagerie à l’image de celles proposées par Maurice Béjart ou Pina Bausch d’une force érotique ou tellurique qui sidèrent bien autrement.
On regarde néanmoins avec un vif et curieux intérêt la recréation de ce Sacre originel. Celui-ci se présente comme une sorte de rituel païen haut en couleurs, orné de rondes et de farandoles de villageois affolés et affublés de costumes d’inspirations slaves et paysannes (coiffes et tuniques, peaux de bêtes). La danse se veut terrienne. Les pieds martèlent le sol au rythme nerveux et effréné de la partition jusqu’à l’issue fatale qui met en scène le sacrifice d’une élue pétrifiée campée par Alice Renavand dont l’immobilité se voit soudainement secouée par des spasmes à répétition.
Un an plus tôt et à seulement vingt-trois ans, Nijinski signait son premier ballet, moins sauvage, plus voluptueux, et donc tout aussi scandaleux, L’Après-midi d’un faune, d’après un texte de Mallarmé et sur une musique de Debussy. La chorégraphe israélienne Sharon Eyal, ancienne interprète de la célèbre Batsheva, formée auparavant à la danse classique, connaît et admire depuis l’enfance cet autre pilier du répertoire. Elle en propose un tableau elliptique et hypnotique qui s’amuse à démultiplier le faune en huit figures unisexes. Organique, la danse fait écho aux gestes anguleux et dissymétriques de Nijinski, eux-mêmes inspirés des corps peints sur les fresques et les vases de la Grèce antique. Les huit interprètes s’apparentent à de fringantes cariatides juchées sur demi pointes, en constante instabilité mais solidement sculptées et bandées. Eyal demeure fidèle à son geste chorégraphique qui fait se conjuguer minimalisme formelle et prouesse physique. Elle déplace Nikinski du cubisme vers l’expressionnisme avec tout ce qu’il comporte d’attraction sensuelle et de troublante étrangeté. Le résultat est fascinant.
Rhapsody de Frederick Ashton, une petite pièce en un acte à la vivacité plaisante a ouvert la soirée. Son esthétique repose sur une théâtralité exacerbée qui rappelle le travail de Ulla von Brandenburg montré au Palais de Tokyo. Au devant d’un mini-corps de ballet toujours en mouvements et épatant de vivacité, Pablo Legasa, voltigeur de grande classe et Ludmila Pagliero, toute en légèreté et en alacrité, forment un couple irradiant parfaitement rompu à l’exigence technique requise.
Christophe Candoni – www.sceneweb.fr
L’Après-midi d’un faune
Création
Avec
Marion Barbeau,
Caroline Osmont,
Nine Seropian,
Marion Gautier de Charnacé,
Héloïse Jocqueviel,
Simon Le Borgne,
Yvon Demol,
Antonin MoniéMusique :
Claude DebussyChorégraphie :
Sharon EyalDirection musicale :
Vello PähnCo‑créateur :
Gai BeharDécors :
Eyal GeverVidéo :
Eyal GeverCostumes :
Maria‑Grazia ChiuriLumières :
Alon CohenLe Sacre du printemps
Nouvelle production en accord avec la succession Vaslav et Romola Nijinski
Avec
Émilie Cozette,
Alice Renavand,
Letizia Galloni,
Juliette HilaireMusique :
Igor StravinskyChorégraphie :
Vaslav NijinskiDirection musicale :
Vello PähnRecréation et adaptation chorégraphique :
Dominique BrunDécors et costumes :
Nicolas RoerichAdaptation scénique et conseiller historique :
Alexandre VassilievRhapsody
Avec
Laura Hecquet,
Myriam Ould-Braham,
Ludmila Pagliero,
Sae Eun Park,
Mathieu Ganio,
Pablo Legasa,
Marc Moreau,
Francesco MuraMusique :
Serguei Rachmaninov – (Rhapsodie sur un thème de Paganini)Chorégraphie :
Frederick AshtonDirection musicale :
Vello PähnDécors :
Patrick CaulfieldCostumes :
Patrick CaulfieldLumières :
John B. ReadPiano solo :
Joseph MoogLes Étoiles, les Premiers Danseurs et le Corps de Ballet
Orchestre de l’Opéra national de ParisPalais Garnier
du 29 novembre 2021 au 02 janvier 2022





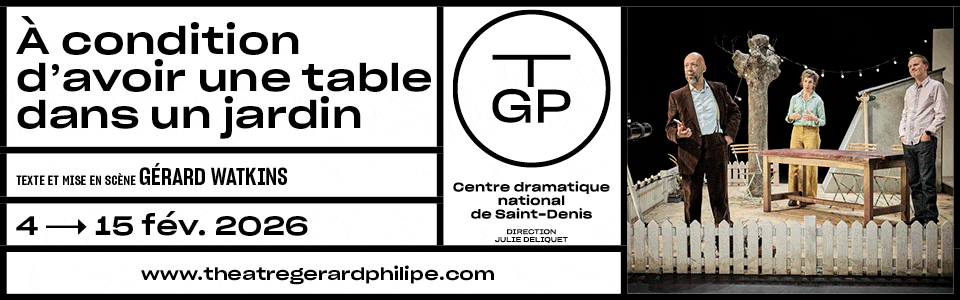








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !