À l’Opéra de Lyon, le baryton français Stéphane Degout fait un admirable Wozzeck de Berg placé par le metteur en scène Richard Brunel au cœur d’une expérience médicale qui renforce la déréliction et la vulnérabilité du personnage.
Richard Brunel cultive depuis longtemps le désir de monter Woyzeck, la pièce de Büchner, qu’il découvre très jeune et considère comme l’un de ses premiers chocs théâtraux. Pour ouvrir la saison de l’Opéra de Lyon qu’il dirige, il met en scène Wozzeck, l’adaptation lyrique composée par Alban Berg d’après l’œuvre fragmentaire et laissée inachevée par l’auteur allemand. Sans rien changer de la partition et du livret, mais en évitant toute littéralité, il délivre un scénario original, « nourri d’un imaginaire lié à la période post-Covid », dit-il. Il fait du rôle-titre un pauvre homme sans travail – il n’est plus soldat – qui se porte volontaire pour devenir, moyennant rémunération, le cobaye d’une expérience scientifique réalisée sur des êtres humains. Celle-ci est pilotée par un docteur, un capitaine, un ministre et un prêtre, autant de figures censées incarner une éthique vertueuse, mais qui semblent moins intéressées par la morale que par leur pouvoir de dominer et d’asservir. Grâce à la solidité de la dramaturgie, de la direction d’acteurs comme de l’interprétation des chanteurs qui forment un remarquable plateau vocal, tout se tient fort habilement dans cette nouvelle et pertinente lecture dystopique de l’opéra où Wozzeck finit manipulé par tous et dépossédé de lui-même.
Des murs gris, un éclairage lugubre, quelques accessoires cliniques – blouse blanche, chariot en acier, photos de radiologie sur écran rétroéclairé… C’est dans ce cadre angoissant, voire asphyxiant, que quatre péquenauds d’allure lambda paraissent en ligne, comme des accusés, pour candidater à l’expérimentation proposée. L’un d’eux est Wozzeck. Il remporte le contrat. Ce que les autres refoulés ne manqueront pas de lui faire payer à la scène suivante lorsqu’ils le recroisent à un arrêt de bus où ils le provoquent, puis le passent à tabac. Plus tard, une triste fête qui réunit le personnel et les patients au cours d’une danse aux gestes lents et somnolents ne saura égayer la sordide atmosphère.
De bout en bout, la mise en scène suit Wozzeck comme un être traqué par une grosse lampe télécommandée qui surplombe le plateau, errant et brinquebalant entre la froideur du centre médical, où il est examiné à intervalles réguliers, et l’intimité de son logement communautaire à l’aspect vétuste et poisseux. Se laisse observer l’existence morne du couple dysfonctionnel et profondément désenchanté que forme Wozzeck avec Marie, rongé au quotidien par la précarité et l’incommunicabilité. Leur unique enfant, solitaire et taciturne, regarde sans joie les dessins animés qui passent sur un grand écran de télé pendant que sa mère se laisse temporairement séduire par le Tambour-major avec lequel elle couche derrière le fin rideau qui sépare la cuisine de la chambre. Celui-ci est présenté comme un technicien venu installer une caméra au logis de Wozzeck placé sous surveillance pour les besoins de l’expérience. Dans ce contexte oppressif et sous les effets nocifs de son traitement médicamenteux, l’homme se laisse envahir par les dérèglements d’humeur, les crises de paranoïa et les hallucinations apocalyptiques.
Habitué aux rôles de torturés – Oreste, Hamlet, Onéguine, Pelléas… –, Stéphane Degout livre un impressionnant Wozzeck, mû par une ardeur et un tourment impossible à refréner. Faussement calme, débordant de violence et de tension, il est toujours prompt à dérailler. Musicien subtil dont la voix grandiose sur toute la tessiture est aussi incendiaire que charbonneuse, il distille autant de délicatesse qu’une insolente puissance musicale et théâtrale. L’accomplissement du crime passionnel se présente comme une acmé d’émotion glaçante. Telle que la campe Ambur Braid, très en voix avec des aigus charnus et cinglants, Marie n’est pas une suave pauvresse, mais plutôt une femme sanguine et sulfureuse bien que poignante d’un bout à l’autre. Sans lac ni lune, elle trouve la mort à côté de l’évier de la cuisine où elle est assassinée dans la douceur d’une quasi-étreinte.
En fosse, Daniele Rustioni, qu’on n’attendait pas forcément dans Wozzeck, se montre tout à fait éloquent. Sans jamais délaisser ses compositeurs italiens de prédilection, le chef s’est tourné progressivement, et avec brio, vers le répertoire allemand, avec des pièces de grande envergure comme Tannhäuser de Wagner ou La Femme sans ombre de Strauss, et ce en déployant toujours le lyrisme fiévreux et passionné qu’on lui connaît. Du chef-d’œuvre de Berg, il fait entendre toute la beauté mélancolique comme la sèche âpreté. L’orchestre rutilant atteint une plénitude de son sous sa direction à la fois souple et acérée. Sur la longue plage symphonique finale aux accents graves et ronflants, Wozzeck manipule tendrement le corps de Marie qu’il assoit à table, puis se place face à elle pour se poignarder à son tour. Seul avec sa peluche, l’enfant dresse la table et sert le dîner, en entonnant tout simplement ses « Hop ! Hop ! », entouré des corps inertes de ses deux parents. Le drame est saisissant.
Christophe Candoni – www.sceneweb.fr
Wozzeck
Opéra en trois actes d’Alban Berg
Livret du compositeur, d’après la pièce Woyzeck de Georg Büchner
Direction musicale Daniele Rustioni
Mise en scène Richard Brunel
Avec Stéphane Degout, Ambur Braid, Robert Watson, Thomas Ebenstein, Thomas Faulkner, Robert Lewis, Jenny Anne Flory, Hugo Santos, Alexander de Jong, Filipp Varik
Orchestre, choeurs et maîtrise de l’Opéra de Lyon
Scénographie Étienne Pluss
Costumes Thibault Vancraenenbroeck
Lumières Laurent Castaingt
Dramaturgie Catherine Ailloud-Nicolas
Chef des chœurs et de la maîtrise Benedict Kearns
Coaching vocal Kirsten SchoetteldreierCoproduction Opéra de Lyon, Opéra royal de Stockholm
Durée : 1h35
Opéra de Lyon
du 2 au 14 octobre 2024





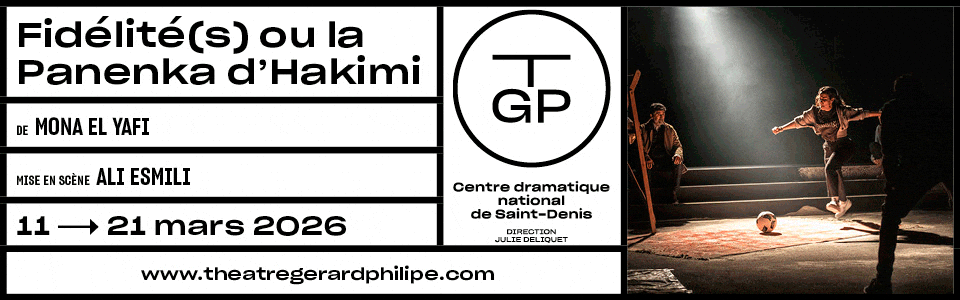








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !