Au Théâtre de l’Atelier, le metteur en scène Johanny Bert échoue à donner un quelconque relief au chef-d’oeuvre de Jean-Luc Lagarce, emmené par un Vincent Dedienne étonnamment transparent.
Il suffit parfois de quelques minutes, voire de quelques secondes, pour comprendre qu’un spectacle se fourvoie, qu’il emprunte une direction qui le conduira tout droit dans une impasse. Symbole de la programmation audacieuse, et de haute tenue, que Rose Berthet propose depuis qu’elle a pris la direction du Théâtre de l’Atelier, l’alliance entre Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce et le metteur en scène Johanny Bert est malheureusement de ceux-là, comme si la rencontre entre ce grand texte et l’artiste aux mille talents, notamment marionnettiques, n’avait pas vraiment eu lieu. D’entrée de jeu, tandis que Vincent Dedienne apparaît au proscenium dans la peau de Louis, le comédien s’avère incapable de poser avec suffisamment d’aplomb le cadre du récit qui va suivre. Jeu neutre, voix blanche, l’acteur, peut-être tétanisé par l’ampleur du rôle qu’il doit endosser, semble avoir la main qui tremble, et le douloureux retour aux sources familiales dont il façonne les bases en aparté, face public, ne se charge d’aucune intensité. Cet impair est d’autant plus préjudiciable que ce prologue conditionne l’ensemble des prises de parole à venir, qu’il permet de pénétrer dans la tête de Louis, de comprendre son attitude pétrie par la gêne de ceux qui ont une annonce à faire, mais ne savent pas comment s’y prendre, de ressentir la cruauté redoublée des mots qu’il aura bientôt à encaisser. Ces mots prononcés par un entourage qui, parce qu’il n’a pas le même niveau d’informations que le public confident, pense que l’heure n’est pas aux adieux, mais au règlement de comptes, à coups de banderilles plus ou moins affûtées.
À leurs yeux, Louis n’est pas, et ne peut pas être, ce jeune homme qui, alors qu’il n’a que 34 ans, est déjà au soir de son existence ; il est, et ne peut être que, celui qui les a fuis et rejetés, qui s’est extirpé du magma familial pour vivre sa vie, une autre vie, loin d’elles, loin d’eux, dans des sphères intellectuelles et sentimentales qui leur paraissent aussi lointaines qu’inaccessibles. Celui qui venait pour annoncer sa mort prochaine se retrouve alors à devoir subir les conséquences de ce qu’il a semé. Au long de pas de deux successifs, il fait face à cette belle-soeur qui tente, aussi gentiment que maladroitement, de tisser des liens avec lui ; à cette petite soeur à tel point en manque de son frère qu’elle en devient étouffante ; à cette mère à mi-chemin entre la joie de retrouver son fils depuis trop longtemps perdu de vue et la nostalgie d’un âge d’or familial réel ou fantasmé ; et surtout à ce frère cadet complexé, le plus vindicatif des membres de cet entourage, qui a vécu le départ de Louis comme un abandon en rase campagne, et n’accepte pas d’avoir eu à endosser les responsabilités d’un aîné et le rôle d’« homme de la famille » après la mort du père – que Johanny Bert fait, aussi étrangement qu’inutilement, apparaître sous la forme d’une marionnette-fantôme.
Tout dans cette pièce de Lagarce – présentée en diptyque avec une plongée dans le journal de l’auteur intitulée Il ne m’est jamais rien arrivé – n’est, en définitive, qu’une affaire de temps : de temps anciens qui apparaissent comme le creuset des haines actuelles ; de temps béni et révolu dont la mère peine à sortir ; de temps perdu qu’il est urgent, notamment pour la petite soeur, de rattraper de manière logorrhéique et compulsive ; de temps compté au regard de l’imminence de la mort de Louis ; et de temps suspendu, volé au cours dramatique des événements, et qui fait office de parenthèse inattendue dans la vie des différents protagonistes. Las, dans sa lecture comme dans sa direction d’acteurs, Johanny Bert semble avoir oublié de cultiver ce rapport crucial à la temporalité. Si, à l’exception notable de Louis, les personnages de Lagarce sont suffisamment caractérisés, le metteur en scène ne donne jamais l’occasion à cette langue si belle et particulière de se déployer. Au lieu de chercher à capter ces silences, longs ou très courts, subis ou brisés, qui donnent du relief à une phrase plus lourde de sens que d’autres, et qui, en rebond, révèlent le vide existentiel et relationnel dans lequel la parole échoue, Johanny Bert a laissé ses comédiennes et ses comédiens maîtresses et maîtres de leur destin, sans cap clair ni direction palpable, condamnés à expédier un texte dont les enjeux peinent à être saisis. Dès lors, si le texte de Lagarce, grâce à sa force intrinsèque, nous parvient distinctement, il apparaît édulcoré, appauvri, comme dévitalisé, privé d’une large partie de sa puissance émotionnelle ravageuse.
Peut-être conscient qu’il n’a pas réussi à trouver la clef d’une pièce dont il reste désespérément à la surface faute de l’avoir suffisamment creusée, le metteur en scène se réfugie alors dans sa zone de confort, dans ce travail scénographique où, comme l’ont prouvé ces précédents spectacles, il excelle. Avec son décor fait d’objets suspendus, qui descendent les uns après les autres du plafond au gré des scènes – et entretiennent, eux, un rapport au temps –, Johanny Bert réussit à créer des images, certes jolies, mais insuffisantes pour faire naître une quelconque intensité au plateau. Peu soutenus, y compris par des créations lumières et musicales un peu trop appuyées et téléphonées, les comédiennes et les comédiens en sont réduits à se débattre pour éviter la noyade. Si, grâce à leur engagement, Astrid Bayiha, Céleste Brunnquell, Christiane Millet et Loïc Riewer tiennent bon an mal an le choc, tout en restant, eux aussi, à la surface de ceux qu’ils entendent incarner, il en va tout autrement de Vincent Dedienne. Alors que, au-delà de ses seuls en scène, on avait pu le voir séduisant dans des rôles de théâtre classique, il paraît perdu dans celui de Louis, à qui il ne donne jamais, ni lorsqu’il écoute ni lorsqu’il parle, un semblant de relief. Tel qu’en lui-même, ou presque, le comédien neutralise tout, y compris les moments les plus beaux, à commencer par l’épilogue, pourtant cousus main par Lagarce. Ainsi fragilisé, celui qui devrait constituer la pierre angulaire de Juste la fin du monde transforme ce chef-d’oeuvre en colosse aux pieds d’argile, qui, à tout instant, menace de s’effondrer.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Juste la fin du monde
de Jean-Luc Lagarce (Les Solitaires Intempestifs)
Mise en scène et scénographie Johanny Bert
Avec Astrid Bayiha, Céleste Brunnquell, Vincent Dedienne, Christiane Millet, Loïc Riewer et, en alternance, les marionnettistes Kahina Abderrahmani et Élise Cornille
Assistante à la mise en scène Lucie Grunstein
Assistant à la scénographie Grégoire Faucheux
Création musicale Guillaume Bongiraud
Création sonore Marc De Frutos
Création lumières Robin Laporte
Création marionnette Amélie Madeline
Création costumes Alma Bousquet
Accessoiriste Irène VignaudProduction Théâtre de l’Atelier
Coproduction Théâtre de la Croix-Rousse
En partenariat avec le Théâtre de Romette
Avec le soutien de l’Institut International de la Marionnette dans le cadre de son dispositif d’aide à l’insertion professionnelle des diplômé.e.s de l’ESNAMDurée : 1h40
Théâtre de l’Atelier, Paris
à partir du 15 janvier 2025Le Sémaphore, Cébazat
du 25 au 27 marsLa Halle aux Grains, Blois
le 29 marsThéâtre de la Croix-Rousse, Lyon
du 1er au 5 avrilThéâtre Saint-Louis, Pau
les 8 et 9 avrilThéâtre Odyssée, Périgueux
le 11 avril
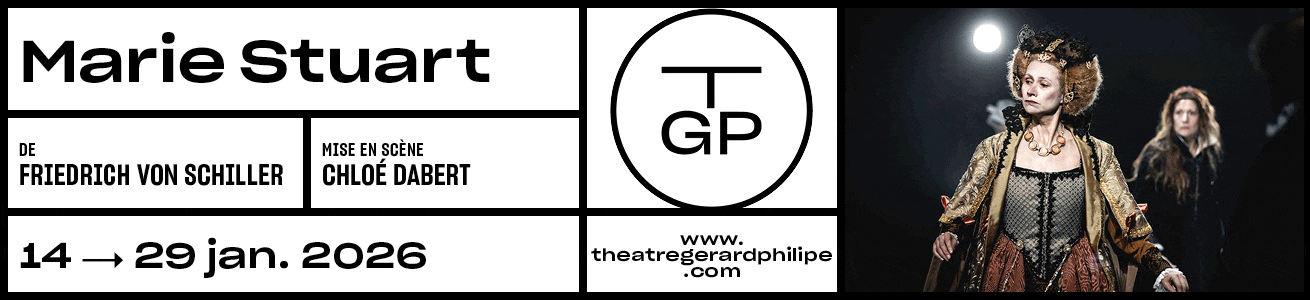

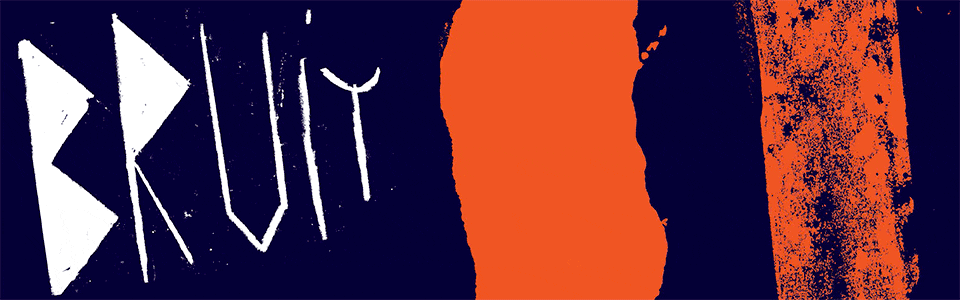


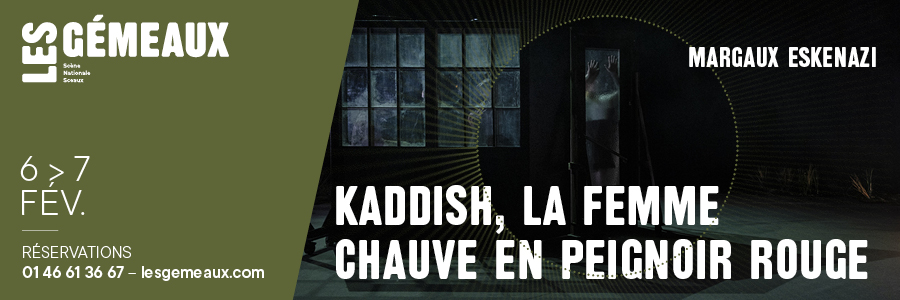







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !