
Photo Simon Gosselin
Le metteur en scène et co-directeur de la Comédie de Colmar pêche par excès de réalisme et fait perdre aux figures et à la langue raciniennes une large partie de leur magnificence et de leur puissance.
Le palais de Thésée a vécu. Sur la scène de la Comédie de Colmar, il n’en reste que des ruines, ou plutôt une coquille vide aux murs défraîchis, symbole de la déshérence des femmes et des hommes qui l’habitent encore. En guise de lit, Hippolyte ne dispose plus que d’un vulgaire matelas posé à même le sol. Même la lumière du jour peine à s’infiltrer dans ce campement de fortune à qui les murs beaucoup trop épais donnent une allure carcérale. Emprisonnés, les personnages de Phèdre le sont évidemment, en ce lieu et en eux-mêmes, aux prises avec des injonctions contradictoires qui, dans le conflit qu’elles provoquent, les broient de l’intérieur. Cette dialectique entre l’ombre et la clarté, Kelig Le Bars – dont il faut souligner, pièce après pièce, l’immense justesse du travail – l’entretient avec sa création lumière. Sous sa houlette, le plateau ne cesse d’être scindé, souvent par la diagonale, en deux camps opposés, où les figures raciniennes se répartissent en fonction de leurs intentions, mais aussi de la perception qu’elles ont les unes des autres et qui peut varier selon la teneur des événements.
Car, dans Phèdre, l’immobilisme n’est que de façade. Apparemment figés, pour ne pas dire pétrifiés, dans l’attente du retour de Thésée, son fils Hippolyte, son épouse Phèdre et l’ensemble de l’aréopage qui les entoure sont, en réalité, soumis au tourbillon du désir. Tandis que le premier succombe progressivement aux charmes d’Aricie, prisonnière de Thésée en tant qu’héritière putative du trône, mais follement amoureuse du jeune homme, la seconde brûle d’amour pour son beau-fils. Une passion criminelle aux yeux de la morale qu’elle tente de refréner, mais qu’elle confesse du bout des lèvres à Oenone, sa confidente et nourrice. Alors qu’elle doit annoncer à Hippolyte le funeste destin de Thésée, dont la rumeur de la mort court à travers Athènes, Phèdre, dans un moment d’égarement, lui avoue ses sentiments. Horrifié, le jeune homme la repousse violemment et sa belle-mère, avec la complicité d’Oenone, promet qu’elle se vengera, tôt ou tard, de cet affront. Un objectif que le retour du maître d’Athènes, finalement bien vivant, va lui donner l’occasion d’atteindre, au-delà même de ses espérances.
Ce monument du théâtre français, Matthieu Cruciani ne le traite pas avec révérence. Après avoir adapté La Nuit juste avant les forêts de Bernard-Marie Koltès, le co-directeur de la Comédie de Colmar a plutôt cherché à s’approprier la pièce de Racine – dont il avait déjà monté Andromaque –, à la placer à hauteur d’Hommes, à la transformer en oeuvre à tel point emplie de sentiments humains qu’elle se mettrait à en déborder. Dans cette entreprise de désacralisation, le metteur en scène semble avoir oublié que, comme dans toute tragédie classique, ce sont, dans Phèdre, les Dieux bien plus que les Hommes qui sont à la manoeuvre. Marionnettes des querelles divines, les individus sont, avant des êtres de chair et de sang, des figures gorgées de valeurs, ce qui leur impose une certaine droiture, et une hauteur de vue, dont elles paraissent ici totalement dépourvues. Empêtrés dans de vulgaires turpitudes humaines, trop humaines, les personnages de ce Phèdre-là font, par excès de réalisme, perdre une large partie de sa puissance à la pièce d’origine. À l’avenant, la langue racinienne, et sa métrique qui frise la perfection, est volontiers malmenée. En souhaitant la normaliser le plus possible pour mettre le sens au premier plan, Matthieu Cruciani la prive de son caractère précieux et cette magnificence d’où elle tire sa force.
Plus proches du plancher des vaches que des Dieux, malgré la belle scénographie évolutive de Nicolas Marie qui, peu à peu, s’ouvre sur cette mer où le raz-de-marée final fourbit ses armes, les comédiennes et les comédiens peinent alors à donner aux personnages qu’ils incarnent le caractère et l’aura qui leur reviennent. Étonnamment, ce sont mêmes des acteurs aux commandes de seconds rôles, ceux d’Oenone et de Thésée, qui dament le pion au duo principal. Tandis que Hélène Viviès et Maurin Ollès échouent, en dépit de leurs efforts, à donner une envergure à Phèdre et Hippolyte, Lina Alsayed et Thomas Gonzalez, lorsqu’il ne force pas trop le trait, endossent respectivement avec plus de justesse, d’assurance et d’amplitude les habits de la confidente conspiratrice et du maître d’Athènes, blessé, tout à la fois, dans sa chair et dans son orgueil. Malheureusement, il en faudrait plus pour donner à Phèdre le lustre qu’elle mérite, celui de l’un des plus beaux joyaux du théâtre classique.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Phèdre
de Jean Racine
Mise en scène Matthieu Cruciani
Avec Lina Alsayed, Jade Emmanuel, Ambre Febvre, Thomas Gonzalez, Maurin Ollès, Philippe Smith, Hélène Viviès
Scénographie Nicolas Marie
Création musicale Carla Pallone
Costumes Pauline Kieffer
Création lumière Kelig Le Bars
Assistanat à la mise en scène Jules Cibrario
Régie générale Manuel Bertrand
Régie plateau Bruno Friedrich
Régie lumière Thierry Gontier
Régie son Éve-Anne Joalland en alternance avec Grégoire Harrer
Construction décor Eclectik Scéno
Patines Élisa Martin, Sara Cubaynes
Toile peinte Atelier DevineauProduction Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace
Coproduction MC2: Maison de la Culture de Grenoble – Scène nationale
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Avec le soutien du Fonds d’insertion pour jeunes comédiens.nes de l’ESAD-PSPBB et de l’École de la Comédie de Saint-Étienne / DIESE # Auvergne-Rhône-AlpesDurée : 2h
Comédie de Colmar – CDN Grand Est Alsace
du 25 janvier au 2 février 2024Les Scènes du Jura – Scène nationale, Lons-le-Saunier
les 7 et 8 févrierThéâtre Olympia – CDN de Tours
du 13 au 16 févrierLes Gémeaux – Scène nationale, Sceaux
du 7 au 17 mars




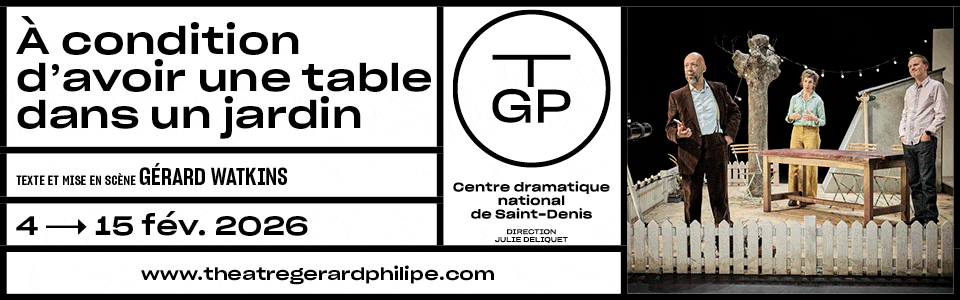

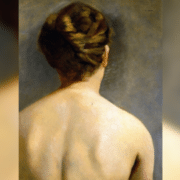






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !