Le directeur du Théâtre National de Bretagne reprend, seize ans après sa création à Boston, sa version à l’américaine de la tragédie historique shakespearienne, et prouve, au long d’une sublime cérémonie, que les mots des spectres antiques peuvent résonner, intimement et politiquement, avec les maux du temps présent.
Qui sommes-nous, nous, pauvres spectatrices et spectateurs de théâtre, pour réveiller ces êtres-là ? Tels des chats de Schrödinger, ou des individus quantiques, ils ont de quoi donner le tournis à n’importe quel historien dans leur manière d’habiter simultanément trois dimensions temporelles bien distinctes : celle de l’histoire ancienne et de la République romaine qui les a vus naître ; celle de l’histoire littéraire moderne et de l’oeuvre shakespearienne qui les a ressuscités ; et celle de l’histoire théâtrale contemporaine et du répertoire d’Arthur Nauzyciel qui les avait déjà convoqués, une première fois, en 2008, à Boston, à l’occasion de la création de ce Julius Caesar. Seize ans après les faits, le metteur en scène et directeur du Théâtre National de Bretagne y revient donc à cette pièce historique de Shakespeare et réactive, en même temps que les fantômes qui l’animent, un spectacle qui fait office de charnière dans son parcours. Ce projet est d’autant plus pertinent qu’il tombe, fortuitement ou non, doublement à point nommé : à quelques jours du retour, qui peut susciter bien des craintes démocratiques, de Donald Trump à la Maison-Blanche ; et quelques années après deux adaptations notables de ce texte, très rarement monté en France. L’une maladroitement commise par Rodophe Dana, en 2019, à la Comédie-Française, et l’autre présentée avec plus de succès par Ivo van Hove, un an plus tôt, au Théâtre de Chaillot, mais sévèrement allégée pour se fondre dans ses Tragédies romaines, où l’artiste flamand lui adjoignait Coriolan et Antoine et Cléopâtre. En regard, Arthur Nauzyciel prouve, avec sa version à l’américaine de la pièce shakespearienne, son immense talent de metteur en scène, capable d’éclairer d’une lumière nouvelle ce texte malaimé et de renverser ses prétendues faiblesses pour les transformer en forces motrices.
Ce défi n’était pas gagné d’avance tant, pour peu qu’elle soit mal maîtrisée, l’oeuvre du dramaturge anglais peut rapidement virer au vulgaire tour de piste historique et se borner à une stricte piqûre de rappel des faits et gestes antiques. D’entrée de jeu, Shakespeare nous plonge au coeur du réacteur, ou plutôt au bord du précipice, celui qui menace d’engloutir définitivement la République romaine et de mettre un point final à la démocratie. Soumis depuis nombre d’années à des convulsions qui perturbent de plus en plus gravement son fonctionnement, le régime politique se retrouve, en 44 av. J.-C., sous la coupe d’un seul individu, César, qui tord à ce point les institutions qu’il tend à mettre en place, décision après décision, une monarchie qui ne dit pas son nom. Réélu consul année après année, l’homme fort de Rome conduit une politique populiste avec laquelle il s’assure le soutien inconditionnel du bon peuple, par ailleurs ébloui par ses victoires militaires récentes dans la guerre civile qu’il mène contre Pompée et ses partisans.
Acclamé par la foule à l’occasion d’un « triomphe » au début du texte shakespearien, il ne tarde pas à être nommé « dictateur à vie » par le Sénat, avant, peut-être, d’être fait « roi » – dans la République romaine, ce terme est lourd de sens puisqu’il renvoie à la période monarchique qui la précède –, ce à quoi, pour le moment, et à contrecoeur, il se refuse, par peur de la réaction des citoyens. Cette toute-puissance progressivement acquise – et à ce point assurée qu’elle lui permet de balayer d’un revers de main les mises en garde du devin qui l’avertit du danger qui le guette le jour des Ides de Mars – finit par inquiéter nombre de sénateurs, à commencer par Cassius qui décide d’ourdir un complot contre lui, et tente de convaincre plusieurs de ses homologues, en particulier Brutus, de le rejoindre. De discussion d’alcôve en discussion d’alcôve, le projet d’assassinat prend forme et aboutit à la mort de César, sauvagement poignardé par les conjurés, puis à leur mise au ban orchestrée de main de maître par les héritiers du défunt, Octave et Marc Antoine, qui entendent bien venger le décès de leur père politique – et mettre Rome sur les rails de l’Empire.
Loin de se faire prendre au piège de la fresque historique, Arthur Nauzyciel donne à la pièce l’allure d’une sublime cérémonie habitée par des fantômes qui repasseraient les plats d’une histoire bien connue, et dont ils paraissent déjà appréhender l’issue : leur perte à tous, ainsi que celle de la démocratie. Au lieu de sacrifier certains passages sur l’autel de l’efficacité, le metteur en scène se sert des longues palabres shakespeariennes, qui peuvent parfois passer pour des bavardages, pour dilater, voire suspendre, le temps, mais aussi faire grandir les âmes. Sous sa houlette, Cassius, Brutus et consorts ressemblent à ces Grecs qui, dans Iphigénie, sont coincés, les armes au pied, à Aulis, et retardent, de facto, le massacre troyen à venir, qu’ils savent d’ores et déjà coûteux pour tous les belligérants. Surtout, chacun des personnages, y compris féminins, s’éloignent du statut de simples figures historiques pour prendre une épaisseur humaine qui permet non seulement de toucher du doigt leurs motivations politiques, mais aussi d’apercevoir les ressorts intimes qui les animent, de sonder, dans une forme de radiographie théâtrale, les coeurs qui irriguent, et dirigent, les têtes. Avec une sensualité que peu d’artistes auraient osée, Arthur Nauzyciel offre alors corps et chair à ces fantômes de l’Histoire, qui passent pour des gangsters du pouvoir, lointains cousins des malfrats du Splendid’s de Genet que le metteur en scène avait choisi de monter quelque temps plus tard, en 2015.
Cette réussite, qui, de bout en bout, tient le fin équilibre shakespearien où ni les uns ni les autres ne sont explicitement condamnés, où, avant toute chose, se dessinent l’impasse dans laquelle se trouve une démocratie qui n’est plus que l’ombre d’elle-même et le menace mortelle qui la guette – et qui résonne ardemment avec notre temps présent, aux États-Unis comme en Europe –, ce Julius Caesar la doit aussi aux multiples talents dont Arthur Nauzyciel a su s’entourer. Avec ses immenses photos reproduisant la salle vide d’un théâtre, autant qu’un hémicycle politique, l’ingénieux et magnifique décor de Riccardo Hernandez vit au rythme de la pièce, et concourt à condamner ou libérer ses personnages, en même temps qu’il tend un troublant miroir aux spectatrices et spectateurs, en mesure d’inverser la place des morts et des vivants, de la fiction et du réel. Tout comme les lumières de Scott Zielinski, capables, tour à tour, de transformer le plateau en sombre cloaque ou en chambre noire, il contribue à l’atmosphère singulière, vénéneuse et captivante, du spectacle, qui, si elle emprunte certains codes des années 1960, parvient à jouir de la force de l’atemporel, et à créer des images renversantes – avec, au premier rang, le retour de Marc Antoine sur la dépouille de César au rythme de My Body Is a Cage d’Arcade Fire et le combat final contre les conjurés. Finement dirigés par Arthur Nauzyciel, profitant du travail chorégraphique toujours aussi aérien et délicat de Damien Jalet, les comédiennes et les comédiens américains, accompagnés par un trio musical de choix – Marianne Solivan au chant, Leandro Pelligrino à la guitare et Dmitry Ishenko à la contrebasse – n’ont alors plus qu’à s’imposer comme les imperturbables patrons du plateau, et démontrent, y compris dans leurs pas de danse finaux sur l’inattendue Nelly Furtado, que les spectres antiques peuvent bel et bien frapper les consciences, et toucher les coeurs contemporains.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Julius Caesar
Texte William Shakespeare
Mise en scène Arthur Nauzyciel
Avec Sara Kathryn Bakker, David Barlow, Jared Craig, Roy Faudree, Ismail Ibn Conner, Isaac Josephthal, Dylan Kussman, Mark Montgomery, Rudy Mungaray, Daniel Pettrow, Timothy Sekk, Neil Patrick Stewart, James Waterston, et les musiciens Marianne Solivan (chant), Leandro Pelligrino (guitare), Dmitry Ishenko (contrebasse)
Décor Riccardo Hernandez
Lumières Scott Zielinski
Costumes James Schuette
Son David Remedios
Chorégraphie Damien Jalet
Régie générale Erik Houllier
Régie plateau Antoine Giraud-Roger
Régie son Florent Dalmas
Régie lumière Christophe Delarue
Habillage Charlotte Gillard
Assistanat à la mise en scène Constance de Saint RemyProduction 2025 Théâtre National de Bretagne
Production 2008 Centre Dramatique National Orléans/Loiret/Centre, en partenariat avec l’American Repertory Theatre (principal mécène : Philip and Hilary Burling)
Coproduction Festival d’Automne à Paris ; Maison des Arts de Créteil ; TGP-CDN de Saint-Denis
Avec le soutien du Fonds Étant Donnés The French-American Fund for The Performing Arts, a Program of FACEDurée : 3h20 (entracte compris)
Théâtre National de Bretagne, Rennes
du 9 au 17 janvier 2025TNP, Villeurbanne
du 23 janvier au 1er févrierLes Gémeaux, Scène nationale de Sceaux
du 6 au 15 mars


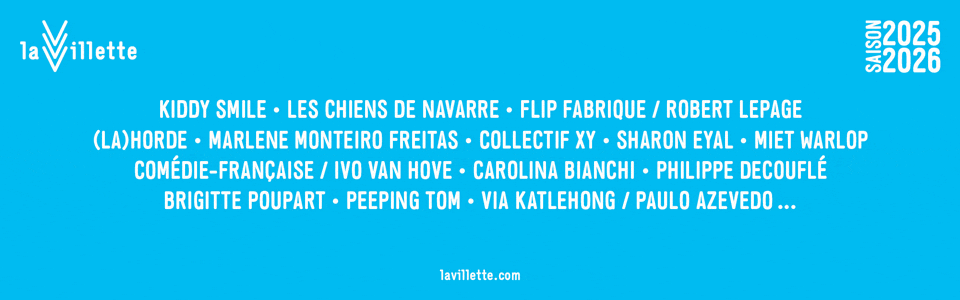


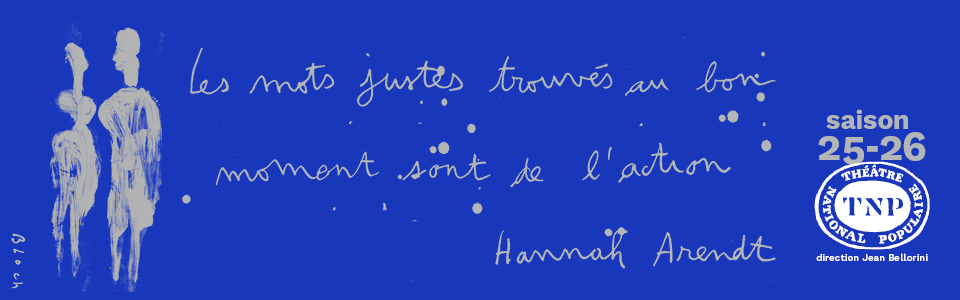








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !