
Photo Catherine Hélie
Depuis près de cinquante ans, la professeure émérite de littérature latine à l’université Paris-Diderot sublime, par ses traductions, la théâtralité des tragédies du dramaturge romain. Aujourd’hui, elle murmure à l’oreille des jeunes metteurs en scène qui, comme Louise Vignaud ou Thomas Jolly, s’attaquent à ces pièces moins classiques qu’il n’y parait.
Les tragédies de Sénèque étaient-elles destinées au théâtre ? Au sortir du Phèdre monté par Louise Vignaud au Studio-Théâtre de la Comédie-Française ou du Thyeste de Thomas Jolly, qui poursuit sa longue tournée après son succès lors du dernier Festival d’Avignon, la question peut sembler saugrenue tant la théâtralité de ces pièces semble évidente. Et pourtant, elle n’a cessé d’agiter, au cours du XXe siècle, le petit monde des latinistes, où d’irréductibles contempteurs étaient persuadés qu’elles avaient été écrites pour de simples lectures publiques.
Florence Dupont n’a jamais été de ceux-là. Professeure émérite de littérature latine à l’université Paris-Diderot, elle a – comme Antonin Artaud qui décrivait Sénèque comme « le plus grand auteur tragique » – toujours été convaincue que le dramaturge avait bel et bien écrit pour le théâtre. « Les parties musicales, l’alternance du parler et du chanter, mais aussi la langue qui n’a rien à voir avec la langue quotidienne, sont les trois piliers d’une écriture qui visait à l’oralisation », assure-t-elle. Cette conviction chevillée au corps, elle s’est lancée, voilà trente ans, dans une retraduction « pour la scène » de neuf pièces de Sénèque – Phèdre, Thyeste, Les Troyennes, Agamemnon, Médée, Hercule furieux, Hercule sur l’Œta, Œdipe et Les Phéniciennes – qui, aujourd’hui encore, fait autorité auprès des metteurs en scène.
Sauf, qu’au départ, ce pari semblait loin d’être gagné. Florence Dupont s’est invitée chez le dramaturge romain telle une exploratrice en terres inconnues. Assistante de latin à la Sorbonne, la jeune normalienne, agrégée de lettres classiques, se voit confier, en 1969, « un cours dont personne ne veut », celui sur les tragédies de Sénèque « Un tel cours était quasiment infaisable car il n’existait peu ou pas de traduction, et aucune thèse sur le sujet, exceptée celle qui affirmait que ces textes n’avaient rien à voir avec du théâtre », se souvient-elle. Plutôt que de renoncer, la doctorante se lance dans une ambitieuse entreprise : traduire elle-même les tragédies de Sénèque, à commencer par Phèdre qu’elle confie aux étudiants de Paris-III dirigés par l’historienne du théâtre Anne Ubersfeld.
Monté à l’École normale supérieure, le spectacle permet à la traduction de se faire connaître, et même d’être « vendue au noir, histoire de rentrer dans nos frais », s’amuse Florence Dupont. Après sa thèse de troisième cycle « Le plaisir et la loi : du Banquet de Platon au Satiricon », la jeune femme décide de prendre le théâtre romain à bras-le-corps, alors que tout était à construire. « Il m’a fallu reconstituer les pratiques rituelles et sociales et embrasser un champ très vaste, du théâtre à la littérature, en passant par l’histoire », détaille-t-elle. En 1981, elle soutient une thèse d’État intitulée « La Fureur et la mémoire : recherches sur la mythologie dans les tragédies de Sénèque ».
Florence Dupont est alors sollicitée par Roger Blin qui, au crépuscule de sa vie, lui demande de traduire Thyeste, juste avant que Jean-Loup Rivière ne fasse de même. Dès la parution de la traduction, Farid Paya et Jean-Pierre Vincent s’en emparent, mais c’est Daisy Amias qui, la première, utilise les mots de Florence Dupont pour monter Phèdre au Théâtre Gérard-Philipe en 1990. « Tous ces metteurs en scène avaient une certaine audace et ne cherchaient pas à faire du pseudo-classique, assure l’universitaire. Si l’on imagine que Sénèque se monte comme Racine ou Corneille, on court à la catastrophe. Le théâtre romain est un théâtre d’avant la séparation entre le théâtre et l’opéra. Il ne faut pas donner un sens politique au texte, mais plutôt travailler sur l’esthétique de la langue. »
Aux jeunes metteurs en scène d’aujourd’hui, comme Louise Vignaud ou Thomas Jolly, Florence Dupont prodigue peu ou prou les mêmes conseils. « Pour préparer son Thyeste, j’ai d’abord vu Thomas Jolly en tête à tête, lui ai expliqué comment cela se passait à Rome et lui ai présenté les arcanes du théâtre romain, raconte-t-elle. J’ai ensuite martelé aux acteurs que les personnages de Sénèque n’étaient pas des sujets psychologiques, qu’ils étaient là pour se faire entendre, et non pour être incarnés. » Avant de poursuivre : « Chaque séquence doit donc avoir une certaine autonomie et chaque moment doit être travaillé pour lui-même, sinon le texte qui superpose les métaphores aux métaphores peut sembler grandiloquent. La poésie doit être là pour elle-même et pas par rapport aux sujets. »
Contrairement à la mise en scène de Louise Vignaud à qui elle reproche un parti-pris assez « traditionnel » et où elle déplore que le prologue du « chasseur chassé » n’ait pas été dansé et chanté – « ce qui empêche l’esthétique sexuelle et violente de se mettre en place », regrette-t-elle – Florence Dupont délivre un satisfecit au rendu final de Thomas Jolly. « Sa mise en scène est vraiment dans l’esprit du texte de Sénèque car elle n’a rien de littéraire ou de classique, mais penche clairement du côté contemporain. » Il n’en fallait pas moins pour faire éclater toute la modernité du « plus grand auteur tragique ».
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr


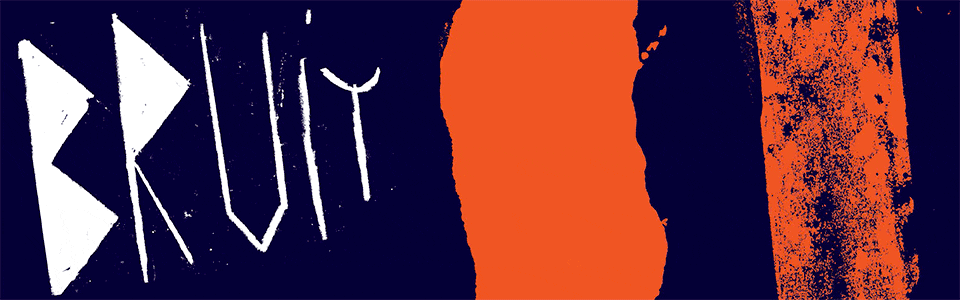







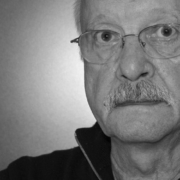


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !