Marie-Christine Orry étudie d’abord à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, avant de suivre des cours aux théâtres nationaux de Chaillot et de Strasbourg. Au début de sa carrière, elle croise la route de Jérôme Deschamps, et triomphe dans La Veillée au Festival d’Avignon. Dans les années 1990, elle entame un long compagnonnage avec Michel Raskine, puis joue sous la direction de Julie Deliquet, Galin Stoev, Jacques Nichet et Jean-Michel Ribes, qu’elle retrouve pour sa nouvelle création Un pas de côté… et l’autre aussi, au Théâtre de la Ville.
Avez-vous le trac lors des soirs de première ?
Au risque de décevoir, ou que l’on interprète mal ma réponse, en général, je n’ai pas vraiment le trac. Le jour de la première, oui, bien sûr, comme un rendez-vous qu’on attend, un moment qui a plus de goût que d’habitude, un parfum d’exception ; et puis, on se demande si le spectacle va plaire, si l’on va réussir. Et parfois, s’invitent comme des réminiscences de matin brumeux d’interro de maths au lycée, de vieux restes, mais il me semble que ce n’est pas ça, le trac.
J’ai travaillé avec des acteurs et des actrices qui ont vraiment le trac, et ça les envahit, parfois même de la première à la dernière, y compris après une centaine de représentations. Ça n’est pas mon cas. Par contre, c’est peut-être pendant les répétitions que je suis inquiète. Quand arrive la première, il faut que je me sente prête, confortable, rassurée sur ce qui a été mis en place. J’ai besoin d’être détendue en scène. Je pense même que le trac ne me réussit pas du tout, et que mon jeu en pâtit.
Comment passez-vous votre journée avant un soir de première ?
La plupart du temps, je termine mes cadeaux de première, ce petit rituel qui donne à la première un léger goût de soir de Noël. Sinon, je suis un peu comme un appareil électrique mis en veille : j’attends le soir, tranquille, je traine, je vaque.
Avez-vous des habitudes avant d’entrer en scène ? Des superstitions ?
Je n’aime pas tellement arriver au théâtre très en avance ou me concentrer pendant plusieurs heures. Je crois que j’aime entrer en scène dans la continuité de ma journée, avec la vie qui bouge, dans une sorte de fluidité. C’est peut-être une façon de préserver une certaine spontanéité. Cette absence apparente de véritables rituels ne veut pas dire pour autant que, pour moi, « monter » sur scène est un acte banal ou qui ne contiendrait pas une petite part de « sacré ». Je crois que jouer, c’est à la fois grave et pas grave, important et dérisoire, et c’est le mélange de ces oppositions qui m’est précieux.
Première fois où vous vous êtes dit « Je veux faire ce métier » ?
C’était à l’aumônerie de mon lycée, figurez-vous. On appelait ça une « journée de réflexion ». Par petits groupes, il fallait réaliser des saynètes sur des sujets qui préoccupaient abondamment les adolescents que nous étions, comme l’amour, la mort, l’inquiétude. C’est moi qui avais été choisie pour interpréter notre saynète devant les autres et j’avais été cueillie comme une pâquerette par ma propre émotion pendant que je jouais. Je ne suis pas sûre que ce soit à ce moment-là que j’ai décidé d’en faire mon métier, puisque je me suis d’abord dirigée vers la peinture en faisant les Beaux-Arts de Paris, mais ça a été une réelle découverte.
Premier bide ?
C’était un spectacle que j’aimais bien : Visages connus, sentiments mêlés de Botho Strauss à l’Idéal Cinéma de Tourcoing. J’y jouais une bourgeoise un peu corsetée. Arrivé à la moitié du spectacle, mon personnage se décoinçait un peu et se mettait à chanter devant son groupe d’amis. Elle chantait toute seule, comme ça, sans qu’on ne lui demande rien. Un vrai cheveu sur la soupe. J’avais choisi une chanson du groupe Il était une fois. J’y mettais tout mon petit coeur de bourgeoise fraichement émancipée. À la fin de la chanson, je disais à mon mari consterné (joué par Philippe Noël) : « Oh là là, ça fait tellement de bien, j’en chanterais bien une autre. » Ce à quoi il répondait un peu gêné : « Non, chérie, je crois que ce n’est pas la peine. » En général, cela faisait son petit effet. Un soir, tout se déroulait comme d’habitude, sauf qu’après ma réplique, une voix s’est élevée instantanément du public en criant très fort : « Ah non, non ! Maintenant, ça suffit ! » Et le spectateur est sorti. C’était si drôle.
Première ovation ?
J’imagine que c’est aux représentations du club théâtre de mon lycée auquel je participais, indissociable des moments de répétitions dans cette vieille salle de théâtre, après les cours, quand tous les élèves étaient partis. Le lycée désert, les couloirs qui résonnent, la nuit qui tombe vers 17h en hiver… Et puis, bien sûr, plus tard, mon tout premier spectacle dans le métier : La Veillée de Jérôme Deschamps. Rencontrer le public, être en rythme avec eux, les écouter, jouer avec eux, c’était vraiment joyeux.
Premier fou rire ?
Je peux être assez rieuse, et celui-ci n’est certainement pas le premier fou rire, mais, par contre, il a été long et collectif, et on a beaucoup lutté. J’ai joué plus de 360 fois L’Atelier de Jean-Claude Grumberg. Au bout d’un moment, la vigilance baisse, et nous avons eu plusieurs fous rires sur ce spectacle. Tout se déroule dans un atelier de couture à Paris, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une des couturières attend son mari de retour des camps et comprendra au cours de la pièce ce qui s’y est vraiment passé et que son époux ne reviendra pas. Au dernier tableau, son petit garçon arrive dans l’atelier pour prévenir que sa mère est à l’hôpital et qu’elle ne pourra pas venir travailler. L’ambiance est pesante, la scène émouvante. Et, un soir, le garçonnet qui faisait ce rôle avec un grand sérieux est entré fièrement en scène avec sa braguette totalement ouverte et le pan de sa chemise blanche qui sortait de son pantalon par ce passage inattendu. Nous étions sept ou huit acteurs en scène. Nous y sommes tous passés, en cascade.
Premières larmes en tant que spectatrice ?
Petite, il y a eu Bambi à la mort de sa mère – on a dû me sortir de la salle du Grand Rex. Plus tard, L’Incompris de Comencini, puis Elephant Man de David Lynch. Mais le cinéma n’est pas le théâtre. Au théâtre, ça a été La Classe morte de Tadeusz Kantor au Centre Pompidou. Un choc. J’étais inconsolable. Un chagrin si profond que j’ai cru que je ne réussirai jamais à sortir de la salle.
Première mise à nu ?
Au sens propre comme au figuré, car je finissais en petite culotte. Je jouais Estelle (l’infanticide) dans Huis clos mis en scène par Michel Raskine. Michel avait beaucoup articulé sa mise en scène autour de ce personnage qui commençait en jeune femme très sophistiquée et superficielle, avec costume, perruque et maquillage, et qui, finalement, se retrouvait en sous-vêtements, décoiffée, démaquillée, trempée, malmenée par les autres, désarmée, désemparée. Michel est la première personne qui m’a fait confiance pour un tel personnage avec toute une palette de jeu et de sentiments à interpréter. J’arrivais de chez Jérôme Deschamps. Comment a-t-il fait pour sentir que j’en étais capable ?
Première fois sur scène avec une idole ?
Quand j’étais aux Beaux-Arts et que je songeais à basculer vers le théâtre, j’ai pris un abonnement au Théâtre de Chaillot. C’était en 1981, la première saison d’Antoine Vitez. Je ne connaissais personne, j’ai coché les spectacles au hasard. J’ai eu la main heureuse puisque c’est comme ça que j’ai découvert En Avant de Jérôme Deschamps et un petit spectacle de Georges Aperghis dont j’ai oublié le titre. Les deux spectacles m’avaient totalement enthousiasmée. Je me suis dit : « Si le théâtre c’est ça, ok, j’y vais ! » Quatre ans plus tard, le premier spectacle auquel j’ai participé, c’était La Veillée, avec Jérôme Deschamps en scène avec nous ; et quelques années plus tard, j’ai aussi travaillé avec Georges Aperghis, un homme tellement merveilleux. Deux spectacles inoubliables.
Première interview ?
Il me semble que ma première radio, c’était au Pop Club avec José Arthur, mais celle qui m’a marquée, c’était dans l’émission « Rien à cirer » animée par Laurent Ruquier tous les jours, de 11h à 12h, sur France Inter. Il avait vu L’Atelier. Je n’avais pas le rôle principal et, en toute logique, il y avait d’autres acteurs à solliciter, mais il avait dit à l’attachée de presse : « Je la veux, elle ! » Ça m’avait beaucoup touchée.
Premier coup de cœur ?
J’ai trois ou quatre ans, je suis assise entre mes parents, il fait noir, et, sur scène, mes deux grands frères participent au spectacle de fin d’année du patronage de la paroisse de La Varenne Saint-Hilaire. Ils sont habillés en papier crépon rouge et chantent Au Feu Les Pompiers dans un camion en carton ondulé d’où dépassent leurs pieds. Et sur le côté de la salle, en haut d’une grande échelle métallique, quelqu’un fait tourner devant un projecteur un disque percé de ronds de gélatine de couleurs différentes qui envoie sur la scène des lumières rouge, jaune ou bleue. Mon coeur est encore là-bas.





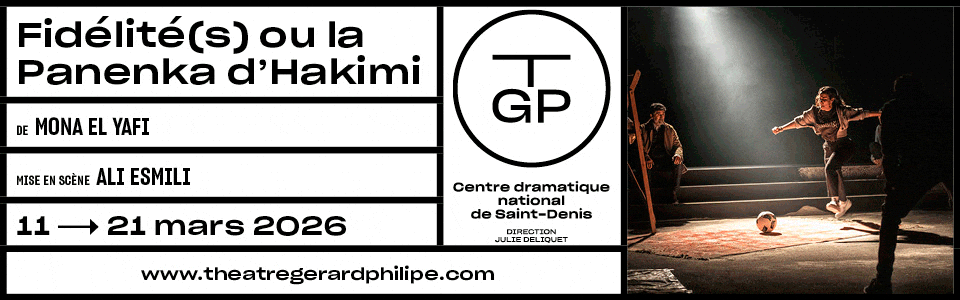








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !