Du 2 au 9 février, le Centre dramatique national d’Orléans (CDNO) organisait La Caverne, un festival dédié aux performances. Une première. Radicale, immersive, engagée sur le plan politique, cette forme de spectacle vivant pourrait tirer son épingle du jeu dans les années à venir, malgré les coupes budgétaires actuelles et l’arrivée possible de l’extrême droite au pouvoir.
L’expérience s’apparente à une sorte de trip. L’effet d’un puissant psychotrope, genre LSD. Après avoir rangé ses chaussures dans un casier, on pénètre dans une bibliothèque. Les murs y sont tapissés de milliers de livres. On pourrait être dans le salon d’un appartement d’intellectuels bourgeois. C’est coloré. C’est vivifiant. Le public, qui, comme nous, est invité à y prendre place, s’assoit sur la moquette. Certains s’y allongent. Le problème, c’est que les livres sont en train de fondre. Sur les étagères inférieures, les ouvrages se répandent au sol, formant des flaques polychromes. Sous l’effet des projecteurs, ils changent de couleur, se mélangent. Déboussolé, on fait comme les autres ; on s’assoit, on respire un bon coup. Quand les premiers mots retentissent dans les enceintes, on tend l’oreille.
Ce lieu étrange est baptisé L’Antre. Il a été conçu par la scénographe Nadia Lauro et se trouve au cœur du festival La Caverne proposé par Émilie Rousset, la directrice du Centre dramatique national d’Orléans (CDNO), qui fait la part belle aux performances, cette forme peu évidente à définir. Les noms d’Adèle Haenel, Marcus Lindeen, Vanasay Khamphommala, Patricia Allio, Valérie Mréjen et bien d’autres sont inscrits en haut de l’affiche. Autant d’artistes aux esthétiques bien différentes, mais dont le travail mis à l’honneur s’affranchit de la frontalité d’une représentation classique pour inventer un autre rapport avec le public. Plus direct, plus immersif, plus radical. « C’est l’occasion de sortir de la boîte noire, précisent d’une même voix Émilie Rousset et Madeleine Planeix-Crocker, chercheuse et co-conceptrice de l’événement. Mettant en jeu les corps, ces propositions occupent les espaces de production pour interroger leur fonction. »
Un engagement particulier
La preuve par trois à Orléans, ce vendredi 6 février. Avec son Wild Minds, Marcus Lindeen réunit des rêveurs compulsifs qui préfèrent vivre dans des mondes alternatifs inventés de toutes pièces. Une cinquantaine de spectatrices et spectateurs se retrouvent assis en cercle parmi une demi-douzaine d’acteurs. Comme chez les alcooliques anonymes, ces derniers prennent la parole chacun à leur tour pour faire part de leur expérience, notant les similitudes, soulignant les différences. Au-delà de son sujet à la lisière du réel, l’étrange façon qu’à Marcus Lindeen d’orchestrer la parole, grâce à ces oreillettes qui permettent aux acteurs de répéter un texte enregistré, provoque un état cotonneux dont les membres de cette assemblée éphémère sortent un peu groggy.
Mettre au monde est un documentaire audio réalisé par Émilie Rousset et Alexandre Plank, qui mêle la musique d’Elsa Michaud avec des paroles recueillies à l’hôpital Jean Verdier de Bondy, celles d’hommes et de femmes confrontés à la douleur de l’infertilité au sein d’une institution cabossée. Laquelle tient, malgré tout, grâce à l’abnégation de son personnel soignant ; un petit miracle. Diffusé dans l’étrange bibliothèque de Nadia Lauro, le résultat provoque une sorte de méditation collective et une qualité d’écoute autrement plus pénétrante que celle des podcasts habituels.
Enfin, Vanasay Khamphommala nous fait voyager jusqu’au Laos, avec ສຽງຂອງຍ່າ (La voix de ma grand-mère). À force d’incantations et de rituels, de danses et de chants, l’artiste part à la recherche de son aïeule dont il ne reste aucune trace (pas même une photo). Elle lève les tabous familiaux avec une douceur aussi envoutante que contagieuse, mettant en scène son père, un fringant octogénaire drapé dans un costume d’Elvis Presley.
Ainsi s’impose le constat a priori paradoxal de la performance. À l’heure des réductions budgétaires drastiques, mais aussi, peut-être, à la veille de l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir, elle semble appelée à jouer un rôle, non pas central, mais, disons, moins marginal que ces dernières années. Une question d’adaptabilité et donc de robustesse. « La forme n’est pas en danger, commente Émilie Rousset, dont Le Procès de Bobigny, avec ses 15 acteurs pour une jauge de 260 spectateurs, ce qu’elle qualifie « d’aberration économique », s’apparente à de la performance. Leur diffusion peut se dérouler sur le temps long. Grâce à leur sujet, elles profitent d’un engagement particulier de la part de certains programmateurs. »
Chape de plomb
Vanasay Khamphommala, quant à elle, a trouvé sa voie artistique lors de la pandémie de Covid. Elle proposait alors Je viens chanter chez toi nue en échange d’un repas, comme une façon de faire théâtre, mais aussi de lui attribuer une valeur marchande ; une sorte de troc en l’occurrence. Aujourd’hui, elle est tiraillée entre les bienfaits liés à la marginalité de la forme et le fait que celle-ci ne doit pas devenir une norme, car elle pourrait alors offrir un prétexte idéal aux pouvoirs publics pour se désengager du financement des créations. « Je ne veux pas faire l’apologie de la précarité, répète-t-elle en préambule de chaque argument. Mais, comme les performances sont rarement préachetées par les institutions, on se sent libéré de mille contraintes. On dit exactement ce que l’on a envie de dire, on ne répond que de soi-même. En retour, je constate que le public se sent aussi bien que moi dans cet espace de liberté. La performance a ceci de particulier qu’elle se joue sur des réseaux d’amitié, au sein de l’institution, avec les spectatrices et spectateurs, mais aussi avec les autres artistes que l’on rencontre pendant les festivals. »
À l’époque où l’autocensure et, qui sait, bientôt la censure pourraient tomber comme une chape de plomb sur le pays, la performance pourrait devenir une utopie underground. « Tout compte fait, conclut l’artiste d’origine laotienne, je pense que les performances sont au spectacle vivant ce que les mauvaises herbes sont à la nature : jamais elles ne peuvent être vraiment éradiquées. Elles auront toujours leur place, surtout si les institutions sont laissées en friche. » Dont acte.
Igor Hansen-Løve — www.sceneweb.fr
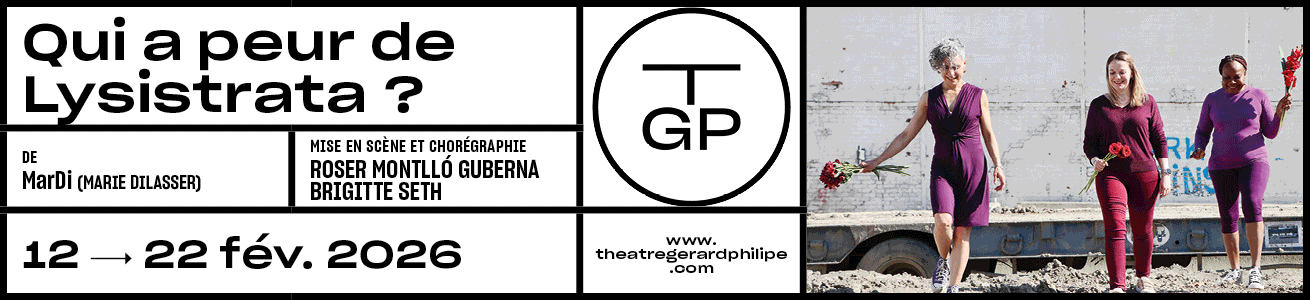
















Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !