Après Seuls et Soeurs, le dramaturge et metteur en scène livre, au Théâtre de la Colline, le troisième volet de son cycle Domestique, et plonge avec émotion et tendresse, à travers le portrait de sa mère Jacqueline, dans la fabrique d’un homme-artiste et de ses souvenirs.
« Je n’ai pas pleuré depuis la mort de ma mère ». Ce 18 décembre 1987, Wajdi Mouawad a tout juste 21 ans ; sa mère, Jacqueline, seulement 55. Par cette confession glissée dès le préambule qui ouvre, en douceur, sans même que l’on s’en aperçoive vraiment, les portes de sa nouvelle création, le dramaturge et metteur en scène en pose les termes : Mère sera une plongée au fond de l’intime, aux tréfonds de lui-même, au coeur, aussi, de la fabrique de ses souvenirs qui se trouvent, forcément, à mi-chemin entre la réalité et la fiction, dans l’une de ces zones grises dont l’esprit a le secret et que l’artiste se plaît à cultiver. Après Seuls et Soeurs, et avant la création de Père et Frères, ce troisième opus s’impose comme le volet le plus sensible, émouvant, et réussi, du cycle Domestique que Wajdi Mouawad édifie, pierre par pierre, depuis plus de dix ans.
Le souvenir de sa mère, l’artiste ne le reconstitue ni au Liban, où elle a passé l’essentiel de sa vie, ni à Montréal, où elle a rendu son dernier souffle, mais bien à Paris, dans cet appartement du XVe arrondissement, situé dans une impasse près du boulevard de Grenelle, entre les métros Dupleix et Bir-Hakeim, où elle s’était installée, avec ses trois enfants, Nayla, Naji et Wajdi, à la fin des années 1970 pour fuir la guerre qui ravageait sa terre natale. A ses yeux, l’endroit n’a rien d’un havre de paix désirable, mais ressemble à un abri temporaire qu’elle s’apprête, mois après mois, à quitter pour retrouver son pays et son mari, Abdo, resté à Beyrouth, sous la menace et les bombes, afin de continuer à travailler et à envoyer à sa famille l’argent dont elle a besoin pour (sur)vivre. Finalement, la fratrie y restera cinq ans, et Jacqueline ne reverra jamais le Liban.
Pour elle, l’existence sur cette « terre d’en face », où elle ne trouve pas sa place, a tout d’un supplice prométhéen, où la douleur lui rongerait, jour après jour, le cœur. Si elle a bel et bien quitté le Liban, le Liban, lui, ne l’a jamais quittée, tels un carcan mental, une obsession dont il serait impossible de se débarrasser. Ses journées et ses nuits, Jacqueline les vit rivée aux fourneaux et suspendue aux appels, tantôt de « tante » Renée, tantôt de « tante » Antoinette, et plus rarement, se désespère-t-elle, de son mari, qui doit composer avec l’interruption régulière des lignes téléphoniques. Morte d’angoisse, elle ne manque jamais le 20 heures d’Antenne 2, où Christine Ockrent lui livre les dernières nouvelles, souvent anxiogènes, en provenance de son pays. A tel point que la présentatrice – qui incarne son propre rôle sur scène – est devenue le cinquième membre de la famille, celle à qui l’on répond « Et bah bonsoir ! » quand elle débarque dans le poste et qui s’invite à la table du dîner, pour peu que le Liban soit à la Une de l’actualité.
Haute en couleur autant que montée sur ressorts, Jacqueline n’en reste pas moins une mère autoritaire, voire tyrannique, avec ses enfants, Nayla et Wajdi, qu’elle élève à la dure, comme si la douleur terrassait tout sur son passage, y compris une partie de l’amour maternel. Entre deux claques, elle n’hésite jamais à les mettre à contribution, là pour passer l’aspirateur, là pour l’aider en cuisine, là encore pour sortir la poubelle. C’est que, à son grand dam, elle les voit aussi s’émanciper et, progressivement, lui échapper. Car si la France ne peut, dans cet appartement, que se glisser par le trou de la serrure, grâce à Dallas, Goldorak ou aux émissions de Guy Lux, et surtout à ces tubes de l’époque – parfois plus ou moins habilement réécrits et réinterprétés par Bertrand Cantat, dont la contribution artistique à ce spectacle a suscité une polémique – que, de Salvatore Adamo à Pierre Bachelet, de Julio Iglesias à Serge Gainsbourg, la radio est souvent, mais pas toujours, autorisée à crachoter, elle fait, peu à peu, son office sur les plus jeunes. A Nayla, elle donne un autre modèle de femmes, moins asservies et soumises aux désirs de leurs maris que les Libanaises de l’époque ; à Wajdi, le goût pour l’Histoire, la langue et la culture françaises qu’il maîtrise de mieux en mieux au fil des années, et dont il fera, à l’avenir, son miel.
Ce portrait de famille, l’artiste ne cherche pas à l’inscrire dans une dimension strictement réaliste. Par sa présence quasi-permanente sur scène pour, en bougeant régulièrement quelques meubles, façonner cet espace mental, il l’impose comme une construction, comme le résultat, pétri de fiction, des souvenirs, forcément déformés par le temps, qu’un homme de 53 ans peut avoir d’un fragment de vie vu à travers les yeux d’un enfant de 10 ans. Fondamentalement teinté de nostalgie, le regard, malgré le contexte très lourd, est tendre et l’ambiance paradoxalement lumineuse. Ode à la mère, hymne à la vie, la pièce de Wajdi Mouawad est aussi une déclaration d’amour à la langue libanaise, en dépit de son caractère plus trivial que poétique. En choisissant de traduire littéralement certaines expressions idiomatiques – tel « mon chéri » qui devient « ô toi qui j’espère m’enterrera » –, le dramaturge dit tout de sa propension emphatique, de sa puissance symbolique, mais aussi de l’omniprésence de la mort et de l’humour, savamment mêlés, comme si le second pouvait se jouer de la première. Cette langue, imagée en diable, Odette Makhlouf et Aïda Sabra s’en emparent avec la finesse d’esprit, et la malice, des natifs. Dans un espace scénographique, conçu par Emmanuel Clolus, qui reprend les codes vidéos et scéniques de Seuls et Soeurs, elles s’imposent, au côté du jeune Emmanuel Abboud – en alternance avec Théo Akiki, Dany Aridi et Augustin Maîtrehenry – tout en belle retenue, comme les patronnes de la scène, capables, la première en jeune femme effrontée, la seconde en mère déchirante et déchirée, d’incarner, à la fois, le désespoir et l’élan vital d’un peuple tout entier pour qui la guerre et le malheur sont, encore aujourd’hui, consubstantiels de l’existence.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Mère
Texte et mise en scène Wajdi Mouawad
Avec Odette Makhlouf, Wajdi Mouawad, Christine Ockrent, Aïda Sabra et, en alternance, Emmanuel Abboud, Théo Akiki, Dany Aridi, Augustin Maîtrehenry, et les voix de Valérie Nègre, Philippe Rochot et Yuriy Zavalnyouk
Assistanat à la mise en scène Valérie Nègre
Dramaturgie Charlotte Farcet
Scénographie Emmanuel Clolus
Lumières Éric Champoux
Costumes Emmanuelle Thomas
Coiffures Cécile Kretschmar
Son Michel Maurer et Bernard Vallèry
Musiques Bertrand Cantat en collaboration avec Bernard Vallèry
Accessoires Carolina Sapiain Quiroz
Coach Cyril AnrepProduction La Colline – théâtre national
Durée : 2h10
Théâtre de La Colline, Paris
du 10 mai au 4 juin 2023





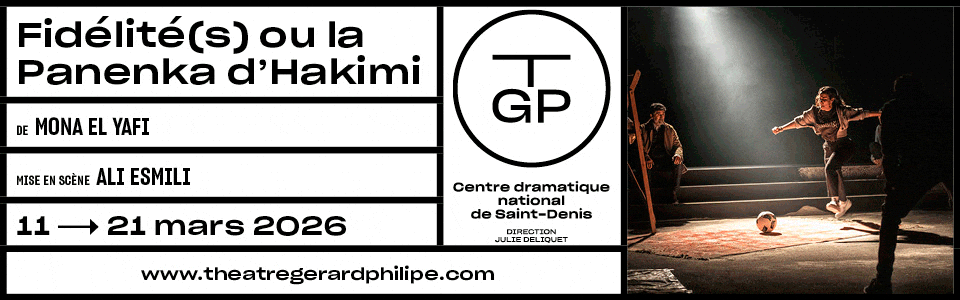







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !