
Photo Christophe Raynaud de Lage
Avec la complicité du dramaturge Guillaume Poix, la jeune metteuse en scène se juche sur les épaules d’Antonioni et livre, au Théâtre du Vieux-Colombier de la Comédie-Française, une expérience théâtrale radicale et captivante où, face à l’indicible, les gestes et les corps prennent le relais des mots.
Est-elle encore une femme ou juste un corps absent à lui-même, une pure enveloppe charnelle qui, telle une pietà, porterait le poids colossal de son malheur sur ses épaules et sur son visage ? Sur le plateau du Vieux-Colombier, au centre d’un dispositif bifrontal qui permet de mieux les observer, les traits de cette femme-là sont tirés, son expression défaite, ses yeux noyés dans le vague. Accompagnée par un triste sire à la présence fantomatique et au regard empli de détresse, elle apparaît défigurée par la souffrance, précipitée dans un puits sans fond où elle n’aurait pas d’autre choix que de continuer à sombrer. À intervalles réguliers, ses jambes paraissent faiblir, incapables de soutenir un coeur et une tête devenus trop lourds. Tout juste a-t-elle assez de force pour faire rebondir une balle de tennis sur le sol et l’envoyer à ce chien qui la sollicite. Un chien petit, curieux, nerveux, dont émane un puissant sentiment de vitalité qui tranche avec l’accablement, un brin rageur, de sa maîtresse.
Dans cet intérieur bourgeois au ton vert olive digne des années 1970, à ce point figé dans sa monochromie qu’elle en devient suspecte, cette femme ne tarde pas à être rejointe par celui qu’on devine être son mari, les bras chargés de courses. Ces deux-là semblent avoir perdu cet attribut, le langage, qui fait d’eux des humains ; et, entre eux, le silence règne en maître. De leurs bouches, comme de celles de cette femme et de cet homme qui bientôt les retrouvent, n’émane aucun indice. Il faut alors mettre sa casquette d’enquêteur pour assembler les pièces du puzzle et identifier le pourquoi du comment de cette situation hors des normes théâtrales. Sur un miroir, est collé un post-it avec le mot « Maman », écrit dans un style calligraphique en bâton typiquement enfantin et accompagné, juste en-dessous, d’un coeur ; au sol, périssent des cartons avec les inscriptions « Vêtements », « Jeux », « Déguisements », de ceux que l’on cherche non pas à vider mais à remplir, et à fermer pour de bon ; et au-dessus, sur un écran, défilent des images en noir et blanc, des souvenirs, des flashs, des scories du passé. Une robe sur une plage de galets, un poste de maître-nageur sauveteur, une mer plus terrifiante qu’apaisante… et le puzzle, enfin, se reconstitue. Ces deux-là ont dû perdre leur petite fille, victime d’une noyade, et sont à leur tour plongés dans l’abîme, dont la soeur du mari et l’un de leurs amis sont venus pour les sortir.
Entre eux, se noue alors une façon bouleversante d’entretenir les rapports humains. Tandis que les uns n’ont pas de mots pour exprimer leur douleur et que les autres doivent les trouver bien futiles pour nourrir leur entreprise de consolation, toutes et tous empruntent d’autres voies pour cultiver leurs liens, s’épauler et se soutenir. Ils s’en remettent alors aux gestes, aux attitudes, aux regards, mais aussi au silence, ou plutôt aux silences, tant ils apparaissent de différentes natures : tantôt respectueux, tantôt gênés ; tantôt synonymes d’incapacité, tantôt vecteurs de complicité. À chaque fois, et l’expression n’est ici pas galvaudée, ils en disent plus longs que les mots et servent de tremplins pour faire naître ces fragments de vie et de désir qui semblaient avoir à tout jamais disparu. Car, au milieu de sons sporadiques – émanant d’un poste de radio, d’une leçon d’italien, d’une platine vinyle ou de voisins un peu trop bruyants –, devenus parasites, voire insupportables, jaillissent un sourire, un regard tendre, une tenue plus attrayante qu’une autre, des injonctions à l’amour ou à faire l’amour qui, chacun à leur endroit, brillent de leur préciosité et, assemblés, annoncent qu’elle, au moins, n’a pas tout à fait renoncé.
Au long de ses dernières créations – citons, notamment, La Vie invisible et Un Sacre –, Lorraine de Sagazan a prouvé qu’elle était capable de transformer le plateau de théâtre en laboratoire, avec l’humain pour clef de voûte et objet d’étude. Avec la complicité de son fidèle dramaturge Guillaume Poix, la metteuse en scène s’est, cette fois, inspirée de l’oeuvre de Michelangelo Antonioni et de la façon dont, à travers ses films et ses écrits, le cinéaste italien cultive l’art des silences pour traduire, pêle-mêle, l’évanescence des sentiments, la menace de la disparition et la pluralité des points de vue. Face à ce Silence-là, on pense spontanément à L’Avventura et à son enquête autour de la volatilisation d’Anna, à La Nuit et à sa façon de sonder l’âme d’un couple a priori sans avenir, mais aussi à Blow-Up où la disparition est affaire de perception. Et Guillaume Poix de nous révéler, a posteriori, à partir de sa note d’intention, qu’il trouve aussi un écho dans un synopsis jamais tourné où « Antonioni détaille, en quelques lignes, l’idée d’un film qui raconterait l’histoire de « deux époux qui n’ont plus rien à se dire » ».
Ce substrat, les deux artistes l’ont radicalisé pour donner naissance à une expérience – et il faut l’accepter comme telle – qui s’avère brillante dans sa façon de fracturer le temple de la parole qu’est habituellement le théâtre. Un temple où, traditionnellement et par convention, les mots fusent pour dire, expliquer, asséner, proférer, mais aussi mentir. Or, dans Le Silence, il ne reste que la vérité des corps. Des corps en souffrance, témoins d’âmes en perdition, mais aussi de pulsions de vie, et de désir, qui, malgré tout, peuvent venir les animer. Par ce processus, sublime, Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix parviennent à atteindre une certaine essence de la douleur que la parole tente parfois de maquiller, et échoue souvent à traduire. Comme si les attitudes, les gestes, les regards, qu’ils nous obligent à épier et à scruter pour mieux les décoder, étaient, eux, incapables de mentir.
Fondée sur un texte qui a subtilement disparu au fil des répétitions, cette partition scénique qui, contre toute attente, échappe à un trop-plein de pathos, ne scintille que grâce au talent des comédiens-français. Nourris par des monologues intérieurs écrits par Guillaume Poix, mais aussi par des didascalies, des poèmes, des photos, des aphorismes, qui habitent aussi le travail vidéo particulièrement léché de Jérémie Bernaert, toutes et tous, à commencer par Marina Hands, sont habités par des esprits qui les hantent autant qu’ils les animent, et gorgés de ces ombres multiples qui possèdent leurs corps. À leurs silences de façade qui masquent mal le bouillonnement de leurs discours intimes, répondent alors nos voix intérieures. Sans que l’on s’en aperçoive vraiment, elles viennent, presque par réflexe, combler ce manque de mots, et font remonter à la surface ce lot de silences qui, dans nos vies, étaient trop pesants pour ne pas être brisés ou trop lourds de sens pour ne pas être écoutés.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Le Silence
de Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan
d’après l’œuvre d’Antonioni
Mise en scène Lorraine de Sagazan
Avec Julie Sicard, Stéphane Varupenne, Marina Hands, Noam Morgensztern, Baptiste Chabauty, le chien Miki et la voix de Nicole Garcia
Scénographie Anouk Maugein
Costumes Suzanne Devaux
Lumières Claire Gondrexon
Vidéo Jérémie Bernaert
Musique originale et son Lucas Lelièvre
Collaboration artistique Romain Cottard
Assistanat à la mise en scène Mathilde Waeber de l’académie de la Comédie-Française
Assistanat au son Ania Zante de l’académie de la Comédie-FrançaiseDurée : 1h20
Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier, Paris
du 31 janvier au 10 mars 2024




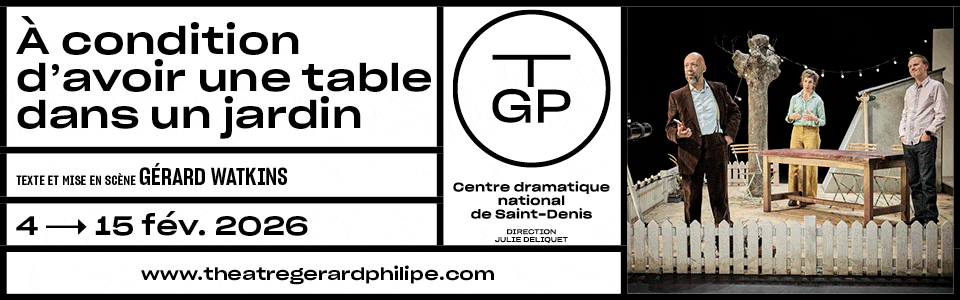








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !