Je vis dans une maison qui n’existe pas confirme la portée déflagratoire de l’écriture de l’autrice autant que sa présence scénique saisissante. Une soirée sous haute intensité émotionnelle.
Présenté en 2023 dans le cadre du festival ZOOM, Je vis dans une maison qui n’existe pas de Laurène Marx est de retour à Théâtre Ouvert: une écriture au scalpel d’une puissance évocatrice phénoménale, qui nous attrape par le col pour ne plus nous lâcher et allie dans le même élan violence inouïe et douceur infinie, inverse le regard, pose les vraies questions et puise dans les zones impénétrables de la souffrance pour en extirper lumière et lucidité. C’est peu de dire que la brûlure est au cœur du geste artistique de Laurène Marx. Son écriture consume le réel, le réduit en cendres pour mieux l’autoriser à renaître autrement, au-delà des injonctions et jugements, au-delà de cette norme qui étouffe tout sur son passage, à commencer par nos singularités magnifiques. Laurène Marx écrit comme on s’adresse, dans le face à face de la scène qui est l’horizon de son flux, elle souffle sur les braises pour nous réchauffer et elle avec. C’est peu de dire qu’elle brûle les planches, sa présence est démentielle, elle aspire tout. Elle nous avait renversé avec “Pour un temps sois peu”, monologue d’une puissance brute dans lequel elle questionnait sa propre transition, l’identité (sexuelle et de genre), le féminin, dans une parole honnête et crue, aussi nue que sincère et dépouillée de l’envie de plaire. On craignait la déception après cette première déflagration qui nous avait laissé sans voix mais pleine de la joie de cette naissance scénique cataclysmique.
“Je vis dans une maison qui n’existe pas” est une bourrasque qui confirme son talent flagrant et l’importance capitale de cette parole. Laurène Marx a cette capacité confondante à remplir le silence de sa présence, à incarner sa propre écriture dans une évidence bouleversante, à habiter l’espace du plateau de son corps et de ses mots, à mettre à terre d’un regard ce 4ème mur qui crée l’illusion pour mieux nous embarquer avec elle, séance tenante, dans son cerveau. La suivre n’est pas sans conséquence, la comprendre, c’est accepter d’aller trébucher au fin fond de l’expérience humaine, de se livrer, sans défense, à une palette d’émotions exacerbées qui nous laissent exsangues. Mais comme délivrés. Dépouillés de ce qui n’a pas d’importance.
Comment dire cette expérience ? Au début il y a ce plateau nu, la boite noire du théâtre, promesse palpitante. Au début, il y a Laurène, assise au plus près de nous sur le bord de la scène nous rappelant qu’elle aime jouer avec les gouffres et ne pas dresser de frontière entre elle et nous. Au début, il y a ce temps indicible où elle ne dit rien et le public, une fois n’est pas coutume, se tait. On ne sait pas si ça commence, ça a commencé, ça va commencer. Nous sommes en présence les uns des autres et ce silence fait la gravité et la beauté de ce temps suspendu. Puis les mots de la musique. Puis la musique des mots. Laurène Marx prend la parole comme on prend d’assaut les faux semblants, les discours simplistes et plaqués, les opinions étriquées. Elle ouvre la bouche qu’elle a maquillée de rouge sang et l’on s’engouffre dans son débit bien à elle, cette façon d’enquiller les mots ou de les retenir, de les laisser tomber comme des gouttes d’eau en fin de phrases.
Dans ce nouveau texte, après s’être racontée au présent, dans la conséquence d’un parcours identitaire douloureux, elle aborde aux rives de l’enfance, des troubles psychiques, de la colère qui vient de loin et envahit tout. Jamais psychologique, elle tisse les fils d’un récit qui brouille les pistes pour mieux nous mener sur le chemin d’elle-même. Passer par la dérive poétique et narrative pour dire le vif du sujet. On y suit Nikki, son double, lestée de Madame Monstre, Nuage le nuage et les Touts Petits dans une ronde schizophrène de figures qui ne sont au fond que les différentes facettes d’une seule et même personne. “Etre qui on est ça peut tout le temps changer” dit-elle dans un souffle et on attrape ses phrases au vol avec l’envie impossible de toutes les retenir, les garder au creux de soi pour les soirées difficiles. Ce qui est sidérant dans ce que propose Laurène Marx au plateau, c’est la manière de porter son “je” face au monde et sa façon d’inviter le public à être là et à en faire autant. “Approche toi”, “écoute moi”, “Attends”… La grande salle de Théâtre Ouvert devient un paquebot gigantesque où nos psychés, nos souvenirs, nos vécus, nos visages même s’entrechoquent dans l’invisible, s’incorporent à la fiction-vérité qui déroule ses intensités émotionnelles démentielles. Le plateau est peuplé, habité de cette aura rare que la composition sonore et musicale ample et sombre de Nils Rougé vient doper à bon escient. Et quand Laurène danse pour achever cette introspection qui tait son nom, cette mutation de la mémoire en fiction, car “écrire une histoire c’est décider de ne rien oublier”, sa danse a la puissance de ses mots. On sort de ce spectacle littéralement essoré, épuisé d’émotion mais fringant d’une ardeur neuve à embrasser la vie.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
Je vis dans une maison qui n’existe pas
Texte et mise en scène : Laurène Marx
Assistanat à la mise en scène : Jessica GuilloudCollaboration artistique : Fanny Sintès
Jeu : Laurène Marx
Création sonore : Nils RougéCréation Lumière : Kelig Le Bars
Régie lumières Gabrielle Marillier
Durée : 1h30
Du 11 au 16 avril 2024
A Théâtre Ouvert





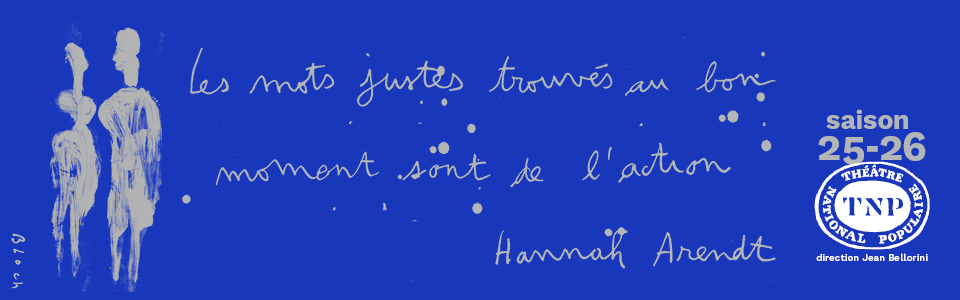








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !