En tandem avec Mammar Benranou, le directeur du T2G, Daniel Jeanneteau, confie la deuxième pièce de l’auteur norvégien, Et jamais nous ne serons séparés, à Solène Arbel, Yann Boudaud et Dominique Reymond, et sublime, en brouillant les frontières du réel, la douleur de l’attente.
« Non ». C’est par ce mot simple, prononcé à la suite d’un rire quasi sardonique qui aura fendu l’obscurité, que s’ouvre Et jamais nous ne serons séparés. Ce « Non », cette femme qui tourne en rond dans son salon semble l’adresser à la réalité, comme pour refuser l’évidence qui s’impose à elle. Au long du soliloque dans lequel elle ne tarde pas à se lancer, on comprend bien vite qu’elle attend l’homme qu’elle aime et qu’elle mène avec ce temps suspendu, et ses conséquences intimes, un combat à mains nues. À propos de lui, Jon Fosse ne dévoile rien. Tout juste apprend-on à intervalles réguliers de la bouche de cette femme qu’il aurait « disparu comme dans la mort ». Chez l’auteur norvégien, auréolé du prix Nobel de littérature en 2023, chaque mot, dont il est particulièrement économe, a son importance, et le « comme » présent ici n’échappe pas à la règle : si la disparition de cet homme ressemble à la mort, elle n’en a peut-être que l’aspect ; si son décès est une hypothèse plausible, la rupture ou l’amour inassouvi le sont tout autant. Sur ce point, Jon Fosse veille, comme il en a l’habitude, à conserver le mystère plein et entier. Car, moins que la source du deuil, causé par la fin d’une vie ou d’un amour, c’est bien le deuil lui-même, et l’attente qu’il crée, qu’il entend explorer à travers la trajectoire mentale de cette femme seule au milieu de son salon et de ses objets chéris, qui font office d’uniques repères, de points de stabilité, face à un réel qui se dérobe.
Soumise à une forme d’instabilité émotionnelle, elle ne paraît plus sûre de rien, à commencer par elle-même. D’un instant à l’autre, d’une phrase à l’autre, elle glisse d’état de conscience en état de conscience, dans une alternance permanente qui fait toute la magnificence de ce texte. Tantôt on l’entend se résoudre à sa solitude, voire s’en gargariser, comme si elle voulait s’auto-persuader que l’homme ne comptait plus ; tantôt on la voit espérer sa venue, attendre que le téléphone sonne et nier toute disparition, comme si la phase de déni, incontournable dans une période de deuil, n’était pas encore finie. Quand soudain, alors qu’elle est assise sur la banquette qui lui sert de sofa, son visage s’illumine. Elle le voit, enfin, sous la forme d’une hallucination ou d’un fantôme indiscernable à nos yeux de spectateurs lambdas, avant de reprendre ses esprits et le cours tumultueux de son incertitude. Tandis que tout semble pour elle perdu, une porte s’ouvre, et l’homme surgit. Cheveux mouillés, peignoir sur le dos, il paraît sortir de la douche, et entame avec celle qui lui fait face une discussion minimaliste et quotidienne, en appuyant simplement sur le fait qu’il se sent « fatigué ». D’abord transie de joie, la femme opère au bout de quelques échanges un étonnant renversement. À l’observer se replier sur elle-même et se rembarquer dans son soliloque, on comprend qu’elle ne le voit plus. En un tour de main, Jon Fosse brouille alors les frontières du réel et de sa perception, et oblige le public à interroger la véracité non plus seulement de ce qu’il entend, mais aussi de ce qu’il voit.
Cette pièce, la deuxième du dramaturge norvégien, sans doute moins radicalement épurée que celles qui suivront, Daniel Jeanneteau l’aborde avec la justesse de ceux qui en ont vu pour avoir participé, en tant que scénographe, à la création de Quelqu’un va venir, mise en scène par Claude Régy en 1999. En tandem avec Mammar Benranou, avec qui il avait déjà co-dirigé La Cerisaie, le directeur du Théâtre de Gennevilliers cultive, sans jamais en faire trop, l’étrangeté de la composition de Jon Fosse, et attise son pouvoir de fascination et d’attraction, parfois vénéneux. Au lieu de l’obscurcir, comme d’aucuns s’y sont risqués par le passé, les deux artistes éclairent, y compris formellement, la pièce, en évitant soigneusement toute lumière crue qui viendrait dissiper son captivant mystère. Dans un espace scénographique à l’épure ultra-contemporaine, où trois cadres photos emplis de noir symbolisent l’irréalité et l’universalité autant que la perte, les temporalités, qui ne tardent pas à se télescoper lorsque l’homme réapparaît en compagnie d’une jeune fille, sont subtilement signifiées par la création lumières toute en délicatesse de Juliette Besançon, et contribuent à offrir au texte une épaisseur, une profondeur et, pourrait-on presque oser, une clarté, qui le fait au moins partiellement échapper au strict et éternel retour du même. Sous la houlette des deux co-metteurs en scène, ce sont bien toute l’humanité et la pertinence du regard de Jon Fosse sur le fonctionnement intime des êtres, et leurs turbulences intérieures, qui éclatent au grand jour, et s’en trouvent sublimées.
D’autant que, pour porter cette pièce à l’économie exigeante, Daniel Jeanneteau et Mammar Benranou ont composé une distribution quatre étoiles et fait appel à trois de leurs comédiens parmi les plus fidèles : Solène Arbel, Yann Boudaud et Dominique Reymond. Et c’est à cette dernière, qui se taille la part du lion textuelle, que l’on doit la performance la plus magnétique et saisissante. Sous la direction précise de ses deux co-metteurs en scène, la comédienne use de tout son talent pour épouser les variations de la femme qu’elle incarne, jusqu’à la rendre complètement insaisissable, tant elle se pare, tour à tour, de mille visages. Grâce à des expressions faciales particulièrement travaillées, elle exprime avec autant d’intensité la colère que la joie, le désarroi que le renoncement, et ose même tendre, avec ce je ne sais quoi un rien sarcastique qui peut provoquer quelques sourires, vers une forme de folie plus ou moins douce. Loin d’être forcé, ou de constituer une clef de lecture un peu trop simpliste, ce désordre mental apparaît comme une conséquence naturelle de la douleur de l’attente et la résultante du duel perpétuel qui se joue entre raison et émotion. À ses côtés, Solène Arbel et Yann Boudaud, qui, en comédien fétiche de Claude Régy, connaît parfaitement Jon Fosse, campent respectivement un homme et une jeune femme en nuances de gris, suffisamment incarnés pour ne pas être éthérés et suffisamment mystérieux pour ne pas être totalement réels. Ensemble, et dans les pas de l’auteur norvégien, ils font alors de leur performance le creuset de la douleur de toutes nos attentes, d’où qu’elles viennent, et nous permettent, en observant cette commune humanité, de mieux la vivre et l’accepter.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Et jamais nous ne serons séparés
Texte Jon Fosse
Traduction Terje Sinding
Mise en scène et scénographie Daniel Jeanneteau, Mammar Benranou
Avec Solène Arbel, Yann Boudaud, Dominique Reymond
Création lumières Juliette Besançon
Musique Olivier Pasquet
Costumes Olga Karpinsky
Construction décor Théo Jouffroy – Ateliers du Théâtre de Gennevilliers
Assistanat à la mise en scène stagiaire Juliette CarnatProduction T2G Théâtre de Gennevilliers, Centre Dramatique National
Coproduction La Comédie, Centre Dramatique National de Reims ; Le Méta Centre Dramatique National Poitiers Nouvelle-Aquitaine ; Bonlieu, Scène Nationale d’Annecy ; La Comédie de Genève ; Ircam – Centre Pompidou ; Théâtre du Beauvaisis – Scène NationaleLa pièce Et jamais nous ne serons séparés de Jon Fosse (traduction de Terje Sinding) est publiée et représentée par L’ARCHE – éditeur & agence théâtrale.
Durée : 1h30
T2G Théâtre de Gennevilliers
du 19 septembre au 13 octobre 2025Le Quai CDN, Angers
les 18 et 19 novembreLa Comédie de Valence, CDN Drôme-Ardèche
les 16 et 17 décembreBonlieu Scène Nationale, Annecy
du 11 au 13 mars 2026Le Méta, CDN Poitiers Nouvelle-Aquitaine
les 18 et 19 marsThéâtre des 13 vents, CDN Montpellier
du 8 au 10 avrilComédie de Reims, CDN
du 28 au 30 mars


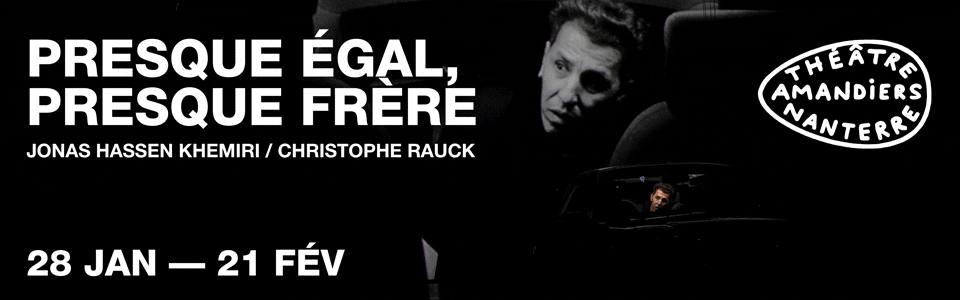











Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !