À La Colline, André Marcon sublime le monologue de Yasmina Reza, où une ancienne comédienne invoque les spectres de sa vie, nimbée, à la ville comme à la scène, de l’aura dorée de la nostalgie.
Sous le feu des projecteurs du Théâtre de la Colline, ne reste qu’une modeste paire de talons, seule, délaissée, tel le témoin d’une époque révolue, vieil accessoire d’une actrice qui désormais ne les enfilera plus. En retrait par rapport à cet halo lumineux, tapie dans cette ombre dont elle n’est jamais franchement sortie, se tient Anne-Marie Mille. Alanguie sur une méridienne digne d’une antichambre racinienne, elle préfère aujourd’hui le confort d’une bonne paire de pantoufles. « Des Furlana. Des Furlana vénitiennes », tient-elle à préciser, comme si l’aisance n’empêchait pas le style. C’est que, même si le crépuscule approche, cette ancienne comédienne n’est pas encore tout à fait prête à lâcher la rampe, contrairement à son amie Giselle Fayolle qui, on le comprendra bien vite, vient de mourir. Un drame intime qui plonge Anne-Marie dans un élan introspectif. « La mort de Giselle voyez-vous c’est comme si j’avais défait une dernière fois ma valise », confie-t-elle, consciente, qu’à l’heure du grand saut, il est temps de faire les comptes.
Alors, Anne-Marie se souvient, comme on orchestrait un bal spectral, au rythme de La Chaconne de Bach – retranscrit pour main gauche par Brahms. De Saint-Sourd en Ger à la rue des Rondeaux, en passant par le Théâtre de Clichy où, pour la première fois elle a croisé la route de Giselle, la comédienne invoque les fantômes de son existence, de sa vie de théâtre et de sa vie tout court. Au long d’un monologue qui, tel un flux de conscience, passe du coq à l’âne, du présent au passé, de l’art au trivial, elle dessine le portrait d’une femme abonnée aux seconds rôles, à la scène comme à la ville avec « son gentil mari sans histoires » et son fils « inquiet », et sans « aucune conversation intéressante ». Dans Ondine comme dans Bérénice, dans Les Caprices de Marianne comme dans les tragédies antiques, elle n’a jamais réussi à obtenir son nom en haut de l’affiche. De cette lutte avec son propre plafond de verre, Anne-Marie ne garde ni amertume, ni rancoeur, tout juste une pointe d’admiration dans la voix lorsqu’elle évoque les noms de Raymond Lice et de Poupi Canella, de Mirelle Camp et de Giselle Fayolle. De toute façon, assène-t-elle : « Sur scène on ne laisse rien derrière soi. La scène se fout de qui l’occupe. Giselle, Giselle Fayolle, Anne-Marie… Aucune trace de personne. Ni odeur, ni ombre. »
Et c’est là, et bien là, que la pièce de Yasmina Reza parvient à toucher au coeur, dans sa façon d’entrer pas à pas dans cette mécanique de l’esprit qui ne conserve que les beaux souvenirs, voire les enjolive en les nimbant de l’aura dorée propre à la nostalgie. Composée de récit de vie et d’anecdotes du quotidien, de recul analytique et de coups d’oeil rétrospectifs, cette ultime confession, offerte à un interlocuteur aussi imaginaire que changeant – tantôt « Mademoiselle », tantôt « Monsieur » –, témoigne, à la fois, d’une infinie tendresse et d’un regard sans concession sur la lente dérive que constitue la vieillesse, où les souvenirs peinent à faire rayonner un quotidien devenu terne et à combler une solitude aussi profonde qu’inéluctable. Pour autant, et c’est là son autre force, Yasmina Reza fait de l’expérience d’une vie le creuset de ces fulgurances poétiques propres aux grands sages qui, entre une virée chez Monoprix et une arnaque orchestrée par des faux agents d’EDF, sont capables de saillies mordantes, d’envolées émouvantes et de constats qui ont la puissance de l’universel, sans tomber dans le commun.
Autant de relais de puissance textuelle qu’André Marcon parvient, avec l’aisance qu’on lui connait, à magnifier. En jupe et chemisier, boucles aux oreilles, le comédien endosse le rôle d’Anne-Marie dans toute sa modestie et sa complexité. Sans jamais chercher, et c’est heureux, à singer une femme, il donne à voir autant sa force que ses fêlures, et offre à ce personnage infiniment touchant une grâce propre à ceux qui, malgré tout, et notamment les apparences, ont compté. Dans le magnifique écrin scénographique imaginé par Emmanuel Clolus, façonné par les lumières de Dominique Bruguière et sporadiquement hanté par les peintures de Örjan Wilkström, qui, telles des silhouettes indistinctes, collent à la peau et à l’esprit d’Anne-Marie, il fait montre d’une sensibilité et d’une mélancolie qui entraînent dans cette zone grise où, entre chien et loup, les frontières entre rires et pleurs se brouillent. Jusqu’à permettre à cette femme de rejoindre ce groupe d’étoiles filantes qu’elle révère et de laisser, elle aussi, une trace dans le ciel.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Anne-Marie la Beauté
Texte et mise en scène Yasmina Reza
Avec André Marcon
Assistanat à la mise en scène Oriane Fischer
Scénographie Emmanuel Clolus, avec le peintre Örjan Wikström
Lumières Dominique Bruguière assistée de Pierre Gaillardot
Costumes Marie La Rocca
Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar
Musique Laurent Durupt d’après Bach et Brahms, transcription pour main gauche de La Chaconne en ré mineurProduction La Colline – théâtre national
Le texte de la pièce Anne-Marie la Beauté de Yasmina Reza est paru en janvier 2020 aux éditions Flammarion.
Durée : 1h15
Théâtre de La Colline, Paris
du 30 novembre au 23 décembre 2021


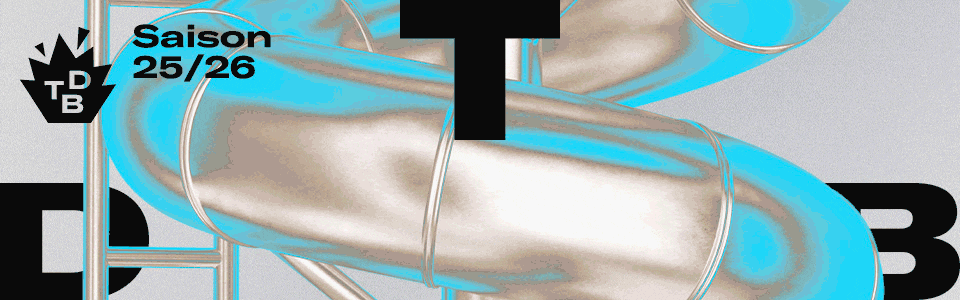


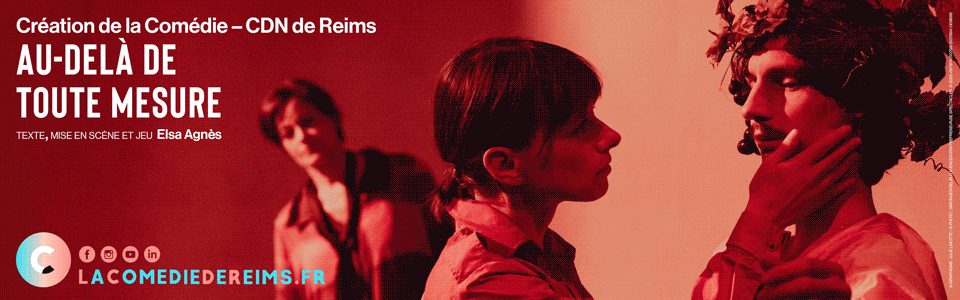








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !