Le cinéaste israélien Amos Gitaï compose une fresque textuelle et musicale qui, malgré le côté répétitif et scolaire de sa dramaturgie patchwork, révèle les blessures du passé sans, pour autant, cesser d’espérer.
À l’occasion de l’une des séances de son cours Après la peste noire, donnée voilà trois ans au Collège de France et intitulée Anno 1349 : lors on assomma les juifs, Patrick Boucheron se lançait dans la résolution d’une « énigme » : « Il y a la peste il y a la mise à mort des juifs », posait-il alors, en ôtant volontairement, dans un premier temps, toute conjonction de coordination – à commencer par le « donc » – entre ces deux syntagmes afin d’éviter une « causalité métaphorique à laquelle nous serions tenus de nous habituer ». À cette époque, les juifs sont victimes de pogroms récurrents à travers toute l’Europe avec un seul motif apparent : ils sont accusés d’avoir empoisonné des puits ou des stocks de nourriture pour propager l’épidémie de peste noire, et seraient exterminés par les masses populaires vengeresses en raison de cette croyance. En croisant des données archéologiques et des archives royales liées à l’attaque du call de la cité de Tàrrega durant l’été 1348, qui a provoqué la mort de plusieurs centaines de juifs, mais aussi en analysant d’autres massacres, à Strasbourg et en Provence notamment, l’historien tend à déconstruire l’idée d’un pur archaïsme, qui repasserait, au fil des siècles, les plats de l’antisémitisme telle une irrémédiable antienne, et relie ces exactions tragiques à des causes micro-économiques et politiques, en particulier à des formes de révoltes contre les pouvoirs princier et royal. Il n’empêche, depuis 1096 et les massacres antisémites perpétrés par les croisés en route vers la Terre Sainte, les juifs sont régulièrement la cible de persécutions, voire d’une volonté d’annihilation.
Scrutant à son tour cette tradition historiographique qui considère « le destin des juifs de la diaspora comme une pure succession de souffrances et de persécutions », selon les mots de l’historien Salo Baron dans son article Ghetto and Emancipation paru en 1928, Amos Gitaï fouille lui aussi dans la mémoire pour voir comment le sort terrible réservé à des minorités peut infuser dans une culture, une langue, une identité, voire dans un ethos, comment les violences perpétrées à l’encontre des membres d’une communauté peuvent influencer leur façon d’être au monde et d’envisager l’existence, et comment il est possible, peut-être, de briser ce cercle en apparence infernal. Après avoir diffusé un extrait de son film Tsili, inspiré du roman d’Aharon Appelfeld où une adolescente juive survit miraculeusement dans les forêts de Bucovine durant la Seconde Guerre mondiale, le réalisateur et metteur en scène israélien fait descendre des cintres une immense quantité de vêtements, comparables à ceux qui garnissaient les baraquements des camps de concentration – et qui ne sont pas sans faire écho à ceux que Christian Boltanski avait agglomérés sous la nef du Grand Palais, en 2010, dans le cadre de son installation Personnes. Derrière chaque pantalon, chaque pull, chaque t-shirt, se cache un individu, une personne, une victime, et le plateau du Théâtre de La Colline se transforme alors en terrain de fouilles, où les comédiennes et les comédiens convoquent une culture irriguée par un passé douloureux.
Scindée en douze tableaux, nourrie par les écrits de Joseph Roth (Juifs en errance), des nouvelles de Lamed Shapiro (« Le Baiser » et « La Croix », extraites du recueil Royaumes juifs. Trésors de la littérature yiddish) et des discours d’Isaac Bashevis Singer (« Pourquoi le yiddish ? ») prononcés lors de la réception de son prix Nobel de littérature en 1978, cette exploration est sous-tendue par un fil rouge, par la figure du Golem, objet d’un conte pour enfants écrit par l’écrivain américain d’origine polonaise à la fin des années 1960. Dans ce texte, Isaac Bashevis Singer remonte au XVIe siècle et raconte l’histoire d’un rabbin, Rabbi Leib, à qui Dieu aurait donné le pouvoir de créer un géant d’argile à taille humaine pour sauver un banquier juif, Reb Eliezer Polner, accusé à tort par le comte Jan Bratislawski, à qui il avait refusé un prêt, d’avoir tué sa fille. À travers cet homme, qu’une justice corrompue par l’antisémitisme séculaire de l’Église catholique condamnerait bien volontiers à mort, c’est tout le peuple juif, globalement menacé par ces fausses accusations – qui sont monnaie courante à l’époque –, que le rabbin doit défendre ; et, à travers ce conte, partiellement distillé tout au long de sa pièce, c’est aux racines atemporelles de l’antisémitisme qu’Amos Gitaï revient.
Dans un contexte où, depuis les attaques terroristes du 7-Octobre, le nombre d’actes antisémites connait une inquiétante flambée en France – + 192% au premier semestre 2024 par rapport au premier semestre 2023, selon une note de la Direction nationale du renseignement territorial remise au ministère de l’Intérieur en octobre dernier –, ce geste est salutaire, et on ne peut plus nécessaire. Si la dramaturgie façon patchwork de l’ensemble peut apparaître répétitive, systématique, voire scolaire, et donner parfois l’impression de faire du surplace, cette fresque textuelle, entrecoupée de chansons et musiques pour partie traditionnelles – en yiddish et en ladino –, dessine touche par touche, bribe par bribe, une constellation de la douleur tout à la fois dure et sensible. Malgré une tonalité scénique un peu monochrome, les musiciens, chanteuses, comédiennes et comédiens, à commencer par Irène Jacob et Micha Lescot qui, de rôle en rôle, constituent les premiers instruments de cette partition, parviennent à révéler les blessures, mais aussi l’humanité pleine et entière qui se dégage du texte composé par Amos Gitaï et Marie-José Sanselme. Tout particulièrement dans le dernier tableau, où chacune et chacun s’appuie sur sa propre vie pour venir nourrir ce panorama, ils édifient non pas une ode vengeresse, amère ou donneuse de leçons, mais bien une quête paradoxalement apaisée qui, in fine, doit aboutir à la réconciliation des peuples en dépit de leurs différences. Si cet appel à un Golem salvateur pourra apparaître naïf aux yeux des plus sceptiques, il n’en reste pas moins essentiel dans les temps troublés que nous connaissons, où les ferments de la division sont plus puissants que ceux de l’union.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Golem
Texte Amos Gitaï, Marie-José Sanselme
Mise en scène Amos Gitaï
Avec Bahira Ablassi, Irène Jacob, Micha Lescot, Laurent Naouri, Menashe Noy, Minas Qarawany, Anne-Laure Ségla, les musiciens Alexey Kochetkov (violon et synthés), Kioomars Musayyebi (santour), Florian Pichlbauer (piano), et les chanteuses Dima Bawab, Zoé Fouray, Sophie Leleu (voix et harpe), Marie Picaut
Recherche Rivka Markovitski Gitaï
Assistanat à la mise en scène Céline Bodis, Talia De Vries, Anat Golan
Lumières Jean Kalman, assisté de Juliette de Charnacé
Son Eric Neveux
Scénographie Amos Gitaï, assisté de Sara Arneberg Gitaï
Coiffures et maquillage Cécile Kretschmar
Costumes Fanny Brouste, assistée d’Isabelle Flosi
Patine costumes Emmanuelle Sanvoisin
Vidéo Laurent Truchot
Conseiller musical et chef de chœur Richard Wilberforce
Préparation et régie surtitres Katharina Bader
Conseiller et coach yiddish Shahar Fineberg
Fabrication des accessoires, costumes et décor Ateliers de La Colline
Régisseur général Anton Feuillette
Régisseur son Valentin Chancelle
Techniciens son Zacharia Abdeddaim, Yasmine Bouchenak, Youn Le Néün
Régisseur vidéo Igor Minosa
Régisseur lumières Gilles Thomain
Technicien lumières Alexandre Garcin
Régisseuse principale machinerie Morgane Bullet
Machinistes-cintriers Martin Decaster, Alexis Flamme
Cintrière Marta Lucrezi
Habilleuse Angèle Gaspar
Coiffures et maquillages Jean Ritz
Accessoiriste François BombagliaProduction La Colline – théâtre national
Durée : 2h
La Colline, Paris
du 4 mars au 3 avril 2025





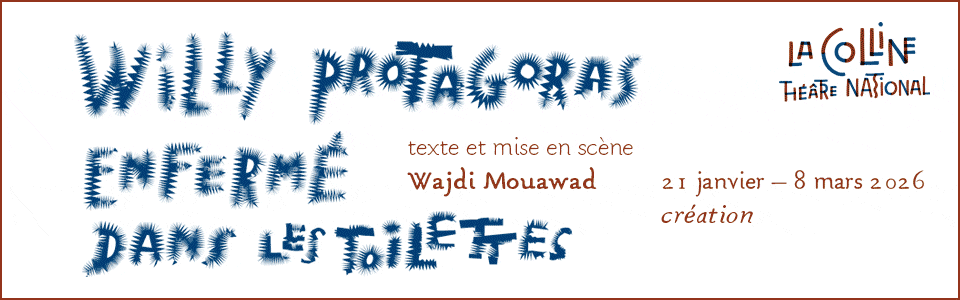


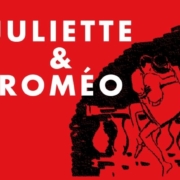

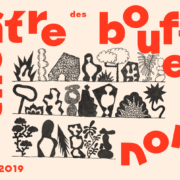
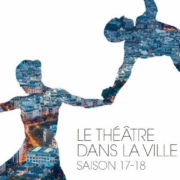


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !