Privé de public depuis près d’un an à cause de la pandémie de Covid-19, le monde du spectacle vivant ne reste pas les bras ballants et cherche à se réinventer pour maintenir une certaine activité. Retour sur douze mois d’une situation hors norme.
C’est un anniversaire que les professionnels du spectacle vivant auraient sans doute voulu ne pas « célébrer ». Il y a tout juste un an, le 6 mars 2020, les premiers établissements culturels fermaient leurs portes pour tenter d’endiguer la progression de la pandémie de Covid-19 dans l’Hexagone. Après l’Oise, le Val d’Oise, le Bas-Rhin et le Morbihan, le Haut-Rhin a rejoint, ce jour-là, la liste des départements où les rassemblements de plus de cinquante personnes étaient interdits. A la Comédie de Colmar, la nouvelle fait l’effet d’une douche froide. La co-directrice du CDN, Emilie Capliez, file voir Alice Laloy, en pleine répétition de son spectacle A poils, pour lui annoncer son annulation. « Je me souviens d’une période particulière, très violente moralement, où la ville vivait au rythme des sirènes et au son des hélicos, ce qui créait une certaine panique, raconte-t-elle. Toutefois, nous avons pris très vite la situation au sérieux car la crise sanitaire était visible de notre point de vue, ce qui n’était pas le cas dans toute la France. »
Ailleurs, les choses continuent effectivement comme si de rien n’était. Ou presque. Le 6 mars, le Président de la République, Emmanuel Macron, et son épouse, Brigitte Macron, se rendent au Théâtre Antoine pour voir Par le bout du nez, tandis que la première de La Ménagerie de verre se tient au Théâtre de l’Odéon, sans précautions sanitaires particulières. Dans le hall, comme dans la salle, le Covid-19 est dans toutes les têtes, mais on aperçoit encore, ici ou là, quelques embrassades qui relèguent les gestes barrières au rang de concept bien abstrait, réservés aux hypocondriaques et autres anxieux de nature. Le premier coup de semonce survient le 8 mars lorsque les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont prohibés sur l’ensemble du territoire. Les plus grandes institutions, comme l’Opéra de Paris, la Philharmonie de Paris et le Théâtre des Champs-Elysées, baissent le rideau et annoncent des annulations en cascade.
Stop ou encore ?
D’autres, plus agiles, entrent en résistance et mettent en place une jauge de 100 personnes pour se conformer à la règle gouvernementale imposée le 13 mars. « C’était un moment de très grande confusion où tout s’appuyait sur le ressenti des gens plus ou moins inquiets, se remémore le directeur du Paris-Villette, Adrien de Van. Dans la petite salle, une comédienne avait un peu de fièvre et il était impossible de se faire tester. Quand nous avons appelé le numéro dédié, on nous a répondu qu’il n’y avait pas de problème pour le public et que s’il y avait un peu de distance entre les comédiens, cela suffirait. » Le 14 mars au soir, alors que le Premier ministre Edouard Philippe vient d’annoncer la fermeture de tous les lieux « non indispensables » à partir de minuit, le théâtre permet à Émilie Anna Maillet de jouer Toute nue, dans la grande salle, devant une poignée de spectateurs non masqués, mais à bonne distance les uns des autres. Dans une ambiance crépusculaire, le directeur du Paris-Villette prend alors la parole pour annoncer au public qu’il s’agit de la dernière représentation avant une date indéfinie. « C’est un souvenir particulièrement fort, commente-t-il rétrospectivement. Je ne regrette pas du tout d’avoir tenu le plus tard possible. Aujourd’hui, nous aurions furieusement envie de rouvrir même avec ces règles très contraignantes car elles nous permettaient, malgré tout, de jouer encore. »
Plateaux TV et nouveaux projets
S’ouvre alors la période du premier confinement où l’ensemble du secteur culturel se retrouve à l’arrêt. Contraint et forcé, l’Opéra-Comique annule ou reporte Macbeth Underworld, Voyage dans la lune et Porte 8. « Puis, à partir du mois d’avril, nous avons souhaité maintenir l’activité, y compris, lorsque c’était possible, avec le public à la fin du mois de juin et au début du mois de septembre », souligne son directeur, Olivier Mantei. Des soirées plateaux TV sont organisées, des sessions de répétitions mises sur pied, des spectacles en streaming diffusés et de nouveaux projets comme Chantons, faisons tapage et Gala sans public – à la place de la reprise de La Belle Hélène – lancés. « Nous avons trouvé que c’était le mieux à faire pour le moral des équipes permanentes et artistiques, précise Olivier Mantei. Il ne s’agissait pas de faire de l’activité pour faire de l’activité, mais pour déboucher sur des créations. D’autant que ces initiatives nous ont permis de toucher un plus large public, moins habitué à nos salles, même s’il n’est pas physiquement présent, ce qui peut être source de frustration. »
Pour juguler l’appréhension des équipes face à la menace du virus, notamment durant les répétitions d’Hippolyte et Aricie, l’Opéra-Comique met en place un protocole draconien. A partir du mois d’avril, tous les artistes et techniciens deviennent remplaçables au pied levé en cas de contamination avérée avec un système de casting B. « Grâce à l’enthousiasme et aux efforts de chacun, ainsi qu’à la responsabilité de tous, aucun cas de Covid n’a été déploré et seulement un spectacle – Le Bourgeois gentilhomme où l’artiste touché avant son arrivée n’était pas remplaçable – a été annulé, se réjouit son directeur. Cela est aussi peut-être dû à la chance et au fait que nos effectifs sont moins nombreux que dans d’autres maisons. »
« Si, un an avant, on nous avait dit « Vous allez être fermés pendant un an », on n’y aurait pas cru »
A la Comédie de Colmar, préside la même excitation. Au tout début du projet qu’elle conduit avec Matthieu Cruciani, Emilie Capliez cherche la parade. Le duo demande à ses équipes de se plier en quatre pour s’adapter en permanence et investir toutes les brèches possibles « en inventant un schéma plutôt que de le suivre » : maintien de résidences d’artistes, mise au point de micro-créations pour aller jouer chez les particuliers, multiplication des ateliers scolaires… « Et puis, au mois de décembre, nous sommes entrés dans un tunnel à durée indéterminée, regrette la co-directrice. On a pu voir une partie du dynamisme s’essouffler à cause de l’épuisement général et des équipes, comme dans toutes les sociétés, tantôt découragées, tantôt offensives à cause du travail permanent avec la difficulté. Si, un an avant, on nous avait dit « Vous allez être fermés pendant un an », on n’y aurait pas cru. »
A plusieurs centaines de kilomètres de là, le Paris-Villette traverse la même zone de turbulences. « Depuis le second confinement, on affronte quelque chose de plus violent, de plus difficile qui peut ressembler, chez certains, à une crise de sens. Tout se passe comme si on travaillait autant que d’habitude, mais que le coeur n’y était plus vraiment, qu’il fallait entrer en résistance pour tenir. Les équipes ont parfois l’impression de bosser sur le décollage de la fusée Ariane en sachant pertinemment qu’elle ne décollera pas. Toutefois, l’ensemble tient bon et aucune fracture interne n’est à déplorer », remarque Adrien de Van
Avec les artistes aussi, les liens sont entretenus et permettent même, à en croire le directeur du Paris-Villette, d’améliorer les relations. « En faisant dérailler la mécanique de sollicitation de programmation dans laquelle on est parfois enfermé, on prend soin réciproquement les uns des autres et on essaie de faire et d’inventer des choses ensemble. Depuis un an, je constate beaucoup plus de discussions de fond car la question de la diffusion s’est allégée. Même si certaines compagnies regrettent que les lieux soient très dociles, car plus protégés qu’eux, qu’ils ne jouent pas leur survie dans les années à venir, contrairement à elles, le milieu culturel arrive à faire front commun, plutôt que d’être face à face. » Malgré tout, Adrien de Van voit poindre une certaine lassitude par rapport à l’action culturelle dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, par rapport à ce travail de médiation qui n’a de sens que s’il est relié à une création finale. « Même si, d’un côté, elle est nécessaire pour eux, certains artistes craignent vraiment d’être enfermés dans les mois à venir dans ce volume colossal d’action culturelle », note-t-il.
Susciter l’envie du public
Pour ne pas rompre le lien avec les spectateurs, le Paris-Villette a également utilisé toutes les possibilités offertes par le numérique avec un rendez-vous podcast, TPV chez vous, la mise en valeur de résidences ou la multiplication des newsletters. « Il n’est d’ailleurs pas rare que certains nous répondent en nous demandant comment nous allons, s’amuse Adrien de Van. Avant la crise, 55% de notre public avait moins de 30 ans et il est très important pour nous que nous puissions le retrouver à la sortie, malgré l’état délétère de la jeunesse et la potentielle perte d’habitudes en matière de pratiques culturelles. »
A la Comédie de Colmar, pari a été pris de rendre visible la partie immergée de l’iceberg, d’informer régulièrement les spectateurs sur l’activité souterraine du théâtre via des newsletters et des pastilles numériques. « L’idée était de voir comment le numérique pouvait, non pas se substituer, mais être un plus dans la période et comment il pouvait nous permettre d’entretenir l’enthousiasme du public par rapport à notre projet, voire de toucher certains publics habituellement empêchés que nous voudrions voir dans nos salles au moment de la réouverture », espère Emilie Capliez.
Dans la même veine, au Mouffetard – Théâtre des arts de la Marionnette, Isabelle Bertola a « développé de nouveaux outils de médiation numérique, mis en place des représentations en établissements scolaires, et placé toute son énergie pour maintenir et développer des projets d’éducation artistique et culturelle. » Résultat : « Nous avons ouvert le théâtre pour 54 jours de résidence, organisé sept représentations en direction des professionnels, présenté 22 représentations hors les murs, dans les établissements scolaires, organisé huit lectures de textes dans les établissements scolaires, mené 377 d’heures d’ateliers en présentiel et 45 heures d’ateliers en distanciel, et conduit un séminaire interne sur les questions de développement du public », énumère la directrice dans un communiqué.
L’inconnue du temps long
Alors qu’aucune date de réouverture n’a encore été inscrite au calendrier des prochains mois, que restera-t-il de cette période hors norme ? « Il y aura du positif, forcément, mais aussi des choses catastrophiques, anticipe Emilie Capliez. A titre personnel, je pense que la période aura contribué à réinterroger mon rapport au temps, y compris dans ma pratique. Il est encore trop tôt pour tirer les bonnes conclusions car nous ne disposons encore d’aucunes règles claires. Nous avons, malgré tout, vu de belles choses, comme la solidarité du réseau des CDN ou le renforcement des relations avec les artistes. »
Olivier Mantei pointe aussi le travail sur les publics, la réalisation d’objets filmiques « artistiquement innovants », « l’amélioration du dialogue social » au sein de l’Opéra-Comique qui « a prouvé sa robustesse, sa souplesse et sa réactivité ». « L’opéra est, traditionnellement, une institution du temps long, mais les équipes ont su prouver qu’elles étaient capables de repenser des modes de fonctionnement, de renégocier des accords en un temps record pour s’adapter aux nouvelles obligations, se félicite-t-il. Pour autant, si on nous le proposait, je ne revivrais pour rien au monde cette expérience. »
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr


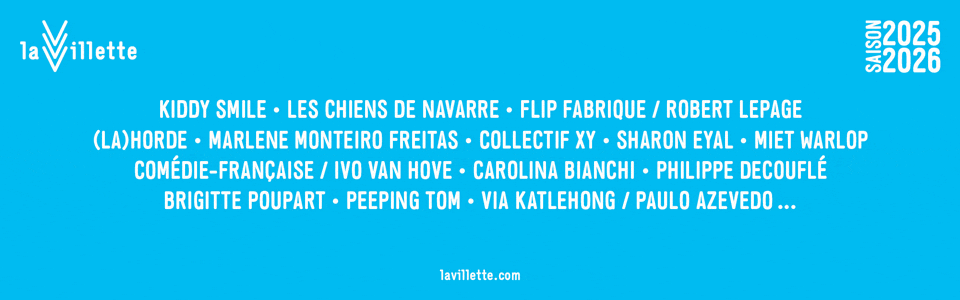


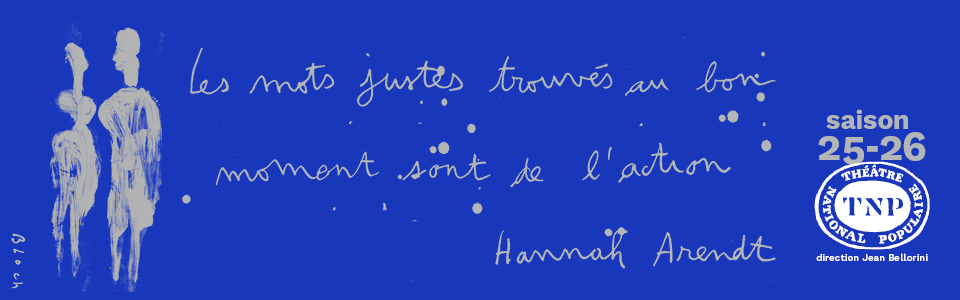








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !