Pour la 28ème année, l’abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson s’est faite en fin d’été, du 24 au 30 août 2023, la somptueuse maison des écritures théâtrales contemporaines. Avec ses 17 lectures, ses spectacles et rencontres, la traversée que nous offre cette édition nous fait aborder des styles et des sujets très variés. Parmi les pièces découvertes, beaucoup explorent toutefois la vaste notion de marge, et invitent à regarder le quotidien autrement.
Qui vient à la Mousson d’été y revient souvent. Il suffit de parcourir la liste des participants à l’édition 2023 de ce festival créé en 1995 pour s’en rendre compte. Vingt-huit ans après sa création, cet événement dédié aux écritures théâtrales contemporaines compte encore parmi ses nombreux participants plusieurs de ses amoureux historiques. À commencer par la metteure en scène Véronique Bellegarde, qui la dirige depuis deux ans. Parmi les inconditionnels de la première heure ou presque, on trouve à ses côtés le metteur en scène Laurent Vacher, le musicien Philippe Thibault, les universitaires Jean-Pierre Ryngaert et Joseph Danan ou encore le comédien Charlie Nelson.
Sans avoir participé aux débuts du festival, décrit dans le livre publié à l’occasion de ses 20 ans comme « à la fois très studieux et très joyeux », d’autres viennent régulièrement « moussonner » depuis de plus ou moins nombreuses années : les autrices et metteures en scène Pascale Henry et Nathalie Fillon, les magnifiques comédiennes Marie-Sohna Condé, Julie Pilod, Alexiane Torrès, les brillants traducteurs Laurent Gallardo et Marianne Segol-Samoy… Nombreux et surtout nombreuses cette année, les nouveaux feront alors pour certains probablement un jour partie des anciens.
Du neuf à l’abbaye
Cette arrivée de nouveaux visages à la Mousson d’été, décidée par Véronique Bellegarde et son équipe, permet au festival de conserver intacte, juvénile, son identité singulière. Ce qui est ici plus indispensable encore que pour toute autre aventure théâtrale, dans la mesure où une partie de son grand charme tient au décalage entre le cadre de l’événement et ce que celui-ci y amène. Élégante bâtisse de style baroque située à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, au bord de la rivière qui donne son nom au département, l’abbaye des Prémontrés tenue jadis par des jésuites, devenue ensuite université de Lorraine puis centre culturel de rencontre tranche en effet avec les écritures d’aujourd’hui qui s’y déploient en temps de Mousson. Dans les différents espaces de ce lieu historique, où logent aussi pendant une semaine tous les acteurs du festival, les mises en espace de pièces sélectionnées par un comité de lecture actif à l’année n’ont guère cessé avec le temps de vivre intensément, et d’offrir un regard sur le théâtre d’aujourd’hui.
La présence de nombreux jeunes auteurs, et de moins jeunes mais qui n’étaient jamais venus auparavant à la Mousson, ou alors une fois, est pour beaucoup dans cette vigueur préservée. La place donnée aux femmes – sur les 17 auteurs invités, 9 sont des femmes – est l’un des ingrédients de cette cure de jouvence. En donnant à découvrir des textes de la Norvégienne Monica Isakstuen, de la Catalane Lluïsa Cunillé, de l’Italienne Tatjana Motta, des Françaises Mona El Yafi, Mariette Navarro, Pauline Sauveur, Lydie Tamisier ou encore de l’Argentine Mariana de la Mata, la Mousson contribue avec force et élégance à la nécessaire mise en valeur des écritures féminines trop longtemps invisibilisées. Aucune de leurs pièces n’abordent toutefois les inégalités entre hommes et femmes. Le festival ne tourne pas pour autant le dos aux grandes questions de l’époque. En témoigne par exemple la venue de la chercheuse Gisèle Sapiro pour évoquer les questions « des morales de l’auteur et de l’œuvre et des formes de la violence symbolique dans la sphère culturelle après #MeToo ». Et bien des pièces approchent d’autres problèmes contemporains, nous les donnant à voir sous des angles neufs. Le drame des migrants et les violences engendrées par le capitalisme et la mondialisation, par exemple, se sont invités à l’abbaye des Prémontrés.
La vérité est dans le sous-texte
En choisissant pour première lecture, la seule du 24 août, Le cercle autour du soleil de l’auteur allemand Roland Schimmelpfenning déjà bien connu du festival pour y avoir présenté plusieurs textes, l’équipe de la Mousson affirmait son intérêt pour un théâtre qui interroge dans un même mouvement le fond et la forme, pour des pièces qui déjouent les discours dominants par leur écriture. Très fragmentaire, elliptique, cette pièce écrite dans le cadre d’une commande du Residenztheater de Münich pendant la crise du Covid présente l’intérêt de ne pas faire « seulement la chronique de l’épidémie qu’il ne nomme jamais et que nous connaissons tous, mais plutôt de notre façon individuelle ou commune de réagir à un traumatisme global. La grande beauté de l’écriture du dramaturge allemand réside dans son économie de mots qui déploie en quelques lambeaux de phrases des histoires entières », dit le traducteur Robin Ormond dans le journal de la Mousson, « Temporairement Contemporain », en réponse aux questions d’Arnaud Maïsetti.
Très chorale, Le cercle autour du soleil a permis à Véronique Bellegarde qui la mettait en espace de présenter un maximum des comédiens de cette Mousson. Au risque de ne pas pouvoir donner à entendre tous ses sens cachés derrière sa profusion de paroles très hétérogènes et ses multiples allers-retours temporels. Car en quatre services de répétition de trois heures, plus une générale, impossible de travailler tous les possibles d’un texte pareil, qui laisse une grande liberté à son metteur en scène et à ses acteurs. Le principal, c’est-à-dire dire l’originalité de la pièce par rapport aux nombreuses productions consacrées depuis quelques temps au même sujet, fut toutefois partagé. En programmant pareil texte, la Mousson fait confiance à ses spectateurs, chargés d’en mesurer le potentiel au-delà de la forme qu’elle prend devant nous, pour un soir seulement. Ce fut le cas avec plusieurs autres pièces de la cuvée 2023, parmi les meilleures : Cet air infini de Lluisa Cunillé, Ceci n’est pas nous de Monica Isakstuen ou encore Nuit blanche de Tatjana Motta. Trois pièces qui, chacune à sa façon, s’emparent du thème de l’étranger, de l’étrangeté.
Des étrangers mythiques
Avec Cet air infini, Lluisa Cunillé, autrice d’une œuvre considérable – une cinquantaine de pièces – invite aux Prémontrés l’une des grandes tragédies de notre époque : celle des migrants. Elle le fait avec son paradoxe habituel, qui selon les mots de son traducteur Laurent Gallardo, figure familière de la Mousson, fait d’elle une autrice « apolitique et politique en même temps ». « Le monde a changé, la Catalogne est de plus en plus confrontée à un monde ultralibéral. L’œuvre de Lluisa Cunillé suit cette évolution, en traitant de manière plus explicite ces mutations. Je dirais qu’en la matière, les années 2010 ont été pour elle un tournant. Écrite cette année-là, Cet air infini – à ce jour la pièce la plus jouée de Cunillé, notamment parce qu’elle a reçu en 2011 le Prix National de Littérature Dramatique en Espagne – témoigne très bien de ce virage, bien qu’elle soit un peu à part dans l’œuvre de l’autrice car écrite en espagnol alors que la quasi-totalité de son théâtre est en catalan. Toutefois, cette pièce comme bien d’autres d’elles n’est pas politique comme l’est un théâtre à thèse ».
Mettant en scène un Ulysse d’aujourd’hui sous les traits d’un ingénieur immigré et une femme elle aussi au ban de la société, qui revêt successivement l’identité de plusieurs figures mythologiques (Électre, Phèdre, Médée, Antigone), Cet air infini invite à regarder autrement la figure du migrant. Placée sous la lumière des grands mythes occidentaux, elle nous apparaît dans toute sa force et sa douleur. Si les choses sont dites plus explicitement que dans certaines pièces plus anciennes de Lluisa Cunillé, la puissance de l’œuvre tient beaucoup à son sous-texte. Là encore, le faire entendre en lecture était un défi, qu’ont relevé les comédiens Géraldine Martineau et Jackee Toto, sous la direction de Véronique Bellegarde.
La parole de Laurent Gallardo est encore précieuse pour saisir les enjeux de la présence de Cet air infini à la Mousson. « Lluisa Cunillé fait selon moi partie des auteurs qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur en Catalogne. Elle fait le choix d’un théâtre exigeant, un théâtre d’art ; or le théâtre évolue aujourd’hui en Catalogne vers des formes télévisuelles, standard, très accessibles. Il n’existe pas là-bas l’opposition qu’il y a en France entre théâtre public et théâtre privé : tout se mélange et Lluisa Cunillé, dont le théâtre est très exigeant pour le spectateur, reste en marge de tous les courants un peu populistes dans leur rapport au théâtre. Traduire Lluisa Cunillé en français, c’est alors en effet la projeter dans un contexte théâtral où son œuvre résonne différemment ». En choisissant ce texte ainsi que sept autres pièces traduites par la Maison Antoine Vitez – Centre international de la traduction théâtrale, la Mousson joue un rôle dans la reconnaissance de leurs auteurs. Tout comme d’ailleurs pour les auteurs français qu’elle défend.
La Mousson à la marge, en famille
L’un des textes les plus passionnants de cette Mousson, Ceci n’est pas nous de Monica Isakstuen, très sobrement et finement mise en espace par Gérard Watkins, brille aussi par son sous-texte. Les quatre personnages, « Ma mère, », « Mon père », « Ma sœur » et « Mon frère » s’y partagent une partition plus riche en trous, en silences qu’en mots – lesquels sont pourtant la seule chose qui existent de façon sûre dans cette pièce. En refusant régulièrement les rôles sociaux auxquels ils sont astreints, en niant souvent même constituer une famille et allant jusqu’à franchir sans cesse les frontières qui séparent la vie de la mort, ces protagonistes incarnent une étrangeté toute autre que celle de « Lui » et « Elle » dans Cet air infini. Ici, c’est le familier qui se mue en quelque chose de trouble, voire menaçant. L’unité de lieu de et de temps de La Mousson invitant à trouver des liens, des parentés entre les écritures qu’elle rassemble, nous pouvons voir dans Ceci n’est pas nous une invitation à la réflexion sur le rapport entre centre et marge, présente aussi dans Cet air infini. Là, le centre serait le modèle familial classique, et la marge tout ce qui le remet en question, tout ce qui finit par en faire une sorte de monstruosité.
Dans plusieurs autres pièces de La Mousson, la marge est géographique. C’est le cas dans Nuit blanche de la jeune autrice italienne Tatjana Motta, traduite pour la première fois en France par Federica Martucci. Ce texte aussi aborde la question de la migration, d’une façon singulière, distanciée. « Dans cette pièce, il n’y a rien ou presque de la tragédie, des destins dramatiques que l’on rencontre dans la plupart des pièces consacrées aux migrants. L’étrangeté du texte m’a beaucoup intéressée : sans ancrage géographique ni temporel clair, il ouvre la réflexion », dit la traductrice. Centrée sur la figure de l’« Hôte », qui accueille dans une ville en fête un couple, une « Femme » et un « Homme » en quête de choses différentes qui nous sont données à deviner plus qu’à voir, cette pièce énigmatique, en forme de parcours initiatique, interroge avec une grande délicatesse ce qu’est être étranger, ce que veut dire être hors de chez soi.
Observatoires du présent et du passé
Avec Aurora travaille de l’Argentine Mariana de la Mata, traduite en mentorat par Emiliana Fullana Lavatelli et Victoria Mariani, ou encore avec Fendre les lacs du Québécois Steve Gagnon, la Mousson nous mène dans des contrées lointaines, en marge de tout : dans la pampa argentine pour la première, et pour la seconde au milieu d’une forêt, près d’un lac dans un pays jamais nommé mais dans lequel on peut reconnaître le Canada. Habités par une poignée d’homme et de femmes seulement, dont les relations sont tendues à l’extrême par l’isolement, ces espaces où la Nature est partout sont pour les auteurs des observatoires des interactions humaines lorsqu’elles sont poussées dans leurs retranchements. Ils sont aussi des espaces où mettre en scène les ravages du capitalisme, qui s’insinue jusque dans les lieux les plus perdus et dans les langages de leurs habitants.
Très orales, les écritures de ces pièces appellent très fortement le corps des comédiens, comme l’ont montré les mises en espace réalisées par Laurent Vacher et Steve Gagnon lui-même. Bien d’autres fils pourraient être tirés de cette Mousson, notamment à partir de l’excellente pièce de l’auteur camerounais Edouard Elvis Bvouma, Chacun pour un, deux pour tous, où deux personnages à l’identité trouble tentent de reconstituer le face-à-face entre le préfet Jean Moulin et un tirailleur sénégalais, en juin 1940. On aurait encore pu partir de Chine avec l’énigmatique Poisson rouge de Berlin de Pat To Yan. Peut-être des productions à venir nous donneront-elles ces occasions. Car il arrive bien souvent à des pièces qui passent par la Mousson de trouver une existence ailleurs, au plateau. Les échanges officiels et plus intimes menés à l’abbaye des Prémontrés par toutes les personnes présentes auront en tous cas nourri la réception de ces pièces, et préparé leur futur possible.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr













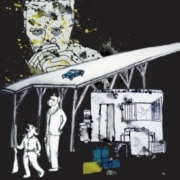


Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !