Membre du Collectif In Vitro, Éric Charon entrelace L’Assommoir et La Bête humaine dans une adaptation qui se focalise sur le sort des femmes d’hier et d’aujourd’hui. La traversée de ces deux romans déploie de nombreuses facettes de l’univers zolien, quitte à diluer un peu l’intérêt du spectacle.
Zola s’est essayé au théâtre, mais sans grand succès. Cependant, on y monte aujourd’hui régulièrement ses romans. Peut-être parce que, comme avec La Terre mis en scène il y a moins d’un an par Anne Barbot, la situation sociale d’hier, mise en lumière par le romancier, nous parle paradoxalement d’aujourd’hui. En effet, si Éric Charon s’attaque à deux gros morceaux du monumental cycle des Rougon-Macquart – L’Assommoir et La Bête humaine –, c’est un peu pour faire renaître l’image de la société ouvrière du temps du Paris haussmannien et des premiers chemins de fer, mais surtout pour tisser des liens avec notre présent. Notamment du point de vue de la place des femmes, et tout particulièrement des violences qu’elles subissent.
Ainsi, après un prologue où Virginie et Gervaise, les deux lavandières de la Goutte d’Or, s’écharpent à coups de linge mouillé à l’entrée du TGP de Saint-Denis, c’est dans un système bi-frontal, et grâce à une scénographie réduite à quelques tables et un grand étendoir pour draps blancs, qui dresse comme un écran de cinéma, qu’on assiste au récit croisé de deux générations de la saga zolienne : Gervaise de L’Assommoir, qui échappe au cruel Auguste Lantier et connaît avec Coupeau le bonheur conjugal et matériel, avant que l’alcool et la malédiction liée à la condition des classes populaires ne brise ses rêves ; puis, l’un de ses trois fils, Jacques Lantier, qui a grandi dans la salle réservée au linge sale de Gervaise, personnage principal de La Bête humaine en proie à une inexpugnable violence intérieure qu’il finit par retourner contre Séverine Roubaud, celle dont il était devenu l’amant après l’avoir exemptée, ainsi que son mari, du meurtre qu’ils avaient commis.
Avec ces deux intrigues complexes, mais linéaires, c’est une matière riche et dense que charrie ce spectacle de plus de deux heures, qui, par l’entremise d’un personnage ajouté – une sorte de narratrice –, se centre autour de la violence masculine qui s’exerce, jusqu’au féminicide, contre les femmes. On peut cependant aussi y croiser des échos d’aujourd’hui, par exemple une société avec ses violences de classes persistantes et ses déterminismes sociaux, tout comme la langue fleurie d’un peuple dont la sensuelle joie de vivre a toujours fasciné Zola, ou les remous de la psyché de Lantier par lesquels le romancier semblait annoncer la venue de la psychanalyse. À vouloir trop embrasser, le spectacle se prend cependant les pieds dans le tapis du manque de rythme et d’un pathos parfois trop étiré, et reste un peu sage à force de coller à l’esprit zolien, fut-il modernisé. L’inimitable goût de la prose de Zola dans ses scènes mémorables, tels le banquet de Gervaise ou le meurtre de Séverine Roubaud, se perd un peu, privé de sa grandeur romanesque et de sa langue. Mais l’implacable mécanique d’une domination des hommes trouve là un éclairage intéressant, où s’entrecroisent solidarité masculine et vulnérabilité sociale des femmes, mâle veulerie et bienveillance vache des rivales, et comme l’expression d’une prescience de Zola, qui questionnait, au passage, les visions bourgeoises et teintées de religiosité de son temps.
Tiré par une Gervaise (Magaly Godenaire) aussi vraie que son modèle littéraire, femme énergique et bienveillante à la fois, à l’appétit de vivre qui finira par la dévorer, et un Lantier biface (David Seigneur) – père impénétrable et distant, fils tout aussi taiseux, mais bien plus tourmenté –, rythmé par les interventions de deux musiciens – Maxime Perrin et Samuel Thézé –, qui se promènent de l’accordéon à l’électro, en passant par les bruitages et l’habillage sonore, le spectacle balance sans cesse entre les époques, fait partager tant l’humeur rigolarde du peuple que la noirceur du quotidien. Un voyage en clair-obscur qui prend donc trop rarement l’allure des trains fous de Zola, mais donne à respirer l’air vicié de nos structures sociales à travers lesquelles, pourtant, par leur humanité, ses personnages brillent.
Eric Demey – www.sceneweb.fr
Les Chroniques
d’après Émile Zola
Adaptation et mise en scène Éric Charon
Avec Zoé Briau, Éric Charon, Aleksandra de Cizancourt, Magaly Godenaire, Maxime Perrin (accordéon, percussions et clavier), David Seigneur, Samuel Thézé (clarinette et sampling), et la voix d’Olivier Faliez
Collaboration artistique Agathe Peyrard
Scénographie Zoé Pautet
Musique Maxime Perrin en collaboration avec Samuel Thézé
Lumières Julie-Lola Lanteri
Costumes Julie Scobeltzine
Assistanat aux costumes Annamaria Di Mambro
Régie générale Pascal Gallepe
Régie plateau Frédéric Gillmann
Régie lumières Luc Muscillo
Réalisation des costumes et des accessoires Nelly Geyres
Habillage Barbara OuvrayProduction Théâtre Gérard Philipe, centre dramatique national de Saint-Denis
Durée : 2h20
Théâtre Gérard Philipe, CDN de Saint-Denis
du 29 novembre au 15 décembre 2024





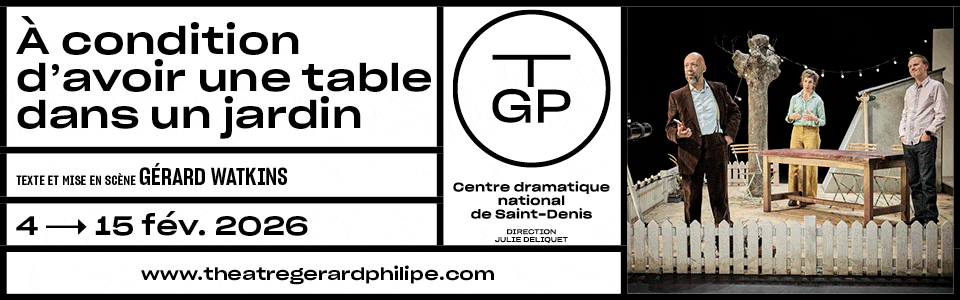








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !