Avec Histoire(s) de France, Amine Adjina offre au jeune public une approche très libre et joyeuse de plusieurs moments du passé. Située dans une classe, sa fiction est aussi un éloge du théâtre, de sa capacité à mettre le savoir en mouvement.
Pour réfléchir à la notion d’identité française, et à ce qu’elle signifie pour lui, Amine Adjina aime à créer à destination du jeune public. Dans Arthur et Ibrahim (2018), il racontait ainsi l’histoire d’une amitié perturbée par la différence : un enfant y refuse de jouer avec un autre parce qu’il n’est pas arabe. Sa nouvelle création, Histoire(s) de France, la première d’un cycle d’écriture de plusieurs pièces à destination de la jeunesse, présente bien des points communs avec cette autre pièce où, pour se fréquenter malgré tout, les deux garçons ont recours à une stratégie très théâtrale : la transformation du petit français en petit arabe. Amine Adjina n’hésite à le faire remarquer cette continuité en donnant à deux des trois protagonistes d’Histoire(s) de France les mêmes prénoms que ceux d’Arthur et Ibrahim. Le troisième est une fille, Camille, ce qui aura son importance. Incarné par Émilie Prévosteau, collaboratrice artistique d’Amine Adjina et codirectrice de leur compagnie Le Double créée en 2012, ce personnage étend la question identitaire à celle du genre.
C’est avec toutes leurs différences que ces trois adolescents incarnés par Émilie Prévosteau, Mathias Bentahar et Romain Dutheil sont amenés à s’emparer d’un épisode de l’Histoire de France. Cela, comme dans Arthur et Ibrahim et dans bon nombre de pièces adressées aux plus jeunes, dans un cadre scolaire. Non pas parce que la pièce est destinée aux écoles – elle ne se joue que dans des théâtres –, mais pour une autre raison qu’Amine Adjina traite avec une finesse aiguisée par la rencontre avec de nombreux collégiens : après la famille, l’école est la première institution fréquentée dans notre société par un individu. Elle est aussi l’un de ses principaux terrains de jeu collectif, qui peut être théâtral ou non. Il l’est dans Histoire(s) de France, et d’une manière beaucoup plus explicite et assumée que dans l’autre pièce déjà citée de la compagnie Le Double. S’ils se mettent ensemble à mettre au point une représentation de la bataille d’Alésia, de la Révolution française puis de la victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde de football de 1998, c’est à la demande d’une professeure d’Histoire peu académique.
Cette dernière, de même que la classe où elle laisse les faits historiques se faire bousculer par l’imaginaire, n’est présente dans la pièce que par la parole des trois élèves. Sur un plateau qui tient à la fois du terrain de sport et du théâtre, les trois comédiens portent un récit dont la jeunesse est entièrement le sujet. Ou plutôt « les sujets », car hormis une distance plus ou moins grande avec le monde adulte, Arthur, Ibrahim et Camille ont des imaginaires et des caractères qui convergent si peu qu’au lieu d’un seul moment de l’Histoire, ce sont trois épisodes du passé qu’ils présentent à leur professeure et à leurs camarades, dont les réactions appartiennent elles aussi à un hors-champ. Pour Arthur donc, les Gaulois. Pour Camille la Révolution française et pour Ibrahim la Coupe du monde. Trois sujets qui, pris séparément, auraient pu donner lieu à un discours, convenu, didactique. Mais rassemblés par le cadre simple et précis conçu par Amine Adjina, ils sont le contraire.
Poreux les uns autres, ainsi qu’à l’identité des élèves qui se révèlent au fur et à mesure de la pièce, les trois moments d’Histoire qui se succèdent dans le spectacle n’ont rien à voir avec l’image qu’en donnent les livres scolaires. Car, poussés en cela par Camille, surnommée par Arthur « la fille de Mai 68 », les trois collégiens s’autorisent toutes les libertés qu’ils souhaitent avec le passé. Ce qui ne va pas de soi : aussi petit soit-il, le groupe possède une identité complexe. En montrant la fabrication de leurs petites mises en scène plutôt que leur aboutissement, Amine Adjina fait du dissensus le cœur de sa pièce. Chacun tour à tour comédien et metteur en scène, les membres du trio soulèvent en effet plusieurs questions d’actualité dans le milieu théâtral : celle de l’appropriation culturelle, de la possibilité pour un acteur de jouer un personnage d’une couleur de peau ou d’un sexe différent du sien, ou encore de la « diversité », au cœur aussi d’un autre spectacle d’Amine Adjina[i], pour adultes celui-là.
Se mettre à hauteur d’ado, pour Amine Adjina, n’est pas baisser d’un cran son exigence dans l’approche des sujets qui l’intéressent. C’est chercher une adresse, une manière de les mettre en jeu capable de faire bouger les représentations d’une tranche d’âge qu’il a abordée à travers une récolte de témoignages qui se mêlent parfois aux mots des comédiens sous la forme de vidéos ou d’enregistrements audio. La galerie de créatures mi-historiques mi-contemporaines auxquelles donnent vie les comédiens permettent à l’auteur et metteur en scène de faire vraiment théâtre d’un thème qui donne souvent lui à des pièces peu théâtrales. Un druide parlant arabe, un Vercingétorix à gros seins, une Marie-Antoinette et un Louis XVI en tenue d’époque et bermuda… Portée par trois excellents comédiens, cette Histoire(s) de France est pleine de trouvailles réjouissantes. Enfants comme adultes, on y puise avec une joie qui n’efface pas le sérieux de la proposition, son invitation à penser le présent grâce à un regard critique sur le passé.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Histoire(s) de France
Texte et mise en scène Amine Adjina
Collaboration artistique : Émilie Prévosteau
Avec : Mathias Bentahar, Romain Dutheil et Émilie Prévosteau
Création lumière : Bruno Brinas et Azéline Cornut
Création sonore : Fabien Aléa Nicol
Scénographie : Cécile Trémolières
Costumes : Majan Pochard
Régie générale : Azéline Cornut
Assistant à la mise en scène : Julien Bréda
Création vidéo : Guillaume Mika
Administration – production : Adeline Bourgin
Diffusion : Olivier Talpaert – En Votre Compagnie
Coproductions : La Halle aux Grains, scène nationale de Blois / Le Théâtre d’Angoulême, scène nationale / Scène nationale de l’Essonne, Agora-Desnos / Équinoxe, scène nationale de Châteauroux / Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin / Le Tangram, scène nationale d’Évreux-Louviers / Théâtre La Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud / Le Grand R, scène nationale de la Roche-sur-Yon / Le Théâtre de Chartres, Scène conventionnée d’intérêt national art et création / Gallia Théâtre, Scène conventionnée d’intérêt national – Art et création de Saintes
Soutiens : Théâtre des Quartiers d’Ivry – Centre Dramatique National du Val de Marne ; Atelier à Spectacle, scène conventionnée d’intérêt national art et création de l’Agglo du Pays de Dreux ; CRÉA – Festival Momix – Scène Conventionnée d’Intérêt National « Art, Enfance, Jeunesse »
Pour cette création, la Compagnie du Double bénéficie du soutien de la Mairie d’Orléans et du Conseil Départemental de l’Essonne.
La Compagnie du Double fait partie de la fabrique pluridisciplinaire CAP Étoile financée par la région Île-de-France, le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et la ville de Montreuil.
La Compagnie du Double est membre du 108 lieu collectif d’expérimentation artistique et culturel financé par la Ville d’Orléans, la Région Centre-Val de Loire, le Ministère de la Culture et la préfecture du Loiret
Depuis 2019, la Compagnie du Double est conventionnée avec la région Centre-Val de Loire
Depuis 2021, la Compagnie du Double est conventionnée avec la DRAC Centre-Val de Loire
Avec le soutien du Fonds SACD Théâtre et de l’Onda – Office national de diffusion artistique
Durée: 1h15


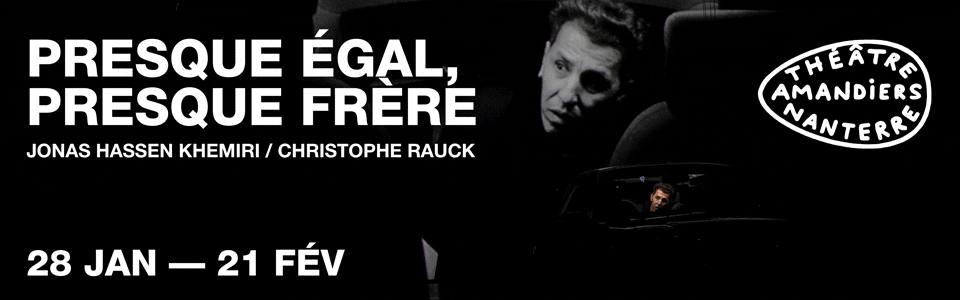











Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !