La performeuse espagnole descend dans l’arène pour se mettre à nu. En s’inspirant du matador Juan Belmonte et de Tristan et Iseult, elle dresse l’autoportrait d’une femme éreintée par la soif d’amour et d’une artiste dévorée par le doute. Une histoire de son théâtre, révoltée et poignante.
Au fil des années, on croyait avoir tout vu d’Angélica Liddell, que l’artiste espagnole n’était plus en mesure de nous surprendre, de nous cueillir, comme elle avait su le faire par le passé. Et pourtant. La toute première image de sa nouvelle création, Liebestod, est tellement incongrue qu’elle provoque immédiatement le décalage et sera, pour sûr, de celles qui resteront en mémoire. Quand le rideau s’ouvre sur le plateau de l’Opéra Confluence, un homme trône au milieu d’un décor tout d’orange drapé. Devant les palissades caractéristiques d’une arène, cette brute épaisse, muscles saillants, tient en laisse une bonne dizaine… de chats, tels les symboles de cette mignonitude qui affole autant qu’elle abêtit les Internets, et avec eux la société. Et l’on ne sait alors plus trop qui, finalement, est le maître de qui. Hautement signifiant sous ses relents comiques, ce tableau n’est que le premier d’une série qu’Angélica Liddell, qui ne tarde pas à paraître, esquisse de sa main pour conter une histoire du théâtre, de son théâtre, révoltée et poignante, dans la veine du cycle ouvert, voilà trois ans, par Milo Rau.
Instantanément, la torera de la scène, à la manière du toréador révolutionnaire Juan Belmonte dont elle s’inspire, se pose en femme à bout de souffle. Assise sur une chaise, verre de vin rouge à la main, la voilà qui se grime avec du sang. Sur les genoux d’abord, sur les mains ensuite, comme si les blessures émergeaient à mesure que le temps avançait, et surtout que l’amour lui infligeait. Car, en fond sonore, résonne Asingara du groupe Las Grecas, et les paroles sont sans équivoque possible : « No… no puedo vivir / Yo sin su amor, sin su amor no viviré ». Telle Iseult au contact de Tristan, c’est bien l’autoportrait d’une âme blessée, éreintée, qu’elle donne à voir, de celles qui plongent irrémédiablement dans les abîmes face à l’impossibilité de l’amour. Chez Liddell, le combat pour l’idéal amoureux devient une corrida stylisée, et c’est elle qui, dans son face-à-face avec le taureau, symbole de la masculinité triomphante, courbe l’échine, et en vient, rabrouée par l’inassouvissement du désir absolu, à vouloir la mort.
Provocante, la performeuse l’est encore et toujours, comme si elle voulait donner au public, pense-t-on d’abord, ce qu’il était venu chercher. Masturbation en pleines menstrues, pain enduit de sang qu’elle dévore, carcasse de taureau qui descend du plafond, exposition d’un corps mutilé… Au-delà du coup de force esthétique, le tout paraît moins gratuit, et sonner moins faux, que dans certains de ses précédents spectacles où elle en venait à se caricaturer elle-même. Sans doute car il fallait obligatoirement en passer par là pour conter, dans toutes ses acceptions, l’histoire de son théâtre, sur fond de refrains hispano-pop, de musique religieuse et de tubes wagnériens. Toujours aussi furieuse, Angélica Liddell semble d’ailleurs nettement plus authentique, comme si elle s’était libérée de ce personnage dans lequel elle s’était très progressivement laissée enfermer. A son corps, on le comprend, presque défendant.
C’est le moment qu’elle choisit pour positionner sa banderille finale, et livrer sa dernière estocade, comme on abattrait le taureau théâtral, et, peut-être, sa dernière carte. En singeant de jouer Iseult, elle s’adresse à elle-même et, en même temps, à ses spectateurs. Avec des accents qu’on avait pu lui connaître dans ¿ Qué haré yo con esta espada ?, la voilà, seule, face public, qui dresse un triste bilan des années passées : les spectateurs ne l’aimeraient plus, lassés par ses provocations à la chaîne. En un sens, ils auraient divorcé de celle qui voulait, à tout prix, trouver dans l’art, et la scène, un remède, un moyen d’être aimée, désirant être applaudie, presque pathétiquement, « par des inconnus », quitte à leur livrer la mort de ses parents en pâture. Et Liddell de poursuivre, sans concession vis-à-vis des autres et d’elle-même, avec une honnêteté violente et poignante, avouant même que l’apogée de sa renommée l’a brisée.
Tout en écharpant ses spectateurs, qui le lui rendent bien, elle dresse l’autoportrait d’une performeuse has been, face à ce public par trop « moderne », d’une artiste en proie au doute, qui ne se reconnaît plus dans le système théâtral – trop fonctionnarisé à son goût –, déçue de ne pas avoir été à la hauteur de ces écrivains qu’elle aurait tant voulu séduire, inadaptée à l’époque, dégoûtée par une société où elle ne trouve plus sa place, où l’amour et la foi auraient complètement disparu. Et surtout d’une femme qui, à trop chercher dans la scène cet amour qu’elle n’a pas dans la vraie vie, n’a pas trouvé sa complétude. Avec force et courage, elle ouvre, comme rarement on l’avait entendu, son capot intime, et le constat est celui d’un échec personnel. L’exercice paraîtra, c’est certain, fort égotique à d’aucuns, voire inutilement insultant vis-à-vis d’un public, et d’un monde du théâtre, qu’elle ne ménage pas. Il a pourtant le mérite de mettre ce coup de pied dans la fourmilière qui manquait tant depuis le début de ce 75e Festival d’Avignon. Il a aussi la beauté de cette confession scénique, profonde, essentielle, et éminemment politique, au sens le plus noble du terme. Angélica Liddell s’est rarement aussi peu dévêtue, mais a rarement été aussi à nu. Sans fard, ni artifice. En un mot, bouleversante.
Vincent Bouquet – www.sceneweb
Liebestod – El Olor a sangre no se me quita de los ojos – Juan Belmonte – Histoire(s) du théâtre III
Texte, mise en scène, scénographie, costumes Angélica Liddell
Avec Angélica Liddell, Borja López, Gumersindo Puche, Palestina de los Reyes, Patrice Le Rouzic, et la participation de figurants Matisse Bonzon, Ezekiel Chibo, Ewen Frey-Janériat, Yannick Janériat, Vincent Masson, Gina Masson, Gael Tiê Moraes Bonzon, Morgan Pons, Louise Pons
Lumière Mark Van Denesse
Son Antonio Navarro
Costumes Justo Algaba
Assistanat à la mise en scène Borja LópezProduction NTGent, Atra Bilis
Coproduction Festival d’Avignon, Tandem Scène nationale Arras-Douai, Künstlerhaus Mousonturm (Francfort)
Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistiqueDurée : 1h50
Odéon
Du 10 au 18 novembre 2022





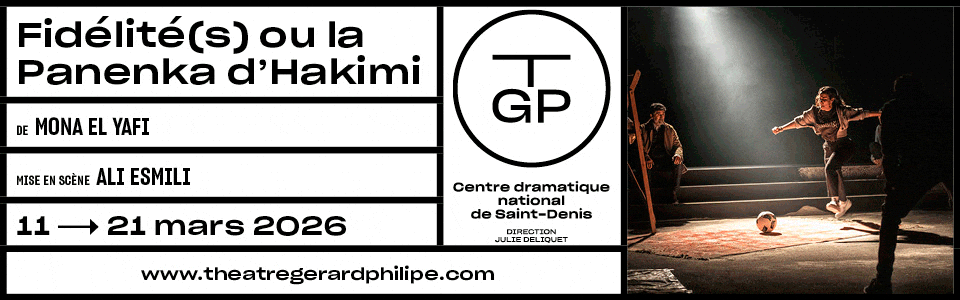








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !