Dans son livre Sauver le moment, le comédien Nicolas Bouchaud fait le passionnant récit de différents épisodes de ses trente ans de théâtre. Reliés par la question du temps, ces textes constituent un précieux témoignage d’une expérience non seulement personnelle, mais aussi collective. En grande partie forcé de la mettre entre parenthèses ces temps-ci, l’artiste nous reçoit chez lui.

Ses trente ans de théâtre, Nicolas Bouchaud les traverse sans hâte, en s’arrêtant où bon lui semble, souvent là où on ne s’y attendait pas. S’il commence par dire sa rencontre fondatrice avec Didier-Georges Gabily en 1992, à ses tout débuts dans le métier, il se promène ensuite à sa guise d’un spectacle à l’autre de Jean-François Sivadier avec qui il travaille depuis vingt ans. Il se remémore également des instants précis de ses spectacles personnels, depuis La loi du marcheur (2012) consacré au critique de cinéma Serge Daney jusqu’à Maîtres anciens d’après Thomas Bernhard, qu’il devait reprendre au Théâtre de la Bastille en ce mois de janvier. L’acteur a le sens de l’anecdote : c’est à partir d’elle qu’avec humilité, il déploie sa pensée du théâtre, qui demeure ainsi toujours vivante, concrète. La transmission se fait sans qu’on s’en rende compte : par l’écriture comme au plateau, Nicolas Bouchaud nous accueille dans son temps.
Les « moments » que vous relatez dans votre livre vont de vos débuts dans les années 90 jusqu’aux répétitions de votre Maîtres anciens (2017). Rien donc sur la situation actuelle, qui prive le comédien de public. Ce contexte a-t-il malgré tout influencé l’écriture ?
Nicolas Bouchaud : Le livre devait sortir en juin dernier. J’avais donc rendu ma copie avant le premier confinement. Avec le report de la publication, mes éditeurs m’ont proposé d’ajouter des textes. Je n’en ai ajouté qu’un, qui n’a rien à voir avec la situation actuelle : le chapitre « Le geste de Galilée », où j’évoque les répétitions de La Vie de Galilée avec Jean-François Sivadier. Écrire, créer à partir du contexte actuel me semble impossible : nous sommes dans un temps qui nous est imposé, qui est exactement l’inverse du temps qu’on invente lorsqu’on joue sur une scène face à un public. On est créatif quand on peut raccourcir ou étirer le temps à sa guise.
Dans sa préface à votre livre, Véronique Timsit, votre complice de longue date, vous dit toujours équipé d’un cahier où vous prenez des notes. Quelle place tient l’écriture pour vous, et comment en êtes-vous arrivé jusqu’au livre ?
N.B. : L’écriture a toujours été très importante. J’aime être un scribe : en recopiant des extraits de livres que je suis en train de lire, en parlant d’un film ou de toute autre œuvre, j’ai la sensation d’avoir accès à ma pensée. Ces cahiers m’ont servi pour écrire le livre, que j’ai entrepris suite à une sollicitation de Claire David et de Georges Banu, pour la collection « Le Temps du théâtre » chez Actes Sud. Il me semble que j’ai écrit Sauver le moment de la même manière que j’aborde le travail de l’acteur : avec une façon de m’imbiber de l’écriture, de la pensée des autres, qui fait qu’à un certain moment on entre vraiment en dialogue et que se créée une chose qui n’existait pas avant. En commençant un texte, j’ai souvent été surpris de voir où il me menait, vers quels écrits, vers quels films. C’est pareil quand je joue : j’essaie de créer un paysage entre moi et le rôle. J’aime beaucoup cette phrase de Louis Jouvet, qui dit : « Alceste dans Le Misanthrope, c’est celui qui ne pourra jamais être Alceste ». Pour moi, c’est une pure définition de l’acteur. C’est avec cette distance que l’on créée de la vie sur scène.
Selon quels critères avez-vous choisi les différents épisodes de votre parcours que vous développez dans Sauver le moment ?
N.B. : Avant de me lancer dans l’écriture, je me suis longtemps demandé ce que je pouvais dire d’intéressant du métier d’acteur. Et, comme je le dis en introduction, j’ai laissé ma mémoire me dicter l’apparition de moments de ma vie d’acteur. Sans être reliés entre eux par un thème, ils sont traversés par une question : celle du jeu. Celle du temps que manipule le comédien : une sorte de faille entre le passé et l’avenir. L’expression « sauver le moment » vient de Serge Daney, dans un article sur John Ford. Il analyse que le cinéaste fait deux films à la fois : un pour étirer le temps le plus possible, et un pour « sauver le moment » en montrant un paysage deux secondes avant l’action. C’est une chose que je ressens sur scène : les secondes qui précèdent le début d’une pièce sont de cette nature.
Vous abordez autant votre travail auprès de Jean-François Sivadier et de quelques autres metteurs en scène – Didier-Georges Gabily, Rodrigo Garcia ou encore Sylvain Creuzevault, avec qui vous auriez dû créer Les Frères Karamazov en novembre dernier dans le cadre du Festival d’Automne – que vos créations personnelles. Comment ces deux pans de votre vie théâtrale se complètent-ils ?
N.B. : Ces deux approches de la scène sont pour moi davantage que complémentaires : elles marchent main dans la main. J’en ai la certitude depuis la création de La loi du marcheur, où je m’empare d’un entretien entre Serge Daney et Régis Debray, qui répondait alors à une nécessité intime. En 2010, lorsque je commence à y travailler, je m’interroge sur la place de la pensée au théâtre. Comment faire pour qu’elle devienne une aventure et que les gens s’en délectent ? Cette question est aussi au cœur de mes créations suivantes, consacrées à John Berger, Paul Celan et Thomas Bernhard. C’est passionnant, mais j’ai aussi besoin de la vie de compagnie.
« Je sais qu’au cœur du projet artistique de Nicolas, il y a le souci du commun. Nicolas joue ‘’dans’’ et ‘’pour’’ le théâtre public. Il lui est redevable », écrit Véronique Timsit dans sa préface. Quels changements avez-vous pu observer en trente ans dans la politique du théâtre public ?
N.B. : Ma génération est encore un peu portée par la politique du couple Mitterrand / Lang. Les très gros salaires du théâtre subventionné ont déjà disparu, et globalement les salaires entament une baisse vertigineuse qui se poursuit aujourd’hui, mais on arrive tout de même avec l’idée que le théâtre subventionné veut dire quelque chose. Avec Didier-Georges Gabily, on en a l’expérience par exemple en allant faire nos créations aux Fédérés à Montluçon, dont la troupe est alors dirigée par Jean-Paul Wenzel, Jean-Louis Hourdin et Olivier Perrier. Ils sont de purs produits du théâtre public et de la décentralisation, et nous apprenons beaucoup à leurs côtés. Nous faisons de nombreuses rencontres autour de nos pièces, comme c’est toujours le cas aujourd’hui en tournée, pour tous les artistes de théâtre. Voilà une réalité parmi d’autres qui semble étrangère aux politiques actuels. En matière théâtrale et culturelle comme d’une façon plus large, la Covid grossit comme une loupe des réalités plus anciennes.
Voulez-vous dire que la recherche que vous menez avec Didier-Georges Gabily, que vous décrivez dans votre premier chapitre comme une tentative de « s’affranchir des codes dominants, chercher le geste reconnaissable, le corps non repérable », serait impossible aujourd’hui ?
N.B. : Sans dire que c’est impossible, je pense que l’importance de la notion de service public était alors beaucoup plus largement répandue qu’aujourd’hui, ce qui permettait un soutien fort de la recherche artistique. Il était admis que, n’étant pas soumis à la valeur marchande des choses, on se devait en tant qu’artiste d’avoir une certaine exigence, de tenter certains gestes. Et surtout, de ne pas « répondre à la demande du public », injonction que l’on ne cesse d’entendre. Or dans un système non marchand plus encore qu’ailleurs, c’est totalement inepte. On ne sait jamais ce qui va susciter le désir. Chez les ministres successifs, s’est insinuée une pensée qui était auparavant le credo des partis politiques d’extrême droite : selon elle, le théâtre est « élitiste », il est destiné à une catégorie de population et pas aux autres. C’est une insulte envers le créateur : lorsqu’on créée des spectacles, des films, des livres, des tableaux, on ne peut pas penser faire quelque chose d’élitiste. Il est scandaleux d’entendre cela.
Comment s’opposer à ce discours en tant que comédien ?
N.B. : Je ne vois qu’une manière : en faisant ce que nous savons faire : des spectacles, même si cette possibilité nous est en grande partie enlevée aujourd’hui. La photographie que nous avons sous les yeux depuis le 15 décembre dernier, jour d’annonce de la non-réouverture des salles de spectacle et de cinéma, est alarmante : consommation, religion et sécurité y tiennent la place centrale. Un principe de sélection, selon le terme employé par l’historien Patrick Boucheron, est aussi à l’œuvre. Les élèves de classes préparatoires, par exemple, peuvent aller en cours alors que les élèves des universités ne le peuvent pas. Quant au théâtre, les compagnies les plus jeunes et fragiles risquent de ne pas s’en remettre : seules resteront alors les plus solides.
Votre engagement prendra la forme d’un nouveau spectacle, Un vivant qui passe. De quoi s’agit-il ?
N.B. : C’est l’adaptation d’un film de Claude Lanzmann, filmé pendant le tournage de Shoah. Le réalisateur y dialogue avec le docteur Maurice Rossel, délégué du Comité international de la Croix-Rouge qui dut se rendre en 1944 au camp de Theresienstadt. Avertis de sa venue, les nazis ont mis en scène le camp de manière à lui cacher la réalité. Autrement dit, ce sera un spectacle sur ce que c’est que voir.
Propos recueillis par Anaïs Heluin
Sauver le moment, Nicolas Bouchaud, Actes Sud, 181 p., 20 €.





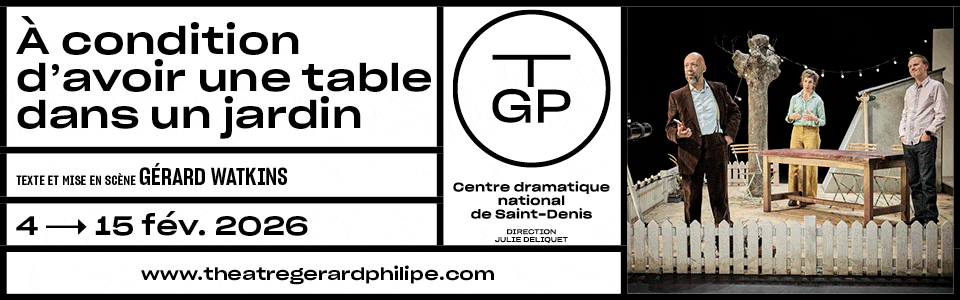



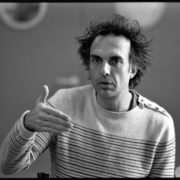



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !