
Photo Pierre Gondard
À la Comédie de Béthune, le metteur en scène poursuit sa route avec l’autrice américaine Naomi Wallace et se saisit, avec une sobriété féconde, du deuxième volet de sa trilogie enracinée dans le Kentucky.
Avec Naomi Wallace, Tommy Milliot n’en est pas à son coup d’essai. En 2019, déjà, dans le cadre de la 73e édition du Festival Avignon, le jeune metteur en scène s’était emparé de l’un des textes de l’autrice américaine, La Brèche, sans savoir que ce spectacle serait la première étape d’un plus ample compagnonnage. À cheval entre deux époques – la fin des années 1970 et le début des années 1990 –, la pièce avait les deux pieds solidement ancrés, pour ne pas dire enlisés, dans le Kentucky. Et il en va de même pour Qui a besoin du ciel, le deuxième volet de la trilogie que Naomi Wallace consacre à cet État américain, dont elle est originaire, et dont Tommy Milliot se saisit aujourd’hui. Entre ces deux opus, n’existe aucun lien dramaturgique direct, aucun personnage commun, aucune logique de suite ou de filiation, mais subsiste un cadre similaire, un environnement mortifère, celui d’un territoire en proie aux assauts du néolibéralisme de la fin du XXe siècle. Si les jeux dangereux des adolescents de La Brèche sont bel et bien terminés, c’est, à nouveau, par le prisme de la vie d’un groupe, de ses ressorts, de ses difficultés, de ses mouvements d’attraction-répulsion, que Naomi Wallace révèle les lourdes conséquences que des conditions sociales dégradées peuvent avoir sur l’existence des femmes et des hommes qui y sont soumis.
Au centre de cette communauté, se tient Wilda Spurlock. Accroc aux médicaments que son médecin, Braxton Roscoe, n’a jamais rechigné à lui prescrire, elle entend bien se sevrer à la dure. À sa demande, son amie, Annette Patterson, et son neveu, Marcos Carreiro, l’ont ligotée à une chaise et se sont engagés à ne la libérer que le jour de son anniversaire. Tandis que la première, guide dans une grotte de la région, bataille pour récupérer la garde de sa fille, Kamary, avec qui elle entretient des rapports compliqués, le second, accompagné de sa petite amie, Lydia Estes, rejette son père, Rafael, tout juste revenu de Floride. Depuis la fermeture de l’usine d’aluminium, due à la cupidité de son PDG, Binkerten Winston, toutes et tous se retrouvent dans une impasse économique et dans un marasme social dont Wilda, entre deux bouffées délirantes, souhaite à tout prix les tirer. Grâce à un secret qu’elle s’était, jusqu’ici, bien gardée d’avouer, elle veut faire chanter le grand patron pour obtenir une coquette somme d’argent ou, mieux, la réouverture de l’usine et redonner ainsi un emploi à chacune et chacun dans cette petite ville ouvrière de l’Amérique reagannienne des années 1980. D’abord sceptique, le collectif se prend bientôt à y croire, et apporte, peu à peu, son soutien à Wilda qui, de son côté, doit se battre avec ses propres démons.
Sur ce terreau irrigué par la misère sociale, ne pousse, comme toujours chez Naomi Wallace, aucun misérabilisme, mais plutôt un sens de la lutte et du combat. Alors que l’autrice expose, en toile de fond, l’ensemble des ravages intimes d’un néolibéralisme forcené, des prémices de la crise des opioïdes – qui, comme l’ont récemment montré le film de Laura Poitras, Toute la beauté et le sang versé, et la série Netflix, Painkiller, continue de dévaster les États-Unis – aux blessures physiques et psychologiques causés par un travail, ou un manque de travail, devenu éreintant, elle fait de la dynamique collective, multiethnique et intergénérationnelle le berceau de la résistance et de la survie, le creuset de l’espoir, sans doute un peu déraisonnable, de sortir la tête de l’eau. Car ce sont bien dans leurs rapports familiaux, amicaux, amoureux, y compris lorsqu’ils sont tendus, que les personnages trouvent la force nécessaire pour se remettre à y croire et engranger des petites victoires – le sevrage, le pardon, la restauration d’un lien filial – qui, à l’échelle individuelle, constituent autant de tremplins pour prendre un autre chemin. Si le versant farcesque de la pièce – couronné par le passage de « la poche à caca » – s’avère moins convaincant que son côté drame social, la langue de Naomi Wallace réussit à tenir ensemble ces deux sphères, à faire de la parole, souvent sans ambages, et de l’humour, toujours brut de décoffrage, des leviers d’affrontement autant que des moyens de conciliation, mais aussi à ausculter, avec finesse, la complexité des rapports intra-familiaux, comme produits des tensions sociales et sources des bonheurs et malheurs individuels.
Ce texte, auquel on peut peut reprocher un manque de radicalité et l’aspect inabouti de certaines de ses tentatives métaphoriques, voire poétiques, Tommy Milliot l’empoigne avec une sobriété féconde. Par son caractère abstrait, « suggérant, dit-il, les fondations d’une maison », sa scénographie est capable d’accueillir les différents lieux traversés par les personnages, mais aussi de se muer en un espace mental, celui de Wilda, à la fois pris en étau entre deux murs porteurs et ouvert sur un fond d’un noir si profond qu’il peut donner l’occasion aux fantômes de surgir. Sans renverser la table, le metteur en scène détache le texte de Naomi Wallace du réalisme auquel il paraissait, à première vue, ancré pour le propulser dans une dimension aux contours rendus flous par les lumières de Nicolas Marie. Ni franchement réelle, ni tout à fait imaginaire, elle peut alors suggérer que l’action qui se noue n’est que le fruit des élucubrations d’une Wilda en plein délire lié à son sevrage. Une impression renforcée par le jeu tout en variations de la comédienne Catherine Vinatier qui, en tandem avec Marie-Sohna Condé, impeccable dans la peau d’Annette, injecte dans le substrat textuel une dose d’étrangeté. Fidèles ou nouveaux venus dans la troupe du nouveau directeur du CDN de Besançon Franche-Comté, l’ensemble des comédiennes et comédiens parviennent, sans mal, à lui emboîter le pas, et à faire de cette communauté une bande d’écorchés, les pieds enlisés dans les affres du Kentucky, mais la tête relevée en direction des étoiles.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Qui a besoin du ciel
Texte Naomi Wallace
Traduction Dominique Hollier
Mise en scène et scénographie Tommy Milliot
Avec Catherine Vinatier, Marie-Sohna Condé, Joris Rodriguez, Athéna Amara, Pau Cólera, Sarah Le Deunff, Mattéo Renouf, Matthias Hejnar, Miglen Mirtchev
Assistanat mise en scène Matthieu Heydon
Lumières Nicolas Marie
Son Vanessa Court
Costumes Louise Digard
Régie générale et plateau Mickaël Marchadier
Régie lumières Jeanne Laffargue
Régie son Kevin Villena GarciaProduction Man Haast, Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France
Coproduction La Criée – Théâtre national de Marseille, Le Centquatre – Paris, TNN – Théâtre national de Nice CDN, Pôle Arts de la scène – La Friche Belle de Mai Marseille, Châteauvallon-Liberté – Scène nationale, La Passerelle – Scène nationale de Saint-Brieuc
Avec la participation artistique du Jeune théâtre national
Avec le soutien du FIJAD – Fonds d’Insertion pour Jeunes Artistes Dramatiques, du Fond d’insertion de l’Ecole Nationale du Théâtre de l’Union – CDN Limoges, de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – Centre national des écritures du spectacle et l’Aide nationale à la création de textes dramatiques – ArtcenaTommy Milliot est artiste associé à la Comédie de Béthune – CDN Hauts-de-France et au Centquatre – Paris. Man Haast est une compagnie conventionnée par le ministère de la Culture – DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle est soutenue par la Région SUD, le Département des Bouches-du-Rhône et la Ville de Marseille.
Durée : 1h50
Comédie de Béthune, CDN Hauts-de-France
du 10 au 18 janvier 2024Le Centquatre – Paris
du 25 janvier au 10 févrierLa Criée – Théâtre national Marseille CDN
du 3 au 6 avril




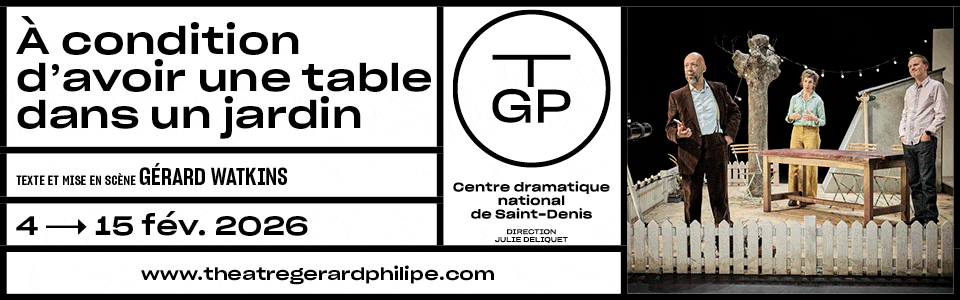








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !