Malgré la performance de Jérémy Lopez, la version du chef-d’œuvre de Racine livrée au Vieux-Colombier par le metteur en scène flamand tend à perdre en rigueur et en grandeur d’âme ce qu’elle gagne en humanité.
Aux spectatrices et spectateurs les plus aguerris, ou simplement fidèles de la Comédie-Française, il ne faudra pas longtemps pour reconnaître la patte de Guy Cassiers. Avant même que la première tirade de Bérénice – « Arrêtons un moment. La pompe de ces lieux, / Je le vois bien, Arsace, est nouvelle à tes yeux » – n’ait retenti, quelques secondes suffisent pour discerner son univers artistique et esthétique si singulier, structuré par cet écran installé en fond de scène qu’on croirait tout droit sorti des Démons de Dostoïevski, qu’il avait adapté il y a un peu plus de trois ans sous les ors de la salle Richelieu. Avec son alliage de (faux) marbre et de néons symbolisant l’encadrement des portes à cour et à jardin, de blocs solidement chevillés au sol et de cloisons amovibles qui dissimulent autant qu’elles révèlent, ce décor froid et sophistiqué transforme le cabinet situé entre l’appartement de Titus et celui de Bérénice en lieu éternel, capable de condenser toutes les époques – l’Antiquité romaine, la Renaissance racinienne, la période contemporaine – en une, indéterminée. Par cet élégant geste scénographique, qui joue avec la double détente temporelle propre à toute représentation moderne du chef-d’oeuvre de Racine – entre les figures antiques et le dramaturge, puis entre son temps d’écriture et nous –, Guy Cassiers rend le trio amoureux qu’il s’apprête à activer le plus universel possible. Mieux, il fait du cabinet d’origine un espace mental où, comme il le dit lui-même, « les paroles semblent être adressées à soi-même, comme si chaque protagoniste, à la recherche de son identité, cherchait à se convaincre personnellement, à se situer dans son rapport au pouvoir et à ses désirs avec les doutes qui l’habitent ».
Présents « depuis des années », selon la vision du metteur en scène flamand, ces « doutes » se trouvent renforcés, et aiguisés, par la nouvelle donne politique : à la suite de la mort de son père, Titus, jusqu’ici libre et fougueux, vient de prendre les commandes de l’Empire, et sent le poids de la raison d’État lui tomber subitement sur les épaules. Alors qu’il avait promis à la reine de Palestine, Bérénice, de l’épouser, le maître de Rome doit encaisser le refus catégorique du Sénat, qui voit d’un très mauvais oeil la perspective d’un hymen entre un dirigeant romain et une monarque étrangère. Profondément heurté par la situation, Titus n’en a pas moins les pieds et poings liés, et n’a d’autre choix, pour espérer conserver sa mainmise politique, et en dépit de son amour, que de répudier sa promise. Incapable de lui dire les yeux dans les yeux, l’homme fait preuve d’une froideur brutale que Bérénice relie, par erreur, à la soudaine confession d’Antiochus : amoureux secret de la reine de Palestine depuis des années, le fidèle ami de Titus vient de se déclarer, suscitant le courroux de Bérénice qui y voit, avant tout, la trahison d’une amitié. Bafoué, éreinté, prêt à mettre les voiles, le prétendant ne tarde pas à se voir confier, par une cruelle ironie du sort, une étrange mission par le nouvel empereur au courage tout relatif : annoncer à Bérénice qu’il la quitte, au risque de voir son monde intérieur s’effondrer.
À ces figures – théâtre racinien oblige –, Guy Cassiers entend, avant toute chose, donner forme humaine afin de rendre le plus palpable possible les tourments qui les étreignent toutes et tous dans un même élan. En parallèle, il semble faire de la lisibilité, voire de la transparence, des émotions, des sentiments et des forces extérieures en présence l’une des conditions sine qua non de sa mise en scène, histoire, sans doute, de ne pas risquer de perdre des spectatrices et des spectateurs dans les méandres de ce chef-d’oeuvre classique. Si ces intentions sont louables, et justes sur le papier, elles supposent l’utilisation de leviers qui, à chaque fois, poussent le curseur un peu trop loin. Tandis que le décor, une fois posé, ne gagne pas suffisamment en organicité pour devenir véritablement efficient, la volonté de rendre la langue racinienne la plus naturelle possible – en oubliant que l’alexandrin, lorsqu’il est correctement maîtrisé, impose un rythme qui s’avère déjà le plus proche du langage parlé – sacrifie une large partie de sa musicalité intrinsèque et, ce faisant, de sa beauté et de sa magnificence. À l’avenant, la direction d’actrices et d’acteurs, tout comme le recours à la musique et aux sons composés par Jeroen Kenens, souligne, voire surligne, les intentions de chacun des personnages, nimbés dans un surplus de théâtralité qui se révèle très rapidement contre-productive. Résultat : ce que Bérénice, Titus et Antiochus gagnent en humanité, ils tendent à le perdre en grandeur d’âme ; et ce que le texte gagne en lisibilité et en proximité, il tend à le perdre en rigueur et en mystère.
Ce constat est d’autant plus regrettable que les comédiens-français avaient sans aucun doute, au vu du talent qu’on leur connaît, toutes les cartes en main pour faire briller, sans en forcer le trait, ce joyau classique. À l’épreuve du plateau, Jérémy Lopez apporte d’ailleurs du crédit à cette hypothèse. Malgré la volonté de Guy Cassiers de lui faire endosser les rôles de Titus et d’Antiochus – une idée intellectuellement séduisante dans sa façon de réunir les deux faces d’un même symbole, mais plus hasardeuse dans son exécution, notamment lorsque les deux personnages dialoguent ensemble avec, d’un côté, un Jérémy Lopez de chair et d’os et, de l’autre, un figurant qui agite les bras au rythme de la voix pré-enregistrée de l’acteur –, le comédien s’avère convaincant, et parfois même bouleversant, tout particulièrement dans la dernière scène de la pièce où, à genoux, au bord de la scène, tel un précipice, Antiochus comprend que le destin de son sentiment amoureux est définitivement scellé. En regard de cette performance, ses camarades de jeu apparaissent plus à la peine : Clotilde de Bayser n’offre jamais suffisamment de consistance au personnage de Phénice ; Alexandre Pavloff ne cesse de cabotiner sous les traits de Paulin et d’Arsace qu’il incarne en parallèle ; et Suliane Brahim donne de Bérénice une image de reine (un peu trop) instable, (un peu trop) naïve et (un peu trop) soumise. Preuve, là encore, qu’au théâtre comme ailleurs, il est avant tout question de juste dosage.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Bérénice
de Jean Racine
Mise en scène Guy Cassiers
Avec Alexandre Pavloff, Clotilde de Bayser, Suliane Brahim, Jérémy Lopez, Pierre-Victor Cabrol
Scénographie Guy Cassiers, Bram Delafonteyne
Costumes Anna Rizza
Lumières Frank Hardy
Vidéo Bram Delafonteyne, Frederik Jassogne
Musique originale et son Jeroen Kenens
Assistanat à la mise en scène Robin Ormond
Assistanat au son Samuel Robineau de l’académie de la Comédie-Française
Réalisation du décor Le Grand T, théâtre de Loire-AtlantiqueAvec le généreux soutien d’Aline Foriel-Destezet, grande ambassadrice de la création artistique
Avec le mécénat de l’entreprise Essayons de simplifierDurée : 1h50
Comédie-Française, Théâtre du Vieux-Colombier, Paris
du 26 mars au 11 mai 2025Maison des Arts de Créteil
les 14 et 15 maiL’Onde Théâtre Centre d’Art, Vélizy-Villacoublay
le 20 maiThéâtre national de Budapest (Hongrie), dans le cadre du festival Mitem
le 12 juin
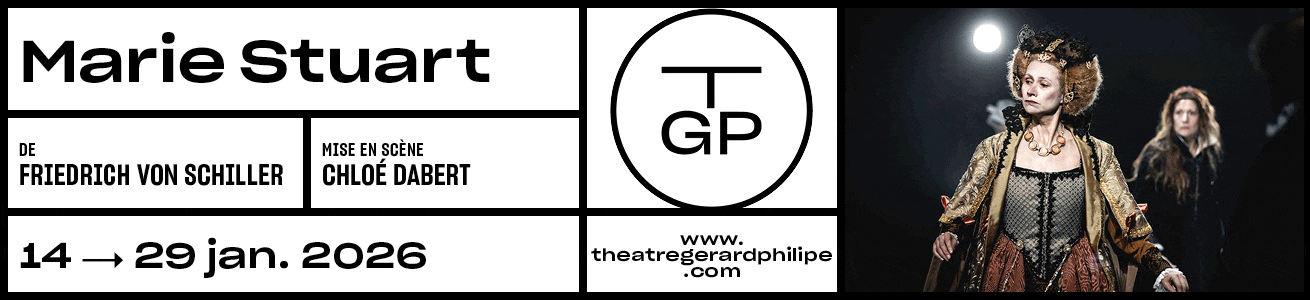

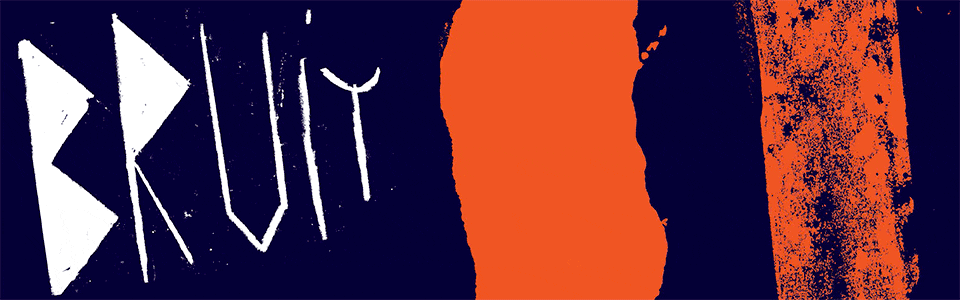


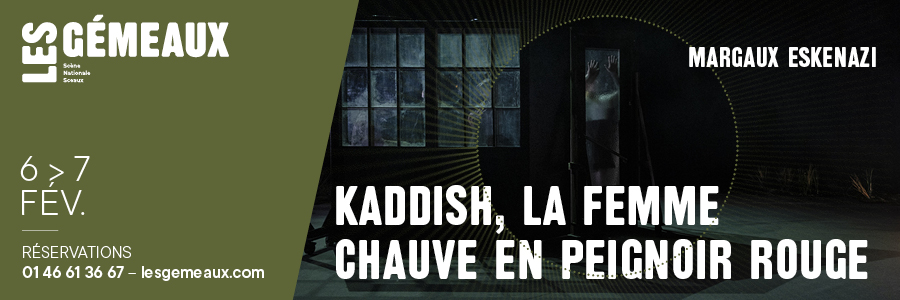








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !