
Photo Christophe Raynaud de Lage
Créée en novembre 2021 au Théâtre de la Manufacture à Nancy, et reprise lors du 77e Festival d’Avignon, Carte noire nommée désir, arrive aux Ateliers Berthier de l’Odéon. La performeuse mène sa troupe de guerrières à travers un spectacle qui force à se poser la question du racisme systémique de nos sociétés blanches et occidentales.
Dans cette version de Carte noire nommée désir, vous êtes huit femmes au plateau, telles une armée de guerrières. Pourquoi ce choix d’autant d’interprètes ?
C’est d’abord une idée financière. C’est important pour moi qu’il y ait d’autres femmes noires qui s’enrichissent. Les droits d’auteur de ce spectacle sont partagés. Ce n’est évidemment pas un partage 50-50, mais cela crée une vraie différence financière pour elles. On a commencé à huit, face au monde, mais il s’avère que c’est quand même ma personne qui prend le dessus. Face à cette starification, il y a une question qui apparaît : je suis martiniquaise et il reste, par rapport aux autres femmes africaines, une forme de domination, notamment en matières d’acceptation en France, de colorisme, d’éducation. Je n’ai pas envie de m’approprier les vécus des personnes qui ont des modes de vie plus stigmatisés. Dans la pièce, je voulais avoir de la divergence : des filles du groupe bossent dans le social, d’autres dans la musique classique, le cirque ou la performance. Cette mixité nous ouvre des portes et ramène plus de gens pour être forts avec nous. Car il faut cette force sur scène, mais aussi en salle ; car jouer ce genre de spectacle, c’est dur physiquement et humainement [quatre représentations ont été perturbées par l’agression d’une actrice par un membre du public au festival d’Avignon, NDLR].
Cette édition du Festival d’Avignon se voulait plus inclusive, avec une programmation plus ouverte à la performance et aux créations engagées. Avez-vous l’impression que les choses changent ?
Je viens au Festival depuis que j’ai 18 ans et je trouve qu’il y a plus de jeunes concernés et engagés notamment dans le OFF. Il y a aussi plus de personnes racisées et queers dans les rues. J’avais très peur que, lorsqu’on joue Carte noire, il n’y ait aucune personne noire dans le public, et en fait si. Ces dernières années, on a programmé des artistes africains ou américains, et cette année on a des artistes français. Il y avait Léonie Pernet dans la cour du lycée Saint-Joseph, qui est une noire gouine. Sa présence me donne de la force.
Dans vos pièces vous parvenez à concilier des individualités différentes et très riches. Dans Carte noire, vous travaillez avec une céramiste, une circassienne… Dans Où la chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, certaines acteurices sont aussi footballeur.euse.s. Comment organisez-vous le travail avec toutes ces personnes différentes?
C’est une petite science. Avoir accompagné des gens à la formation, dans l’animation, dans les ateliers est une force. Pendant douze ans, dans un petit village de Picardie, j’ai animé des ateliers pour enfants en bas âge, avec des personnes en situation de handicap, avec des parcours ouvriers, ou encore avec des profs à la retraite. Je prends les gens là où ils sont dans leur vie et je les amène où je veux. L’idée c’est de trouver à chaque fois le bon écrin pour chacun et d’être très à l’écoute. Pour ça, il faut vraiment se respecter, prendre soin, établir un lien de confiance fort. Dans mes spectacles, on construit les choses ensemble. Pour moi, c’est ça la performance, c’est faire que les personnes soient maîtres et décisionnaires de leurs actes.
Comment est-ce que vous créez ensemble ? Est-ce une écriture de plateau dans laquelle vous partez des improvisations de chaque personne?
Je fais souvent des brainstormings, je lis, je prends des notes ; puis, je demande aux actrices de préparer des performances. On passe par des ateliers de maquillage, des temps d’entretien durant lesquels on se questionne. On établit aussi un moment de jeu pendant lequel je place des éléments de scénographie pour voir comment les gens s’en saisissent. Ensuite, c’est moi qui écrit la performance. Pour Carte noire, il fallait vraiment que les 45 minutes du début soient une performance en soi. On l’a déjà performé seule, de manière isolée. J’incarne vraiment le paradoxe du spectacle : je suis noire, mais j’ai grandi en France, alors il y a en moi un « white gaze » et une culture blanche. Et dans cette France blanche, très cadrée, administrative, qui valorise tant le travail, où suis-je ? Où me place-t-on ? Je suis celle qui va prendre soin, s’occuper des enfants des autres, soigner les vieux, les personnes en situation de handicap… Celle qui prend soin des autres sans jamais prendre soin de soi. Et on voulait que tout ça soit dit dans la performance.
Avez-vous des figures inspirantes qui habitent vos spectacles et votre travail ?
Dans le travail théâtral, j’ai été fortement portée par Rodrigo Garcia. Le fait que ses pièces soient sur-titrées m’a, par exemple, permis de développer un rapport au théâtre en forme de mélange d’écriture, de lecture et de jeu sur le plateau. Évidemment, la performeuse Marina Abramović, qui m’a autorisé une certaine forme de violence, comme quelque chose de libérateur et d’artistique. Je pense aussi à Jan Fabre. Même si je ne soutiens pas les choses qu’il a commises auprès de ses interprètes, il m’a montré que les choses pouvaient être doubles : attirantes et dégoûtantes à la fois. Et que c’était ça le réel et l’humain. Politiquement, j’ai adoré ce que j’ai vécu au camp d’été décolonial, organisé par la militante afroféministe Fania Noël et la journaliste Sihame Assbague et réservé uniquement aux personnes subissant à titre personnel le racisme d’État en contexte français. Les militants dans les domaines qui m’intéressent sont des grandes sources. Tous ces gens qui parviennent à poser de la pensée m’impressionnent.
Vous avez vu la pièce-performance de l’artiste brésilienne Carolina Bianchi, A Noiva e o Boa Boite Cinderela. Son travail résonne-t-il avec le vôtre ?
Je suis sortie de la pièce et je me suis dit : « Carte noire, c’est pour les bébés ! ». Ce spectacle m’a permis de m’interroger et m’a fait penser à l’artiste espagnole Angélica Liddell, dans cette impudeur et cette prise de risque, mais avec un groupe qui est derrière, qui cautionne et qui accompagne. Je me suis posée la question de la résistance du corps et de ce qu’on s’inflige à soi-même, et cela fait écho à mon travail. J’ai aimé le profond malaise qu’elle crée. Peut-être parce que je viens d’une famille qui retient plus les choses traumatiques et négatives. Et elle travaille un sujet qui me fascine. Je suis la première à regarder « New York Unité spécial viol » pendant 23 saisons, ou à écouter uniquement des épisodes d’Affaires sensibles [une émission de France Inter, NDLR] sur les viols et les agressions. Il y a une forme de fascination morbide pour ces choses qui pourraient m’arriver, qui me sont arrivées ou qui arrivent à mon entourage. Et bien sûr Carolina Bianchi fait référence à l’histoire de la performance féminine, portée par des femmes. Avec son spectacle, elle me dit : « Tu as des compagnes partout, qui font les mêmes choses que toi ». Ce spectacle m’a vraiment reboostée, et m’a autorisée à donner de la lumière à des endroits si sombres de nous-mêmes.
Vous avez un rapport à l’écriture très personnel, très poétique…
Je n’ai jamais tellement lu de poésie, j’ai commencé il y a un an. J’ai aimé la poésie par le théâtre, par Racine notamment. J’adore les figures de style et j’aime la musique. Surtout les paroles. Je ne peux pas aller danser si je ne connais pas les paroles d’une chanson. On m’appelle Jukebox car je connais tout. Je pense que les mots ont une grande importance. La poésie est apparue par nécessité, pour que mon cerveau hyperactif puisse s’exprimer. Maintenant, je m’intéresse aux poétesses, aux poètes trans. Ils repoussent les choses très loin, jusqu’à l’édition avec de nouveaux matériaux, en désacralisant le rapport aux livres, en faisant des fanzines, en distribuant des textes. Ils créent un nouveau rapport à l’autorat, qui est beaucoup plus libre. Ma participation au collectif d’auteurices RER Q m’a fait entrevoir un espace dans lequel on existait en tant que groupe.
Vous parliez d’un esprit en arborescence. Est-ce pour cette raison que vous travaillez sur des supports différents ? Pour exprimer au mieux votre créativité ?
J’ai une tendance à aimer large, à vouloir tout avaler, pour filer les métaphores culinaires que j’apprécie tant. J’ai une grande gourmandise à tout apprendre : j’ai fait un stage de céramiste, j’aurais adoré être circassienne ou savoir chanter et danser. Ce sont des outils que j’aimerais posséder. J’étais très heureuse de travailler avec le chorégraphe congolais DeLaVallet Bidiefono, que j’avais rencontré à Avignon en 2013 avec son spectacle Au-delà. Quelques années plus tard, il m’a confié l’écriture d’un spectacle avec des danseurs et j’y suis allée sans préparation physique. Je me suis dit : « Je suis performeuse, j’en suis capable ». Mais c’étaient des athlètes de la danse et moi j’étais là, avec mon corps de 115 kilos, à faire des sauts avec eux. Je me suis défoncée le corps. Mais j’étais heureuse de me dire que j’avais fait de la danse contemporaine. Mon œil pioche des inspirations partout, à la télé, dans les publicités, et ensuite il régurgite. Je m’en fous que ce ne soit pas parfait.
Propos recueillis par Chloé Bergeret – www.sceneweb.fr




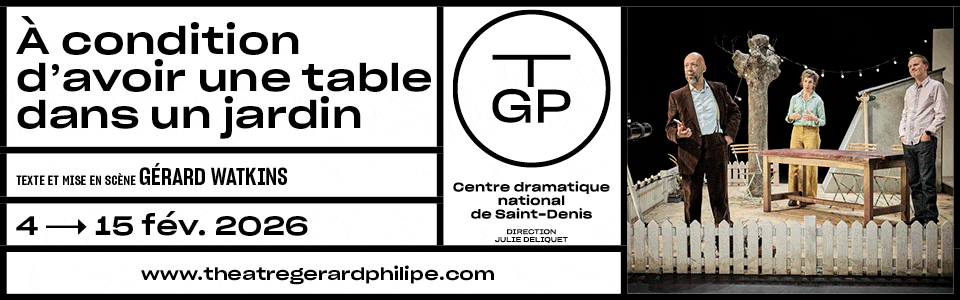








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !