En réunissant le texte d’Ibsen et la musique de Grieg, Olivier Py met en scène Peer Gynt dans une version qui, à l’instar de son héros pressé, se veut haletante et resserrée, quitte à passer un peu en force.
Pour sa première création en tant que directeur du Théâtre du Châtelet, Olivier Py a choisi de monter Peer Gynt, la grande fresque épique du dramaturge norvégien Henrik Ibsen. Un véritable défi pour l’artiste certes bien habitué aux spectacles au long cours, qu’ils soient le fruit de son propre imaginaire fertile d’auteur – la représentation de La Servante, l’une de ses premières pièces, durait 24 heures – ou bien la traduction scénique de textes antiques (L’Orestie d’Eschyle) et modernes (Le Soulier de satin de Claudel). Après de tels marathons théâtraux, Peer Gynt pourrait presque passer pour une sinécure. Pourtant, la pièce d’une durée de sept ou huit heures, lorsqu’elle est jouée dans son intégralité, relate le cheminement initiatique de son héros éponyme parcourant le monde pour assouvir ses rêves de grandeur et chercher sa véritable identité.
Compte tenu de son ampleur, l’œuvre si belle, et en même temps si intrigante, est aussi un défi pour son interprète principal. À la rencontre d’un rôle aussi savoureux que potentiellement écrasant, Bertrand de Roffignac se montre parfaitement dans son élément. Révélé en Arlequin-livreur de pizza dans Ma jeunesse exaltée, il est désormais Peer, le rêveur vagabond, un peu poète, un peu bandit, à qui il donne l’aspect d’un éternel gavroche qui ne tient jamais en place. Jeu à la fois explosif et au cordeau, d’une énergie folle qui ne s’essouffle jamais, il campe un Peer plus physique que métaphysique, tant constamment il bondit, tourbillonne, court, chute et rebondit, sans non plus être dépourvu d’âme et d’humanité, notamment dans son rapport avec sa mère, l’Aase superbe de force comme de tendresse de Céline Chéenne – sa mort donne le frisson –, et avec la Solveig de Raquel Camarinha, dont le jeu et le chant délicats incarnent l’amour absolu et l’inconditionnel dévouement.
Si l’œuvre fait pénétrer dans un imaginaire profus et incongru, l’espace mobile imaginé par Pierre-André Weitz plonge le plateau dans une tonalité massivement noire qui se décline sur les pans de murs de maisons hautes et pointues, et qui s’apparente autant au songe qu’au cauchemar. C’est ce qu’Olivier Py suggère au moyen d’une idée toute simple et fort poétique, celle de poser à la rampe un manège miniature dont les figurines, éclairées et agrandies dans leurs projections sur le fond de scène obscur, donnent vie à de géantes créatures fantastiques. Comme les ampoules vacillantes suspendues à des fils qui descendront des cintres, l’installation rappelle le théâtre d’ombres de Christian Boltanski et convoque la mémoire de l’enfance, des fantômes. Peer Gynt se place ainsi sous les signes de la disparition et la déraison.
Des chimères, la pièce en compte nombre : les vachères s’assument comme les revisites sous un mode dégradé des wagnériennes filles du Rhin en haillons sales ; les trolls sont quant à eux représentés en horde carnavalesque d’une inquiétante étrangeté, livrant un ballet horrifique dans un décor de music-hall douteux, comme les affectionne Olivier Py. D’autres figures, tels que des soiffards endimanchés qui font la queue leu leu dans la noce à neuneu d’Ingrid et Mads Moen, des cortèges d’esclaves du désert, de drôles de chimpanzés ou de fous aliénés, peuplent un chemin long et cahoteux qui fait revenir Peer sur sa terre natale, éplucher un oignon et voir redéfiler ses multiples vies.
On pourrait reprocher à la mise en scène présentée un excès de littéralité, et quelques facilités. Mais le travail d’Olivier Py exclut le folklorisme, tout en faisant preuve d’une grande fidélité aussi bien à l’égard du texte, même retraduit et adapté dans une langue assez crue, qu’à l’égard de la superbe partition composée par Grieg à partir de la pièce. L’un et l’autre, quasiment tout le temps désolidarisés, sont, à son initiative, bien réunis et défendus. Les musiciens de l’Orchestre de Chambre de Paris, dirigés par la cheffe estonienne Anu Tali, les acteurs, chanteurs, danseurs passant formidablement d’un rôle à l’autre, toutes et tous font régner un réjouissant esprit de troupe mû par une profonde générosité à restituer, à la fois, la beauté, la cruauté, la profondeur et la trivialité d’un tel poème scénique et musical au propos existentiel. Si le Grand Courbe exhorte Peer à faire un détour, Py et sa bande semblent bien s’en garder. Leur Peer Gynt se donne d’une manière assez brute, sans ambages, d’un seul trait, et va droit au but, à commencer par celui de plaire, bousculer, faire réfléchir et rêver.
Christophe Candoni – www.sceneweb.fr
Peer Gynt
Livret Henrik Ibsen
Adaptation du texte et mise en scène Olivier Py
Musique Edvard Grieg
Direction musicale Anu Tali
Avec Damien Bigourdan, Clémentine Bourgoin, Pierre-Antoine Brunet, Raquel Camarinha, Céline Chéenne, Emilien Diard-Detœuf, Marc Labonnette, Justine Lebas, Pierre Lebon, Lucie Peyramaure, Olivier Py, Bertrand de Roffignac, Sevag Tachdjian, Hugo Thery
Orchestre de Chambre de Paris
Décors et costumes Pierre-André Weitz
Lumières Bertrand Killy
Création sonore Stéphane Oskeritzian
Chorégraphe et assistant à la mise en scène Ivo Bauchiero
Assistant à la direction musicale Quentin Hindley
Assistant décors Clément Debras
Assistant costumes Mathieu Crescence
Stagiaire à la mise en scène Hugo Thery
Pianistes répétiteurs et chefs de chant Vincent Leterme, Benjamin LaurentProduction Théâtre du Châtelet
Coproduction Orchestre de Chambre de Paris pour les représentations au Théâtre du ChâteletDurée : 3h50 (entracte compris)
Théâtre du Châtelet, Paris
du 7 au 16 mars 2025





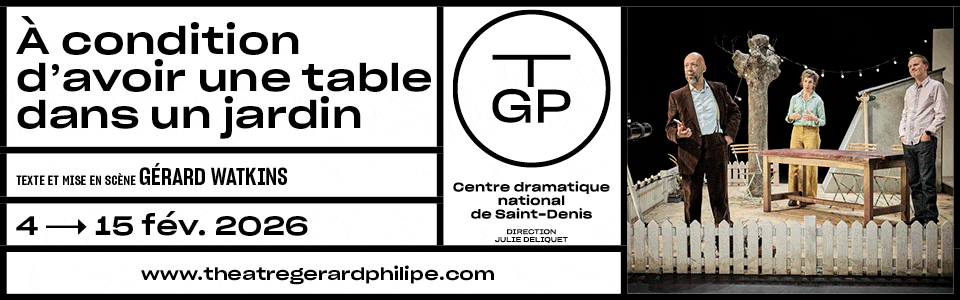







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !