Au Festival d’Avignon, l’artiste autochtone Émilie Monnet présente une variation chorale et performative autour de l’histoire et de la figure de Marguerite Duplessis, mais ne parvient pas à transformer ses intentions politiques éminemment louables en geste théâtral suffisamment puissant.
C’est au détour d’une rue, à la faveur du hasard, qu’Émilie Monnet a croisé, il y a une dizaine d’années, la route de Marguerite Duplessis. Alors qu’elle vient de s’installer à Montréal, l’artiste et activiste autochtone, d’origine anichinabée par sa mère et française par son père, découvre, à l’occasion d’une visite guidée, une petite plaque commémorative, apposée dans une rue transversale du quartier historique de l’agglomération québécoise, où figure le nom de cette femme esclave du XVIIIe siècle. Pour elle, l’occasion est trop belle de remonter le cours de l’Histoire et de plonger, à la demande des commissaires autochtones du Canada, dans le récit de vie de celle que d’aucuns décrivent comme une « héroïne oubliée ». À partir de cette figure, Émilie Monnet imagine alors une « triade » composée d’un « parcours sonore et performatif » dans les lieux de mémoire du Vieux-Montréal (Marguerite : la pierre), d’une série de podcasts (Marguerite : la traversée) et d’un spectacle, Marguerite : le feu, qui, après avoir franchi l’Atlantique, débarque dans la programmation du 77e Festival d’Avignon.
Installées à la proue d’un bateau sur le plateau du Théâtre Benoît-XII, Anna Beaupré Moulounda, Catherine Dagenais-Savard, Tatiana Zinga Botao et Émilie Monnet elle-même unissent leurs forces pour exhumer des oubliettes historiques le destin tragique de cette femme qui, à l’âge d’à peine 22 ans, refusa de monter dans le navire marchand qui devait la conduire en Martinique à la demande de son maître, Marc-Antoine Huart Dormicourt. Enfermée dans une geôle de la prison de Québec, mystérieusement épaulée par le praticien Jacques Nouette, Marguerite Duplessis entame alors un combat judiciaire pour recouvrer sa liberté en arguant qu’elle est née d’un père français et d’une mère autochtone libre. Pour la première fois de l’histoire de la Nouvelle-France, une esclave, qui n’a à cette époque que le statut d’objet, ose mettre en branle la machine judiciaire de cette province française. Las, après quelques semaines de procédure, Marguerite Duplessis est bel et bien reconnue, à travers une ordonnance de l’intendant Gilles Hocquart, comme la propriété de Marc-Antoine Huart Dormicourt, et même condamnée aux dépens. À partir de cette sentence, l’Histoire se révèle tristement silencieuse, et perd la trace de la jeune femme, très vraisemblablement déportée.
Pour redonner ses lettres de noblesse au juste combat de cette pionnière, Émilie Monnet n’a pas choisi la voie, sans doute trop évidente, du théâtre documentaire. Si elle ne manque pas de s’appuyer sur une série de documents historiques et juridiques, des lettres aux extraits de plaidoiries, en passant par les décisions de justice et les textes de lois, elle préfère, en adéquation avec son habituel travail pluridisciplinaire qui mêle la vidéo, le théâtre et les arts médiatiques, orchestrer une variation chorale et performative où chaque comédienne apporte sa pierre, et notamment sa voix, à l’édifice pour tenter de transcender l’aridité de ces écrits. D’entrée de jeu, cette composition scénique et textuelle permet à Émilie Monnet de relier l’histoire de Marguerite Duplessis avec le sort des femmes autochtones contemporaines, dont les meurtres et les disparitions en série ont justifié, à la demande de nombreuses associations, la mise en place d’une enquête nationale au Canada. Dès les premières minutes, Marguerite : le feu prend alors une dimension politique, éminemment louable dans ses intentions, mais qui peine, sur la durée, à passer l’épreuve de la scène.
Nourrie de références musicales, vocales et chorégraphiques issues de la culture des Premières Nations, pétrie d’allusions au Québec – à l’image des différents noms des Premiers ministres québécois et des patronymes des familles anciennement propriétaires d’esclaves panis, encore très courants aujourd’hui, égrenés durant de longues minutes –, la performance semble broder autour de son sujet, plutôt que de l’embrasser à bras-le-corps, sans doute handicapée par les nombreuses zones d’ombre qui demeurent dans la trajectoire de Marguerite Duplessis. Malgré l’engagement des comédiennes, Tatiana Zinga Botao en tête, et l’intensité de leur jeu, le geste théâtral d’Émilie Monnet, en forme de show faiblard, ne parvient jamais à atteindre ses ambitions, et à être à la hauteur de sa prétention, celle de déciller le regard de ses contemporains, de faire sortir de l’oubli les ravages de la colonisation, alors qu’ils ont, encore aujourd’hui, des conséquences bien réelles.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Marguerite : le feu
Texte Émilie Monnet
Mise en scène Émilie Monnet, Angélique Willkie
Avec Anna Beaupré Moulounda, Catherine Dagenais-Savard, Émilie Monnet, Tatiana Zinga Botao
Traduction pour le surtitrage Elaine Normandeau
Dramaturgie Marilou Craft
Collaboration à la mise en scène Mélanie Demers
Musique Laura Ortman, Frédéric Auger
Scénographie Max-Otto Fauteux
Lumière Julie Basse
Vidéo Caroline Monnet
Son Frédéric Auger
Arrangements chant Dominique Fils-Aimé
Chant pow wow Black Bear Singers
Costumes Korina Emmerich, Yso
Assistanat à la mise en scène Érika Maheu-Chapman
Voix Dominique Cyrille
Intégratrice vidéo Dominique HawryProduction Productions Onishka
Coproduction Espace Go
Avec le soutien de Fonds national de création du Centre national des arts, Fondation Cole, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Montréal, Conseil des arts et des lettres du Québec, programme Territoire Création Théâtre de la Ville (Canada), Théâtre du Bic (Canada), Théâtre Hector-Charland (Canada), Émergence théâtrale autochtone du Centre des auteurs dramatiques en partenariat avec la Fondation Cole
Résidences Théâtre Le Diamant (Canada), Centre du Théâtre d’Aujourd’hui (Canada), École nationale de Théâtre du Canada, Salon 58Durée : 1h10
Vu au Festival d’Avignon 2023
du 14 au 18 janvier 2025
Le Grand T, Nantes






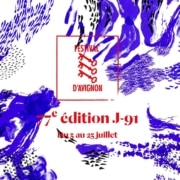




Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !