L’artiste belge Claude Schmitz continue de creuser le sillon qu’il avait entrouvert avec son film Lucie perd son cheval. Au long d’un vrai-faux songe horrifique, tel un conte aux allures de thriller, il interroge les modalités du récit, la fabrique de l’art dramatique et les motivations de ses artisans.
Sans doute parce qu’on ne s’attendait pas à les retrouver là, on a d’abord eu du mal à les reconnaître. Lui, Francis, le directeur technique faussement bourru ; elle, Nao, la blondinette attachante et volubile. Et puis, elle est arrivée, son armure à nulle autre pareille sur le dos, pour enlacer cette petite fille qui lui avait visiblement tant manqué, et toutes les pièces du puzzle se sont imbriquées. Avec ce court métrage qui sert de prologue à son dernier spectacle, Le Garage inventé, Claude Schmitz reprend là où il s’était arrêté. L’artiste belge s’inscrit à la suite de son délicieux film Lucie perd son cheval qui, en 2021, avait lui-même servi de dérivatif cinématographique à sa précédente pièce, Un Royaume, dont la création et la diffusion avaient été méchamment percutées par la crise du Covid-19. Dans ce long métrage aussi loufoque que déroutant, une comédienne se mettait, à la faveur d’un rêve, littéralement en route vers son prochain rôle de chevaleresse. Équipée d’une épée et d’une armure en bonne et due forme, elle ne tardait pas à croiser la trajectoire de deux homologues, avant d’atterrir dans un théâtre fermé à double tour où une troupe confinée tentait de répéter Le Roi Lear. Cette interrogation sur la difficile unicité des êtres, sur les tiraillements qui peuvent exister entre les aspirations hétérogènes, et parfois conflictuelles, d’une femme, d’une mère et d’une actrice, Claude Schmitz la poursuit, l’amplifie et l’augmente dans Le Garage inventé.
De retour sous le soleil brûlant des Cévennes, dans cette communauté adepte du zazen – cette pratique de la méditation du bouddhisme zen – où officie sa mère, Lucie sait qu’à peine sa fille retrouvée, elle devra à nouveau la quitter, et la laisser sous la surveillance de Francis, pour partir travailler sur un autre projet. Tandis qu’elle va se coucher, la jeune femme se retrouve, dès les premières secondes de son sommeil, téléportée dans un garage pour le moins vétuste, et le cinéma cède alors sa place au théâtre. Sur le plateau, désormais débarrassé de tout écran, se découvre un lieu austère et lugubre, sombre et inhospitalier, où tout transpire la saleté, du sol aux fenêtres. L’endroit est à l’image de son inquiétant patron, sorte de tyran mécanique qui fixe des règles pour le moins étranges : il interdit à quiconque de répondre à un téléphone qui n’en finit plus de sonner, et intime l’ordre à son mécano, Didier, de ne pas toucher un seul boulon de cette Dodge Charger à laquelle il semble tenir plus que tout.
Au lieu de réparer les voitures, l’homme doit passer son temps à débarrasser un buffet pour mieux en préparer un autre, celui du mariage annoncé entre Lucie, devenue Verte, et le patibulaire patron. De fil en aiguille, on comprend bien vite que la fiancée n’est pas la première du genre et que le despote, tel un Barbe Bleue des temps modernes, a déjà usé six épouses avant elle, au nez et à la barbe des autorités. La dernière en date, Violette, lui conte d’ailleurs, avec sa voix venue d’outre-tombe, l’histoire originelle, celle de Rose qui, alors que la fête de mariage battait son plein, a répondu au bruyant téléphone, avant de prendre la fuite. Furieux, son mari l’a poursuivie en voiture, et l’a renversée tandis qu’elle marchait sur le bord de la route. Depuis, la situation, telle une malédiction, se répète à chaque fois que des noces sont célébrées. Pour briser le cercle infernal, Violette conseille à Verte de saboter la Dodge Charger car, résume-t-elle, « pas de voiture, pas de mariage ; pas de mariage, pas de tragédie ».
Plus intéressé dans son travail récent par la fabrique que par le résultat, par les outils que par le produit fini, par les modalités du récit que par l’histoire à proprement parler, Claude Schmitz ne tarde pas à faire pousser sur ce conte aux allures de thriller une ramification métathéâtrale, proche de celle développée dans Lucie perd son cheval, où la pièce devient une immense séance de répétitions. Désormais associé au Théâtre de Liège et à la Comédie de Caen, le metteur en scène belge brouille toutes les frontières, celles entre le songe et le réel, entre la fiction et la réalité, entre les personnages et les comédiennes et comédiens qui les incarnent – et qui portent pour la majorité d’entre eux le même prénom que leur double fictionnel – jusqu’à leur, et nous, faire perdre la tête.
Sans totalement disparaître, en faisant même irruption dans le réel pour mieux le perturber, et influer sur lui, l’histoire du garage est alors mise à distance au profit d’une exploration de la confection de ce même récit et des motivations de ses artisans. Comme s’il souhaitait reprendre le dialogue avec le metteur en scène de Lucie perd son cheval qui assénait « Le théâtre c’est de la merde, faut juste être là », Claude Schmitz répond, très précisément, qu’une actrice, en l’occurrence, ne peut pas toujours, et justement, « être là », qu’elle peut aussi être une mère pétrie par le manque de sa fille, mais également une femme en proie aux doutes par rapport au rôle qu’elle incarne, celui, une nouvelle fois, et comme tant de comédiennes avant elle, d’une victime, ce qui la poussera à claquer la porte. Comme si, s’il est communément admis que le réel influence la fabrique de l’art, l’inverse était tout aussi vrai.
Cette voie, l’artiste ne la trace pas avec un langage dramaturgique aimable, limpide, linéaire, mais plutôt avec un récit qui, sans être totalement fragmentaire, opère par une série de glissements successifs entre lesquels les spectatrices et les spectateurs sont invités à se faufiler pour tricoter leur propre lecture. Surtout, il use d’une grammaire scénique qui, jusque dans les moindres recoins, enrichit son propos. Dans Le Garage inventé, le texte et le jeu des comédiennes et comédiens sont des rouages tout aussi importants que la lumière, le son ou les différents éléments de décor – on notera d’ailleurs l’étonnante présence d’une colonne et d’une statue grecques au milieu du fatras mécanique – pour non pas seulement colorer, mais bien faire progresser la narration. Innovant, sans être révolutionnaire, ce procédé donne au spectacle une séduisante dimension expérimentale, un côté réalisme magique qui sied parfaitement à l’ambiance à mi-chemin entre le film d’horreur et le conte fantastique. Et prouve que Claude Schmitz est, non sans quelques risques, décidément du côté de celles et ceux qui osent.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Le Garage inventé (qui restaure la mécanique et les rêves)
Mise en scène Claude Schmitz
Avec Lucie Debay, Marc Barbé, Francis Soetens, Lorenzo de Angelis, Louise Leroy, Didier Duhaut, Fantazio
Collaboratrice artistique Lucie Debay
Dramaturgie et assistanat à la mise en scène Judith Longuet-Marx
Scénographie Clément Losson
Accessoiriste Caroline Sarah Faust
Costumes Alexis Beck
Création lumière Amélie Géhin
Assistant à la création lumière Lionel Ueberschlag
Création son Thomas Turine
Régie générale Baptiste Wattier
Construction décors Ateliers du Théâtre de Liège
Réalisation costumes Ateliers du Théâtre de LiègeProduction Théâtre de Liège, DC&J Création et Paradies
Coproduction Théâtre National Wallonie-Bruxelles, Théâtre Populaire Romand de la Chaux-de-Fonds, MC2 : Grenoble, la Comédie de Caen – CDN de Normandie, la Comédie de Genève
Soutien Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique et Inver Tax Shelter
Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Service ThéâtreDurée : 2h10
Vu en septembre 2024 au Théâtre de Liège
Comédie de Caen – CDN de Normandie
les 16 et 17 octobreMC2: Grenoble
les 21 et 22 novembreThéâtre Populaire Romand de la Chaux-de-Fonds
les 28 et 29 novembreComédie de Genève
durant la saison 2025-2026
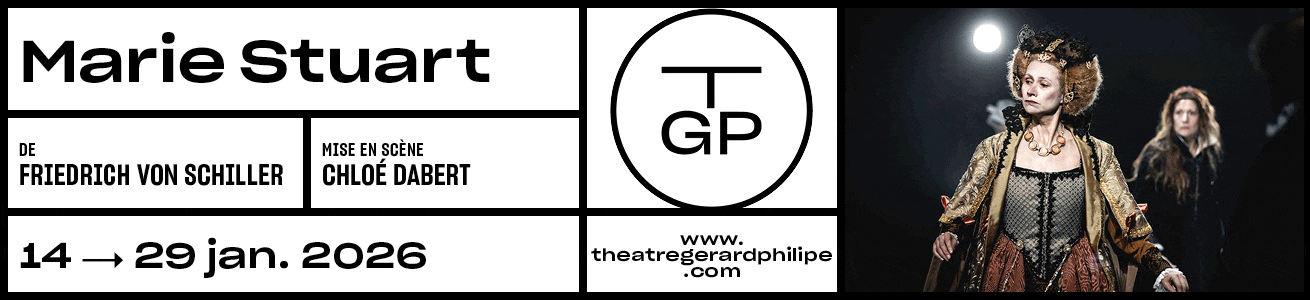

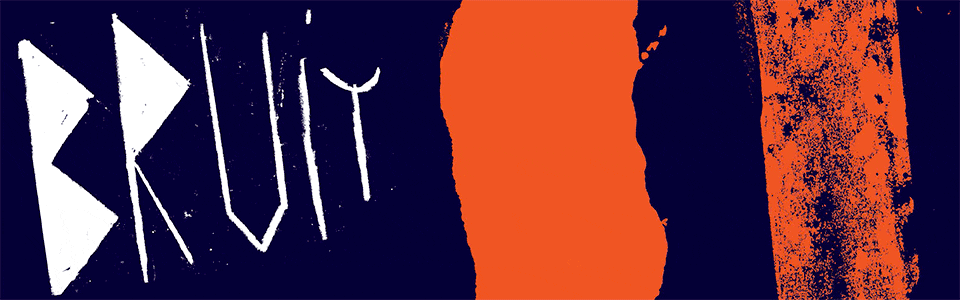


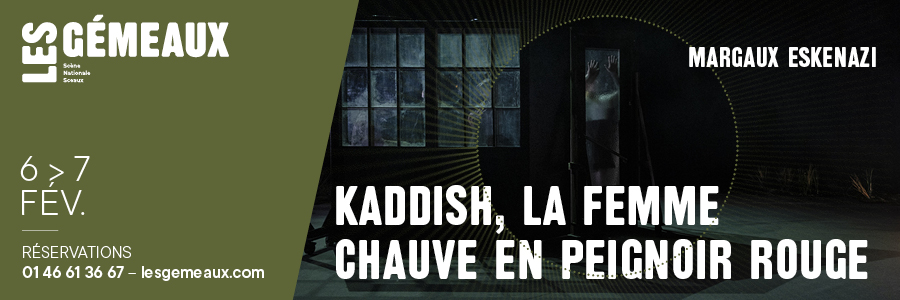
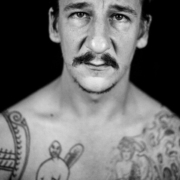







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !