Koulounisation, aborde le passé franco-algérien sous la forme d’une enquête sur les mots de la colonisation. Une recherche passionnante, portée par le désir d’inventer une forme singulière de théâtre documentaire, qui perd toutefois un peu de sa force lorsqu’elle s’aventure trop dans l’intime.
Comme bien des enfants d’Algériens nés en Europe, Salim Djaferi n’a hérité de ses parents qu’une mémoire à trous et une langue approximative, un arabe que les Arabes comprennent mal et dont ils se moquent parfois. Comme Naïma, le personnage central de L’Art de perdre d’Alice Zeniter, l’Algérie a pourtant toujours été là pour lui. Les mots de l’héroïne, au début de ce roman multi-primé consacré aux conséquences des non-dits de la guerre d’Algérie sur les nouvelles générations, auraient pu être ceux de Salim Djaferi. Pour l’acteur, auteur, performeur et metteur en scène belge formé à l’ESACT – Conservatoire Royal de Liège comme pour le personnage de fiction, « l’Algérie a toujours été là, quelque part », comme « une somme de composantes : son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs ». De même que la protagoniste d’Alice Zeniter et que bien d’autres personnes réelles ou imaginées – au théâtre, on pense par exemple à Au milieu de l’hiver, j’ai découvert un invincible été d’Anaïs Allais, à Amer M. et Colette B. de Joséphine Serre ou encore à Points de non-retour [Quais de Seine] d’Alexandra Badea –, Salim Djaferi mène l’enquête.
L’angle qu’il choisit dans Koulounisation prouve sa conscience d’arriver sur un territoire déjà bien défriché, et encore en cours d’exploration par de nombreux artistes et chercheurs. Il le formule dès les premières minutes de son spectacle, en s’acharnant sur un fil tout emmêlé, à l’image de sa compréhension d’un moment de l’histoire franco-algérienne qu’il nomme encore « guerre d’Algérie », avant d’opter pour « révolution » ou « guerre de libération nationale » : c’est par le langage qu’il se propose d’enquêter. Dans une adresse très directe au spectateur, qui donne à son – presque – seul en scène une allure de conférence gesticulée, Salim Djaferi fonde sa recherche sur le refus d’un mot. Celui que lui donnent sa mère et sa tante lorsque, voulant résorber des lacunes qu’il présente comme immenses, il leur pose une question apparemment simple : « Comment dit-on ‘’colonisation’’ en arabe ? ». Le « koulounisation » qu’elles lui servent toutes les deux n’est pas à son goût. Il s’attendait, nous dit-il, à un mot en arabe. Il ne lui en faut guère plus – c’est du moins ce qu’il explique dans son préambule –, pour décider de partir en Algérie en 2018. Seul, pour la première fois.
Salim Djaferi poursuit sa quête auprès de « vrais Algériens d’Algérie ». Son récit-cadre accueille alors d’autres histoires, qui à partir de la question de langage initiale dessinent différentes visions de l’Histoire. S’il retombe d’abord en Algérie sur le mot qui lui déplaît, le jeune homme en découvre en effet d’autres. Le premier signifie « s’approprier sans autorisation ». Un autre veut plutôt dire « ordonner ». L’un appartient langage courant, et peut désigner de toutes autres réalités que la colonisation de l’Algérie. L’autre, tiré d’une traduction des Damnés de la terre de Frantz Fanon, n’est quant à lui connu que d’une poignée de spécialistes. Lorsqu’il reviendra de son périple, Salim Djaferi trouvera encore chez sa mère une autre manière d’évoquer l’épisode passé : la périphrase « au temps où ils étaient là ». Au bout du conte – car c’en est un, quand bien même le réel y tient une place importante –, Koulounisation ne débouche que sur une seule certitude : de même que chacun a son mot pour la désigner, chacun a sa colonisation.
L’humour subtil, l’autodérision de Salim Djaferi créent la distance dont a besoin le spectateur – à plus forte raison lorsqu’il est français – pour cheminer aux côtés de l’acteur-chercheur dans son parcours. En expliquant bien l’endroit complexe d’où il parle, Salim Djaferi fait de lui-même une sorte de Candide en Algérie qui ne manque pas de piquant. Partageant son étonnement pour tout ce qu’il trouve sur place, en particulier pour les mots que les femmes et les hommes du pays de ses parents mettent sur la chose qui l’intéresse, il ne cherche pourtant pas la connivence du public. S’il affecte de pouvoir se passer de quatrième mur, l’enquêteur met sa propre narration à distance en développant en parallèle une partition physique pour laquelle il s’est entouré des scénographes Justine Bougerol et Silvio Palomo. Avec le fil qu’il bricole en début de spectacle et des plaques de polystyrène, Salim Djaferi tente en effet de développer un langage non-verbal qui n’illustre pas le discours mais le complète ou le donne à entendre autrement.
La tentative est louable, le résultat mitigé. Si ce travail sur la matière, sur l’installation, permet d’ouvrir la pièce à l’interprétation, il manque de la complexité nécessaire pour être récit à part entière. On pense au travail d’Adeline Rosenstein, qui dans Décris-ravage et Laboratoire Poison imagine un langage chorégraphique et plastique complexe pour aborder l’Histoire de la Palestine et les mécanismes de la trahison. Cette artiste est d’ailleurs créditée au regard dramaturgique de la pièce. Si Salim Djaferi souffre quelque peu de la comparaison, celle-ci permet de comprendre le désir d’exigence qui anime Salim Djaferi, et dont la partie orale rend bien compte, à quelques passages près. Lorsque l’artiste s’éloigne de son examen du langage pour aborder des pans d’histoire plus personnelle – le passé de ses parents en Algérie puis en France, surtout –, il perd parfois le fil ténu de sa proposition. Car bien que parlant en son propre, on comprend que Salim Djaferi se tient sur une crête fragile dressée entre le vrai et le faux. Cette indécision est à cultiver.
Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr
Koulounisation
Conception et interprétation : Salim Djaferi
Collaborateur artistique : Clement Papachristou
Regard dramaturgique : Adeline Rosenstein
Aide à l’écriture : Marie Alié, Nourredine Ezzaraf
Écriture plateau : Delphine De Baere
Scénographie : Justine Bougerol, Silvio Palomo
Création lumière et régie générale : Laurie FouvetProduction, diffusion, développement : HAbemus papam – Cora-Line Lefèvre et Julien Sigard.
Coproduction : Les Halles de Schaerbeek, Le Rideau de Bruxelles et l’Ancre – Théâtre Royal de Charleroi.
Avec le soutien des bourses d’écriture Claude Étienne et de la SACD, de la Chaufferie- Acte1, de La Bellone-Maison du Spectacle (BXL/BE), du Théâtre des Doms, du Théâtre Episcène et de Zoo Théâtre.
Avec l’aide de la Fédération Wallonie Bruxelles. de : SACD – Bourse « Auteurs d’Espace », DGCA/Ministère de la Culture et de la Communication, CD du Gard, Région Languedoc Roussillon, Réseau en Scène et la Diagonale.
Théâtre de la Bastille
du 29 avril au 12 mai 2024
19h, 17h les samedis et dimanches
relâche les mercredis 1er et 8 mai
et jeudi 9 mai





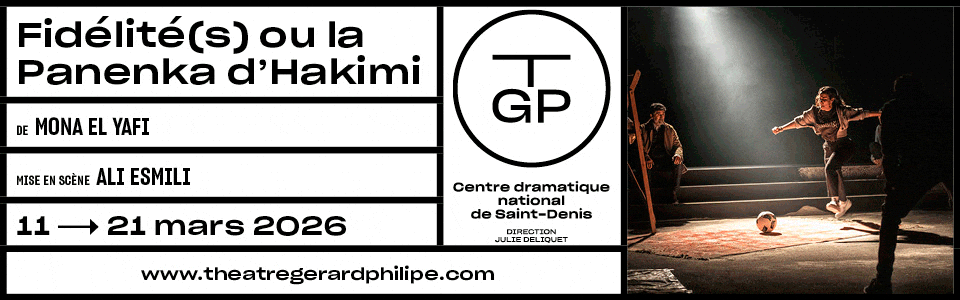




Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !