
Photo Jean-Louis Fernandez
Pour sa première saison d’été à la tête de l’institution vosgienne, la metteuse en scène Julie Delille réinscrit l’une des dernières pièces de Shakespeare dans sa filiation littéraire. Épaulée par la dramaturge Alix Fournier-Pittaluga et par la scénographe Clémence Delille, elle offre au Conte d’hiver un écrin fin, délicat et organique, où peuvent s’épanouir sa théâtralité sensible et sa profonde humanité.
Imprimer sa marque et s’inscrire dans une histoire. Arriver à la tête d’une institution impose de satisfaire à cette exigeante alliance des contraires, a fortiori lorsque ladite institution a une identité aussi forte que celle du Théâtre du Peuple de Bussang. Pour ses premiers pas à la tête de la maison vosgienne, où elle a posé ses valises en octobre dernier, Julie Delille devait, tout à la fois, faire montre de sa différence avec ses prédécesseurs – tous masculins depuis près de 130 ans – et répondre aux attentes des spectatrices et spectateurs, qu’ils soient nouveaux venus, et attirés par la renommée du lieu, ou habitués, et munis de ces petits coussins bien utiles pour assouplir la dureté des assises en bois. Son projet, la metteuse en scène l’a construit selon trois axes, trois « termes poétiques », tous liés à cette « écologie profonde » – environnementale, sociale et mentale – autour de laquelle elle travaille depuis plusieurs années au sein de sa compagnie, Le Théâtre des trois Parques : la saisonnalité, inhérente au Théâtre du Peuple, mais que l’artiste entend « déployer à tous les niveaux » ; la sensibilité « fine, loin de l’accumulation technologique et spectaculaire », comme base de la « qualité de la relation » à nouer ; et l’organicité, qui « met au coeur les questions du vivant, de la réalité et de la faisabilité des différentes initiatives ». Et il est remarquable d’observer que ce triptyque intellectuel, loin d’être un voeu pieux, offre autant de mamelles à sa réappropriation, si précise, délicate et exigeante, du Conte d’hiver, qui ouvre sa première saison d’été.
Comparée aux tubesques Hamlet, Le Roi Lear, Roméo et Juliette ou encore Richard III, pour ne citer qu’elles, Le Conte d’hiver n’est assurément pas la pièce la plus montée de Shakespeare. Cette oeuvre tardive, l’une des dernières écrites par le dramaturge britannique avec La Tempête, a pourtant ceci de fascinant, et sans doute d’effrayant, qu’elle paraît contenir en elle une large partie des autres. Surtout, elle semble dictée par la plume facétieuse d’un auteur à ce point sûr de son art qu’il en intègre nombre d’artifices, au nez et à la barbe de la vraisemblance. Comme tout conte qui se respecte, son histoire prend racine dans une demeure royale, celle de Léonte, le monarque de Sicile. En compagnie de sa femme Hermione et de son fils Mamilius, il reçoit son très vieil ami Polixène, qui règne en maître sur la Bohème. Alors que l’ambiance est au beau fixe entre tous les convives, une simple danse met le feu aux poudres. En observant la complicité entre Hermione et Polixène, Léonte est convaincu que son épouse et son camarade le trompent, que le second enfant qu’elle attend n’est pas le sien, mais bien celui du roi de Bohème. Rapidement, le doute se transforme en folie et le monarque sicilien déroule son plan cruel : il tente d’empoisonner son vieil ami qui, in extremis, réussit à mettre les voiles, et emprisonne son fils, puis sa femme, qui accouche derrière les barreaux de la petite Perdita qu’elle est contrainte d’abandonner.
À ce pêché aussi originel que fantasmé, Julie Delille donne une dimension hamlétienne en diable. Tandis que, comme le prince du Danemark, Léonte joue les trouble-fêtes, la source de son mal intérieur devient également, sous la houlette de la metteuse en scène, une vision spectrale, celle non pas d’un fantôme, mais d’un effleurement de main que le roi de Sicile se repasse en boucle. Institué comme le descendant de son illustre aîné littéraire, Léonte adopte alors sa position et ses tourments : loin d’être le mari tyrannique et colérique que l’on voit parfois, il prend l’allure d’un homme toujours aussi jaloux, mais beaucoup plus intimement blessé, en proie à des forces qui semblent le contrôler et le dépasser. À l’avenant, cette vision hamlétienne du Conte d’hiver ruisselle sur Hermione, mais aussi sur Perdita, qui, l’une comme l’autre, apparaissent comme les dignes héritières d’Ophélie : la première dans sa pureté et la seconde dans sa façon de faire exploser les codes et les cadres, y compris à l’aide de ces fleurs qu’elle distribue à la volée. Co-construite avec la dramaturge Alix Fournier-Pittaluga, cette émouvante filiation offre un écrin sensible aux comédiennes et comédiens, professionnels comme amateurs, qui peuvent explorer, et donner à voir, l’humanité de leurs personnages. Si, en toute logique au vu de cet attelage propre au Théâtre du Peuple, le jeu semblait encore un peu vert le jour de la première, certaines actrices, telles Laurence Cordier et Sophia Daniault-Djilali, s’illustraient déjà, quand d’autres paraissaient simplement avoir besoin de rodage.
Aidés par la direction précise de Julie Delille, et par une adaptation limpide, fluide et nerveuse qui profite de la traduction très équilibrée de Bernard-Marie Koltès, toutes et tous le sont également par la magnifique organicité de sa mise en scène et la complémentarité de ses composantes. Au-delà des subtiles lumières d’Elsa Revol et de la création musicale envoûtante, et dramaturgiquement pertinente, de Julien Lepreux – en forme de boucles où les sonorités de l’orgue évoluent pour épouser les différentes teintes (horrifiques, religieuses, festives…) de la pièce –, il faut particulièrement saluer, une nouvelle fois, l’époustouflant travail scénographique et de création costumes piloté par Clémence Delille. Alors que ses beaux habits fourmillent d’élégants symboles dramaturgiques – à l’image de ces liserés dorés qui ornent la robe noire de Paulina, comme dernière source d’un pouvoir royal anéanti par la peine dans une demeure sicilienne en deuil –, son décor, tout en bois sombre, semble faire naturellement corps avec le magnifique cadre du Théâtre du Peuple. Se transformant au gré des évolutions textuelles – aussi encombré et piégeux en Sicile, à l’instar de l’esprit de Léonte, que dégagé et léger en Bohème –, il débouche spontanément sur l’un des passages obligés, et attendus, à Bussang : l’ouverture du fond de scène sur la forêt, à l’occasion de la fête de la tondaison, mais aussi lors de la toute dernière scène du spectacle. À l’origine d’une image sublime, cet ultime moment bâtit un pont entre culture et nature, autant qu’il rompt avec l’héritage d’Hamlet. Là où, dans la tragédie du prince du Danemark, l’humanité est décimée, elle est, dans Le Conte d’hiver, puissamment réhabilitée par Shakespeare, et Julie et Clémence Delille d’en profiter pour offrir à ses personnages, devenus les leurs, une échappée finale dans la forêt. Tel un retour, plein et entier, dans le monde des vivants.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Le Conte d’hiver
Texte William Shakespeare
Traduction Bernard-Marie Koltès
Mise en scène Julie Delille
Avec Laurence Cordier, Laurent Desponds, Élise de Gaudemaris, Baptiste Relat et les comédien·nes amateurices de la troupe 2024 du Théâtre du Peuple : Héloïse Barbat, Garance Chavanat, Véronique Damgé, Sophia Daniault-Djilali, Michel Lemaître, Gérard Lévy, Valentin Merilhou, Jean-Marc Michels, Yvain Vitus et, en alternance, Alcyone Bénézit-Desbordes, Nicolas Brice, Marie Charton, Anna Dupleix-Marchal, Mailla Hattier, Philippe Voiriot
Dramaturgie Alix Fournier-Pittaluga
Scénographie et costumes Clémence Delille
Création lumière Elsa Revol
Musique Julien Lepreux
Assistanat mise en scène Gwenaëlle Martin
Assistanat scénographie et costumes Elise Villatte
Régie générale et lumière Pablo RoyProduction Théâtre du Peuple – Maurice Pottecher
Coproduction Théâtre des trois ParquesDurée : 3h30 (entracte compris)
Théâtre du Peuple, Bussang
du 20 juillet au 31 août 2024


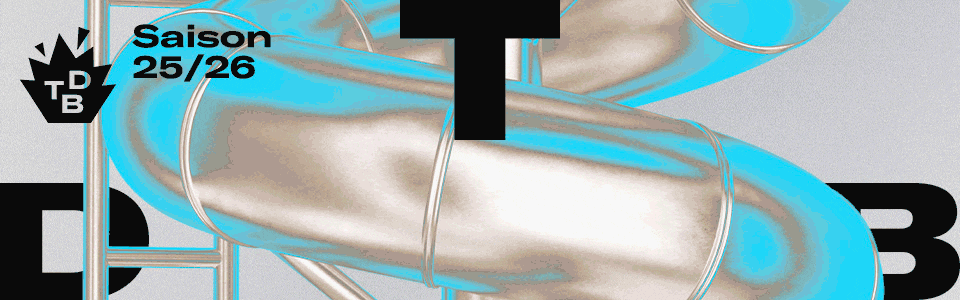

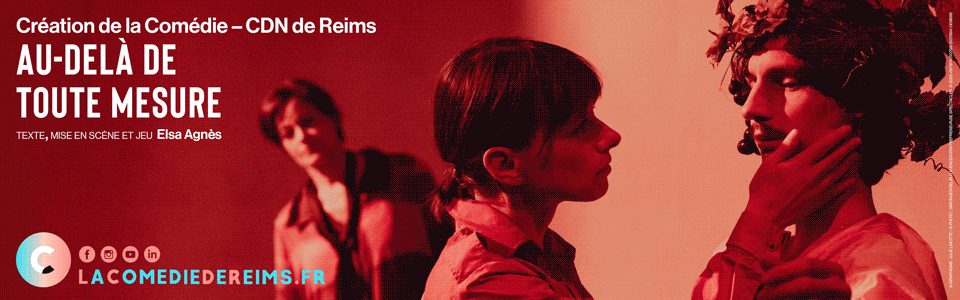







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !