Dans le silence laissé par la fermeture des théâtres et autres lieux d’art et de culture, le comédien et metteur en scène Olivier Balazuc fait entendre sa colère et son incompréhension. Il appelle au dissensus.
Dès le premier jour du premier confinement, vous lanciez un blog intitulé Le jour où (presque tout s’arrêta), où à travers une écriture de l’intime vous disiez notamment les dysfonctionnements révélés par la situation actuelle (nous en parlions ici et là). Vous ne poursuivrez pas ce blog pendant ce second confinement. Pourquoi ?
Quand nous sommes rentrés dans le premier confinement, nous ne savions rien. La circulation du virus, sa durée de vie, les moyens de nous en protéger… Tout cela nous échappait complètement. C’est d’ailleurs pourquoi la population a entièrement joué le jeu. De nombreux artistes dont je fais partie ont tenté de faire œuvre du moment, d’exprimer que l’immobilité ne nous condamnait pas à l’immobilisme, que notre créativité, notre capacité à penser l’époque demeuraient plus vivaces que jamais. La virtualité était un moyen de conserver le lien avec le public dans un contexte où l’ensemble de la société se retrouvait à l’arrêt. C’était un don spontané. Cette fois, la situation est différente. Déjà parce que l’annulation et le report de nombreuses dates de représentations et de résidences nous a placés dans une grande fragilité économique. Et ce second confinement n’est pas de même nature que le premier : une décision gouvernementale définit notre travail comme « non essentiel » et nous empêche en partie de l’exercer. C’est autoritaire, et profondément injuste, comme pour les librairies par exemple. Il n’y a aucune raison que je reste chez moi, je veux consacrer mon temps au spectacle que je suis en train de monter.
C’est là l’objet principal de l’appel que vous nous avez lancé au lendemain de l’annonce de ce second confinement. Dire que le théâtre, que l’art sont des biens de première nécessité.
Il est important de se rappeler que dans son Petit Manifeste de Suresnes qu’il écrit en 1951, alors qu’il mettait en place des représentations décentralisées pour les ouvriers des usines Renault, Jean Vilar revendiquait son action comme un bien de « première nécessité », au même titre que « le gaz, l’eau et l’électricité ». Le théâtre public tel qu’il existe aujourd’hui, ou tel qu’il tente encore d’exister, s’est construit sur cette vision. Les théâtres sont parmi les derniers lieux de parole où l’on peut expérimenter une distance critique, une insolence qui offrent une alternative au flux d’information en continu et à la gouvernance par la peur. N’est-ce pas de « première nécessité » ?
Dans les articles de votre blog, une question revenait régulièrement : « De quoi la Covid est-elle le nom ? ». Qu’en diriez-vous aujourd’hui ?
Mon point de vue n’a pas changé, l’épidémie de Covid n’est pas la cause première de notre catastrophe systémique, elle est un effet révélateur de défaillances structurelles et de politiques économiques dévastatrices pour l’environnement et la société. Or, toute réflexion de fonds a été balayée par un état d’urgence qui menace de devenir permanent. Alors, comment comprendre des décrets qui sanctionnent des secteurs essentiels où les risques ne sont pas avérés ? Le spectacle vivant, qui, il faut le rappeler constitue la première ressource économique française, s’est très vite adapté aux mesures sanitaires. Avec l’espacement des spectateurs, la distribution de gel hydroalcoolique ou encore la fermeture de leurs bars, les lieux de spectacle vivant ont été exemplaires. On ne peut pas nous faire croire qu’il est plus dangereux d’aller au théâtre que de prendre le métro. J’ai toujours pensé que le sort réservé au théâtre était le baromètre de la démocratie. Force est de constater qu’elle va mal. Avec toutes ces mesures prises de manière autoritaire, sans consultation des instances démocratiques, c’est l’ensemble du service public qui paye, très cher. Regardons l’hôpital public, tenu pour héroïque par le gouvernement pendant le premier confinement. Que reste-t-il de ces paroles ? Aucune leçon n’a été tirée de la crise, et le système hospitalier se retrouve en pleine hémorragie. Avec ces décisions au coup par coup, je crains que l’on nous installe dans une précarité systémique. Au nom du principe de précaution, l’espace public nous est confisqué, nous ne sommes pas libres de nos corps dans la rue. Il est impossible de manifester, de faire valoir une parole critique sans être taxé de complotisme. J’ai la sensation de vivre en plein Metropolis. Prenons garde que nos masques ne se transforment pas en muselières. Ce qui fait la bonne santé de la démocratie, il est bon de le rappeler, ce n’est pas le consensus, mais bien le dissensus.
La fragilisation du service public que vous décrivez ne date pas d’hier. Depuis quand la ressentez-vous en tant qu’artiste ? Sous quelles formes ?
L’un des grands changements que j’ai eu à déplorer depuis que j’ai commencé, c’est l’expropriation de l’artiste de son lieu de travail. Alors qu’il a été, et devrait toujours en être le centre. On ne parle d’ailleurs plus d’art, mais de « culture ». Et le mot « théâtre » disparaît des frontons de ces maisons, comme si ce mot désignait une chose honteuse. Avec la multiplication des intermédiaires entre lui, les théâtres et les institutions, l’artiste est devenu un prestataire de services de l’industrie culturelle. À devoir remplir des cases préétablies – au premier rang desquelles, la diffusion –, avant même d’avoir éprouvé ses envies et ses idées sur un plateau, l’artiste de théâtre s’assèche, il se formate. On le contraint à devenir un produit, au nom d’une logique de compétitivité qui annule tout historique de création, toute démarche un peu singulière. Le champ se rétrécit à vue d’œil entre l’estampille « artiste émergent » et celle d’artiste reconnu, c’est-à-dire officiel. On est entré dans un principe de rentabilité à court-terme, cher à la logique du « zéro risque ». Un Jean-Luc Lagarce n’aurait jamais pu exister dans un tel contexte. Or, la « culture », c’est ce qui reste quand un artiste n’est plus. Elle ne saurait lui préexister. La preuve en est qu’au moment où un artiste commence, il se retrouve souvent en butte au goût ou la tendance de l’époque. Telle est et doit demeurer la mission du service public : donner le temps, les moyens et l’outil à l’artiste pour développer une œuvre. Au-delà de la case « émergence », ce qui compte, c’est que les artistes émergent ! C’est pourquoi on voit de plus en plus d’équipes, jeunes ou confirmées, tenter désormais l’aventure « en marge » de l’institution, créer des fabriques. Une manière de retrouver un souffle vital.
Que pensez-vous utile de faire en cette période, pour amorcer un changement ?
Il faut faire savoir que des artistes travaillent en ce moment dans les théâtres. Il faut que tous les théâtres accueillent des équipes, mettent leurs moyens financiers et techniques à leur service, même si nous ne pouvons pas faire de représentations. Les lieux doivent être habités, car c’est leur vocation, multiplier les captations, créer des solidarités nécessaires. Les spectacles joués dans des maisons vides pourraient être diffusés sur les chaînes de télévision locales, par exemple, moyennant bien sûr rétribution aux compagnies. Dans la mesure où les enfants vont à l’école, les représentations scolaires pourraient aussi être maintenues, avec l’accord des préfets. En cette période difficile, le lien avec la jeunesse doit absolument être conservé, et même renforcé.
Observez-vous les mêmes attentes dans l’ensemble du milieu théâtral ?
Je crois que beaucoup d’artistes sont encore dans la sidération d’être à ce point ignorés, invisibilisés. Comme si pour le gouvernement, le fait d’accorder l’année blanche aux intermittents avait réglé une fois pour toutes le problème. Je me réjouis de voir que de nombreux directeurs de lieux prennent la mesure du problème et œuvrent avec nous à trouver des solutions pour donner à voir notre travail. Les directeurs de L’Agora – pôle national cirque de Boulazac et du Moulin du Roc – scène nationale de Niort, coproducteurs de mon spectacle W, d’après W ou le Souvenir d’enfance de Georges Perec qui aurait dû voir le jour le 23 novembre, sont de ceux-là. L’art n’est ni un luxe ni un dérivatif, il permet aux spectateurs de forger des outils de compréhension du réel. En tant que citoyens, nous en avons besoin dans ce moment de grande tension que connaît la civilisation. Et c’est l’occasion pour la « culture » de réaffirmer la place primordiale des créateurs, qui sont la raison d’être de notre maillage théâtral unique au monde.
Propos recueillis par Anaïs Heluin – www.sceneweb.fr





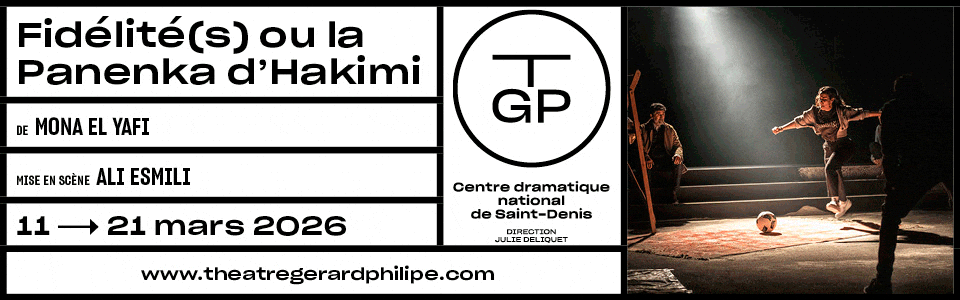








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !