Pauline Bayle livre une version condensée, fluide et limpide du monument romanesque de Balzac. Un tour de force où l’apparente simplicité du geste n’a d’égal que l’impressionnante acuité du propos.
Les monstres littéraires, d’où qu’ils viennent, ne font pas peur à Pauline Bayle. Bien au contraire. Après L’Iliade, puis L’Odyssée, d’Homère et le plus modeste Chanson douce de Leïla Slimani, la metteuse en scène a jeté son dévolu sur Illusions perdues, l’une des pierres angulaires – si ce n’est la pierre angulaire – de La Comédie humaine de Balzac. S’attaquer à un tel monument, avec ses près de 700 pages et ses quelque 70 personnages, n’a rien d’une mince affaire. L’adapter au théâtre impose de faire des choix, d’opérer des coupes, de viser juste, et non d’y aller sabre au clair, pour préserver la justesse balzacienne. C’est le tour de force qu’a réussi Pauline Bayle. Sans complètement occulter ses première (Les Deux Poètes) et troisième (Les Souffrances de l’inventeur) parties, condensées en un prologue et un épilogue, elle s’est concentrée sur le cœur battant de l’œuvre, Un grand homme de province à Paris. En ressort un précipité, débarrassé de toute longueur, qui, en un seul et même mouvement, donne à voir la splendeur et la décadence d’un homme, dévoré par ses envies d’amour, d’argent et de gloire.
Cet homme, c’est Lucien Chardon. Beau et lettré, fils de pharmacien et d’aristocrate, il préfère se faire appeler du nom de sa mère, de Rubempré, depuis que Madame de Bargeton, avec qui il entretient une liaison, l’a introduit au sein de la noblesse d’Angoulême. Sauf qu’aux yeux de cet ambitieux duo, le talent de l’écrivain en herbe, qui a composé un recueil de sonnets en l’honneur de sa belle, n’est pas reconnu à sa juste valeur par cette bonne société de province. Ils décident alors de monter à la capitale pour vivre leur amour et accéder à cette renommée que la cité angoumoisine ne peut leur offrir. À peine débarqué à Paris, leur tandem ne fait pas long feu. Sous les railleries des femmes de l’aristocratie, qui se gaussent de la voir au bras d’un roturier mal dégrossi, Madame de Bargeton lâche Lucien en rase campagne. Livré à lui-même, le jeune homme ne s’en laisse pas compter et gravit, de proche en proche, les échelons jusqu’à se convertir au journalisme. Là, il découvre qu’il peut faire et défaire des réputations, et surtout satisfaire ses ambitieuses envies, quitte à voguer de compromission en compromission.
Pour suivre Lucien dans ses pérégrinations, de l’opéra à ses appartements, de la bibliothèque à la salle de rédaction, Pauline Bayle ne s’est embarrassée d’aucun décor. Conformément à sa grammaire habituelle, elle a opté pour un théâtre brut et un plateau nu, habilement éclairé par les lumières de Pascal Noël. Encadré par un public installé en quadrifrontal, délimité par un rectangle blanc recouvert d’une fine couche de craie, l’espace de jeu se transforme en un ring social autour duquel les spectateurs jouent, malgré eux, un rôle primordial, celui d’une société parisienne qui transperce les personnages de son regard acéré. Car, qu’importe le lieu, c’est toujours la même logique qui prévaut, celle d’un monde où chacun est évalué à l’aune de ce qu’il a – argent, titre, influence – et non de ce qu’il est, où le paraître, toujours, supplante l’être, où le moindre acte, y compris intellectuel, peut constamment servir de monnaie d’échange. Dans cet univers obsédé par la fin et non par les moyens, les alliances et les contre-alliances peuvent se nouer et se dénouer, les trahisons et les coups bas tomber comme à Gravelotte.
Cette lutte à mort sociale, conduite avec limpidité et intensité par Pauline Bayle, ne serait rien, ou si peu, sans l’incroyable fluidité de sa troupe de comédiens. À eux six, metteuse en scène comprise, ils incarnent près d’une vingtaine de rôles sans se préoccuper des genres. Si Jeanna Thiam se borne logiquement au personnage prédominant de Lucien, tout en fougue et en faiblesses, et Pauline Bayle à celui de l’abbé espagnol, Carlos Herrera, digne héritier du Diable faustien, Charlotte Van Bervesselès, Hélène Chevallier, Guillaume Compiano et Alex Fondja passent, en un claquement de doigt, de protagoniste en protagoniste avec l’aisance de cabris scéniques. Fondée sur des changements ultra-rapides d’accessoires vestimentaires – pardessus, veste, paire de chaussures, chemisier –, cette mécanique est le plus bel exemple de la simplicité qui irrigue l’ensemble de la pièce, jusqu’à en devenir la force motrice. Celle-là même qui, décidément, va si bien à Pauline Bayle.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Illusions perdues
d’après le roman d’Honoré de Balzac
Adaptation et mise en scène Pauline Bayle
Avec Charlotte Van Bervesselès, Hélène Chevallier, Guillaume Compiano, Alex Fondja, Jenna Thiam
Assistante à la mise en scène Isabelle Antoine
Scénographie Pauline Bayle, Fanny Laplane
Lumières Pascal Noël
Costumes Pétronille Salomé
Musique Julien LemonnierProduction déléguée Compagnie À Tire-d’aile
Coproduction Scène nationale d’Albi, TANDEM – Scène nationale, Espace 1789 – Scène conventionnée Saint-Ouen, MC2 : Grenoble, Théâtre de la Bastille, La Coursive – Scène nationale La Rochelle, Théâtre La Passerelle – Scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, Châteauvallon Scène nationale, Théâtre de Chartres
Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication / DRAC Île-de-France, de la Région Île-de-France et du CENTQUATRE-PARIS
Le Département de la Seine-Saint-Denis a soutenu la création de cette œuvre.
La Compagnie À Tire-d’aile est en résidence à l’Espace 1789 – Scène conventionnée de Saint-Ouen, avec le soutien du Département de la Seine Saint-Denis.Durée : 2h20
Vu en mars 2020 au Théâtre de la Bastille
Théâtre de l’Atelier, Paris
du 7 septembre au 6 octobre 2024
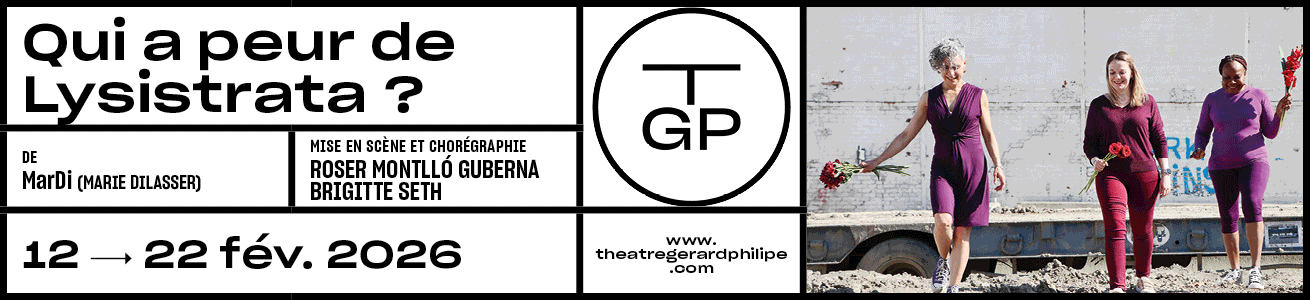













Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !