À l’occasion du premier volet de sa nouvelle série présentée au Théâtre du Soleil, la metteuse en scène Ariane Mnouchkine chausse les lunettes confortables du présent pour imposer, façon leçon d’Histoire, son regard superficiel et manichéen sur les figures de la révolution russe de 1917.
Tandis que le plateau de Théâtre du Soleil baignait dans la quiétude propre aux paysages enneigés, le visage de Vladimir Poutine apparaît soudain en fond de scène. La femme qui, quelques secondes auparavant, demandait aux spectatrices et aux spectateurs de « mettre les téléphones portables hors d’état de nuire » et de « ne pas prendre de photo », se précipite alors vers lui, lui intime l’ordre de « dégager » et tente de couvrir cette voix qui, comme le président russe l’avait fait le 24 février 2022, annonce le début de l’invasion de l’Ukraine. Sous ses coups de poing répétés, la toile où la vidéo est projetée ondule, se déforme, et donne au faciès de Poutine des traits encore plus démoniaques qu’à l’accoutumée. Cette irruption aussi gigantesque que brutale d’un morceau de l’Histoire récente ne constitue pas le strict point de départ de la nouvelle série du Théâtre du Soleil, Ici sont les Dragons, mais sert plutôt de tremplin pour basculer de la Russie d’aujourd’hui à celle d’hier. Bientôt, la femme traverse à nouveau le plateau pour s’installer à ses pieds, et s’imposer en tant que metteuse en scène, au milieu d’un empilement de livres qu’elle ne tarde pas à ouvrir. L’objectif de ce double d’Ariane Mnouchkine, incarné par Hélène Cinque, est clair : « rentrer dans le lard de l’Histoire » afin de nous donner les moyens de comprendre comment nous, et plus particulièrement la Russie, en sommes arrivés là.
Pour cela, dans une forme de mise en abyme de l’acte de création mnouchkinien, elle ambitionne de monter un spectacle, ou plutôt plusieurs spectacles. En guise d’ouverture, elle se plonge dans cette Première époque, dans cette révolution de 1917 qui a fait chavirer la Russie tsariste dans l’ère soviétique, et qu’Ariane Mnouchkine considère, visiblement, comme le berceau de notre mal contemporain – alors que les tentations impérialistes russes lui sont bien antérieures. Au long d’une petite vingtaine de tableaux, déroulés comme on tournerait les pages d’un livre d’Histoire, elle porte au plateau le récit de ce mouvement populaire peu à peu confisqué par une petite clique de dirigeants. Née à Petrograd en février 1917, sous l’effet conjugué d’un hiver particulièrement rude, d’une pénurie alimentaire et de la lassitude liée à la Première Guerre mondiale, cette révolte prend rapidement de l’ampleur et la liste des revendications s’allonge jour après jour. Alors que les femmes et les ouvriers demandaient d’abord du pain, ils réclament bientôt la fin de la guerre, l’abdication du tsar, et rêvent, pour certains, d’égalité, de droit de vote pour toutes et tous et de l’autodétermination des peuples de l’Empire.
Épaulés par les soldats, en dépit de la répression sanglante ordonnée par Nicolas II, les manifestants remportent la première manche, et voient, en mars 1917, l’arrivée aux commandes d’un gouvernement provisoire en lieu et place du régime tsariste. Malgré la formation de soviets, ces assemblées spontanées d’ouvriers, de paysans, de soldats et de marins, la bourgeoisie qui veille au grain, et freine des quatre fers pour contenir les velléités populaires, fait progressivement main basse sur le pouvoir, et ne met pas fin à la guerre. En parallèle, les Allemands, qui cherchent à obtenir la paix sur le front de l’Est pour concentrer toutes leurs forces sur celui de l’Ouest, permettent au maximaliste Lénine de revenir de son exil suisse, dans un « train plombé » qui arrive le 3 avril en gare de Petrograd. Cette opération de déstabilisation du géant russe est un succès et précipite le pays dans une nouvelle instabilité politique qui, mois après mois, jette les bases de la révolution d’Octobre et du « coup d’État » des bolchéviques. Emmenés par le triumvirat Lénine-Trotski-Staline, ils mettent le pays sous leur coupe réglée, font miroiter une Assemblée constituante pour mieux la tuer dans l’oeuf et imposent une dictature. « La démocratie n’aura duré que huit mois », se désespère alors la metteuse en scène en guise de clôture de cette première partie.
Avec cette collection de tableaux, Ariane Mnouchkine, « en harmonie » – comme le veut le terme consacré – avec Hélène Cixous, entend mettre le doigt sur la naissance d’un pouvoir autoritaire, mais le fait avec beaucoup trop de superficialité et une manière de faire la leçon qui donne bien peu à penser. Loin de ce que Joël Pommerat avait su brillamment réaliser avec Ça ira (1) Fin de Louis au sujet des débuts de la Révolution française, la metteuse en scène chausse les lunettes, forcément confortables, du présent pour se poser non pas comme une historienne ni comme une femme de théâtre, mais comme une procureure aux accents didactiques qui jugerait le cours des événements qu’elle fait défiler sous nos yeux. Au gré de rares allers-retours avec les différents fronts de la Première Guerre mondiale et avec l’Allemagne, elle joue la partition, un tantinet démagogique, du pauvre peuple romantisé – sacrifié dans les tranchées, naturellement enclin au partage, en quête forcenée de grandes avancées sociétales – contre les élites corrompues. Surtout, elle paraît à bas bruit, sans le dire explicitement ni le justifier, renvoyer dos à dos, et mettre sur le même plan, les architectes de la révolution d’Octobre et les nazis en devenir : Hilter, que l’on aperçoit simplement épargné dans les tranchées par un soldat britannique, et Goebbels, qui se repaît sur un banc des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse de Vicente Blasco Ibáñez.
Au-delà du côté très scolaire de ce déroulé, Ariane Mnouchkine propose alors une vision partielle, partiale et surtout simpliste de la révolution russe. Tracée à gros traits, elle se révèle manichéenne dans sa façon de se lancer à la poursuite des « méchants » – y compris à grand renfort de musique inquiétante à chaque fois que Lénine pose un orteil sur le plateau. Sans jamais chercher à sonder leurs motivations, y compris les plus viles – à l’image de ce que Milo Rau avait pu faire dans son Lenin –, à analyser leur pensée, à expliciter clairement le jeu politique complexe qui se joue, elle se borne à les caricaturer comme les grands ordonnateurs uniformes d’un complot – alors que l’on connaît les dissensions et les querelles qui pouvaient exister au sein même du triumvirat – visant à confisquer le pouvoir pour leur propre intérêt, en se payant, au passage, la tête du bon peuple. De tout cela, ne se dégage, finalement, et étonnamment au vu de la bibliographie pléthorique sur laquelle la metteuse en scène dit s’être appuyée, que très peu de profondeur intellectuelle, y compris dans la convocation de ces figures présentées comme plus modérées – tels Irakli Tsérétéli et Karl Kautsky –, à qui Ariane Mnouchkine semble donner quitus, sans explorer ni donner à apprécier, là encore, le fond de leur pensée.
Surtout, l’autoritarisme qu’elle entend dénoncer, la metteuse en scène le pratique dans sa façon de faire théâtre. Si elle profite toujours de son impeccable maîtrise du plateau et du rythme, et de son imperturbable talent à faire naître des tableaux avec un charme artisanal à nul autre pareil, Ariane Mnouchkine opère le choix pour le moins curieux de faire jouer ses comédiennes et ses comédiens en playback, exception faite d’Hélène Cinque. Si l’on croit d’abord à un souci de véracité, à un moyen de faire résonner les langues russes, allemandes et anglaises, que les actrices et les acteurs ne maîtrisent pas forcément, cette fragile hypothèse s’effondre quand vient l’heure des fragments en français, eux-mêmes pré-enregistrés. Contre-productif dans sa manière de fausser ce qui se joue, ce parti-pris donne à cette fresque historique l’allure d’une pantomime, d’une farce, dont Ariane Mnouchkine ne pousse ni les feux ni les traits – sauf lors de la bien nommée « farce ukrainienne » – afin qu’il se révèle dramaturgiquement pertinent. Affublés de masques qui leur offrent, avec une précision d’orfèvre, le visage de celles et ceux qu’ils incarnent, lorsque ces personnages sont connus, les comédiennes et les comédiens de la Troupe du Soleil sont alors privés de leur capacité réelle à jouer. Ils deviennent les pantins d’une composition quasi marionnettique, de simples pions au service de la vision d’une metteuse en scène toute puissante, réduits à bouger vaguement les lèvres et à agiter les bras, avec une bonne dose de surjeu. Niés dans leur individualité, privés de leur singularité, ils ressemblent alors à ces « hommes nouveaux » que les totalitarismes du XXe siècle entendaient faire naître pour mieux en tirer les ficelles.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Ici sont les Dragons – Première époque – 1917 : la Victoire était entre nos mains
Une création collective du Théâtre du Soleil en harmonie avec Hélène Cixous
Direction Ariane Mnouchkine
Avec Hélène Cinque, Dominique Jambert, Nirupama Nityanandan, Aline Borsari, Alice Milléquant, Omid Rawendah, Sébastien Brottet-Michel, Seear Kohi, Reza Rajabi, Jean Schabel, Shaghayegh Beheshti, Pamela Marin Munoz, Vincent Mangado, Duccio Bellugi-Vannuccini, Maurice Durozier, Samir Abdul Jabbar Saed, Dimitri Leroy, Andréa Formantel Riquelme, Agustin Letelier, Farid Joya, Élise Salmon, Ève Doe-Bruce, Andréa Marchant Fernandez, Judit Jancsо́, Vincent Martin, Seietsu Onochi, Vijayan Panikkaveettil, Sébastien Brottet-Michel, Xevi Ribas, Ariane Hime, Astrid Grant, Tomaz Nogueira Da Gama, Omid Rawendah, Clémence Fougea, Ya-Hui Liang, et les voix de Ira Verbitskaya, Egor Morozov, Martin Vaughan Lewis, Brontis Jodorowsky, Arman Saribekyan, Cyril Boutchenik, Alexey Dedoborsch, Rainer Sievert, Johannes Ham, Sava Lolov, Sacha Bourdo, Yuriy Zavalnyouk, Anna Kuzina
Musique Clémence Fougea
Son Thérèse Spirli, assistée de Mila Lecornu
Images Diane Hequet
Lumières Virginie Le Coënt, Lila Meynard
Peintures Elena Ant, assistée de Hanna Stepanchenko
Soies Ysabel de Maisonneuve
Masques Erhard Stiefel, assisté de Simona Vera Grassano
Masques et accessoires Xevi Ribas, Miguel Nogueira, Lola Seiler, Emma Valquin, Sibylle Pavageau
Figurines Miguel Nogueira, assisté de Sibylle Pavageau
Costumes Marie-Hélène Bouvet, Barbara Gassier, Nathalie Thomas, Annie Tran, Elisabeth Cerqueira, avec l’aide de Mona Franceschini
Perruques et coiffures Jean-Sébastien Merle
Décors David Buizard, Naweed Kohi, Sandra Wallach, Aref Bahunar, Antoine Giovannetti, Noël Chambaux, avec l’aide de Martin Claude, Clément Vernerey, Pierre Mathis-Aide, Chloé Combes
Effets spéciaux Astrid Grant, Andréa Formantel Riquelme, Farid Joya, avec l’aide de Judit Jancsо́, Reza Rajabi
Conseils historiques Galia Ackerman, Stéphane Courtois, Nicolas Richoux, Dominique Trinquand
Archiviste Sébastien Brottet-Michel
Assistant à la mise en scène Alexandre Zloto
Surtitrage Amanda Tedesco
Régie générale Aline Borsari, assistée de Sébastien Brottet-Michel
Régie son Thérèse Spirli
Régie images Diane Hequet, en alternance avec Pierre Lupone
Régie lumières Virginie Le Coënt, Lila Meynard, Noémie Pupier, avec l’aide de Bérénice Durand-JamisProduction Théâtre du Soleil
Coproduction TNP – Villeurbanne
Avec le soutien exceptionnel, à l’occasion de la célébration des 60 ans du Théâtre du Soleil, de la Région Île-de-France, du Ministère de la Culture et de la Ville de ParisLe Théâtre du Soleil est soutenu par le ministère de la Culture, la Région Île-de-France et la Ville de Paris.
Durée : 2h45 (entracte compris)
Théâtre du Soleil, Paris
du 27 novembre 2024 au 27 avril 2025






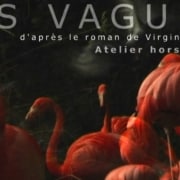







Monsieur Rouquet, le regard que vous portez sur la dernière création du Soleil est consternant. Nous n’avons pas vu le même spectacle. Quand aurez vous fini de traîner votre mèche grasse, votre morgue d’hypokhâgneux et votre condescendance d’artiste frustré dans les théâtres de France au frais d’une rédaction moribonde? Prenez pignon sur rue d’un théâtre, mettez les deux pieds sur un plateau et faites quelque chose d’autre qu’écrire des inepties en sciant la branche malade du spectacle vivant. Michard Olivier
Les personnes doivent être respectées ainsi que la liberté d’expression