La comédienne libanaise Hanane Hajj Ali présente au 76e Festival d’Avignon, Jogging, spectacle créé en 2017. Cette année, on a pu la voir en France dans la création de Chrystèle Khodr, Augures. Cette artiste militante et résistante dresse le portrait de Beyrouth, sa ville.
Jogging parle de vous, de vos deux passions, le jogging et le théâtre. Quelle est la place de Beyrouth dans le spectacle ?
Il y a deux choses qui m’ont toujours permis d’affronter et de résister à tout ce qui se passe au Liban comme la guerre, les crises, les catastrophes, cette mauvaise série qui n’en finit pas depuis ma naissance. Ces deux choses, ce sont le jogging et le théâtre. Dans cette pièce, elles se croisent, se complètent, et me permettent de rendre hommage aux femmes libanaises, aux mères libanaises et surtout à ma ville, Beyrouth, aujourd’hui sinistrée.
Cette pièce, vous l’avez écrite il y a quelques années. Est-ce que vous l’avait changée par rapport aux derniers faits d’actualité au Liban ?
J’ai commencé à jouer cette pièce en 2017. Elle a prédit, en quelque sorte, ce qui allait se passer dans les années suivantes. Je n’ai jamais quitté Beyrouth et je sentais cette mutation farouche et le désastre qui allait survenir. C’était prémonitoire. Je l’ai jouée pendant la révolution de 2019. Elle parle aux jeunes générations de spectateurs entre 16 à 25 ans. C’est plus qu’une mosaïque, c’est un kaléidoscope qui me permet de rajouter des choses qui surviennent. Par exemple, je cite les scandales qui se succèdent à Beyrouth et il y en a pas mal, on est très créatifs dans ce domaine ! J’ai intégré l’explosion du port de Beyrouth du 4 août 2020 parce que c’est le plus grand scandale jamais arrivé au Liban.
Le spectacle évoque aussi la société libanaise, et les femmes qui la composent. Est-ce la pièce d’une résistante ?
Beyrouth est une ville intrigante et détonante avec une vitalité créative et artistique extraordinaires. Et en face, il y a ces mafiosi qui détiennent le pouvoir politique depuis une trentaine d’années et qui se sont amnistiés eux-mêmes. Je sais que le théâtre ne change pas le monde, mais il aide à changer les esprits. Cette pièce parle du non-dit, des tabous que l’on met sous le tapis. Je touche au triangle des Bermudes, aux tabous libanais que sont la religion, le sexe et la politique. Je raconte des histoires vraiment très osées. Et j’ai même reçu des menaces de mort dans certaines régions. Parce que je fais parler les femmes libanaises.
Comment font les artistes pour continuer de créer en 2022 au Liban ?
Comment fait-on pour vivre à Beyrouth ? C’est ça la question. C’est un casse-tête. Les artistes sont laissés pour compte parce que même avant les crises, l’Etat ne jouait presque aucun rôle pour soutenir la communauté artistique et culturelle. Et donc là, vous pouvez imaginer les difficultés grandissantes. Mais ceci nous a poussés à nous soutenir ensemble, à travers les associations culturelles pour faire des programmes communs et postuler à un financement commun. La solidarité entre artistes et les gens de la culture n’a jamais été aussi forte qu’en ce moment, mais ça ne veut pas dire qu’on ne court pas de grand risque. Des espaces culturels, des théâtres ont été détruits. On a pu en sauver quelques-uns grâce à l’aide locale de la société civile et à la solidarité internationale. Ça fait chaud au cœur, ça nous donne de l’espoir. On est très pessimiste vis-à-vis de la situation, mais on n’est pas désespéré, on reste optimiste. Et être artiste comédienne, ça me donne beaucoup d’adrénaline. Je ne peux pas m’arrêter. Je cours tout le temps, dans tous les sens.
Les Libanais aiment sortir, se rassembler. Y-a-t-il toujours cette envie ?
Bien sûr, mais les formes de rassemblement changent. Depuis la révolution d’octobre 2019, on se regroupe dans des groupes clandestins, des groupes virtuels. Ça nous donne beaucoup d’énergie pour résister. Si vous revenez à Beyrouth, je l’espère car ce sera un acte de solidarité aussi, vous serez toujours surpris de voir que les quelques théâtres existent encore, des lieux rouvrent, des galeries programment des expositions. La vitalité est là, on la puise dans la sève du sol à chaque catastrophe. Beyrouth ne peut pas mourir, même si on est en mode de survie, car il n’y a plus de médicaments, il n’y a plus de médecins. Par exemple, les cancéreux meurent tous les jours parce qu’il n’y a plus de traitements. A chaque fois que l’on peut voyager, on retourne avec dans nos bagages pleins de médicaments pour les proches et pour les amis. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut vraiment changer la donne et que les grandes puissances cessent de vendre des armes pour s’occuper du peuple qui souffre.
Et vous, vous continuez de courir tous les jours à Beyrouth ?
Oui, je cours pour ces différents plaisirs. Je suis à l’écoute de mon corps, à l’écoute de mes désirs. Vous allez voir que, dans la pièce, il y a des rêves que j’évoque en courant et qui sont surprenants. Des rêves érotiques par exemple, des rêves de grands rôles que je n’ai jamais pu jouer. Je parle de Beyrouth comme je la rêve et, en même temps, je parle des désillusions. J’ai toujours envie de travailler sur ce fil comme un funambule. Entre le rêve et la réalité, entre le comique et le tragique, entre l’intime et le public. Et ça fait beaucoup rigoler. Je souhaite stimuler le public avec cette réflexion critique et profonde.
Propos recueillis par Stéphane Capron – www.sceneweb.fr





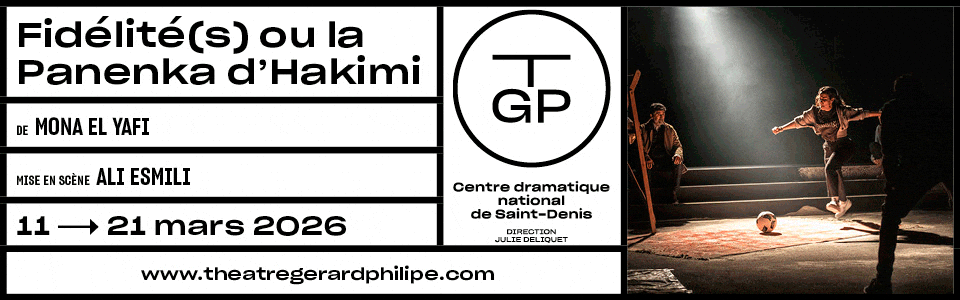




Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !