Co-mis en scène par Dida Nibagwire et Frédéric Fisbach, Gahugu Gato déplie une adaptation plutôt lisse du roman de Gaël Faye, qui tend à neutraliser la violence du génocide rwandais.
En novembre 2022, Frédéric Fisbach créait – une première fois – Petit Pays. Cette adaptation, portée par six interprètes français issu·es d’horizons divers, le metteur en scène, réalisateur et comédien l’a réalisée avec l’auteur et dramaturge Samuel Gallet et dans un dialogue avec Gaël Faye. C’est au cours des tournées du spectacle que, par l’entremise du chanteur, rappeur, musicien et romancier couronné de plusieurs prix pour ce premier roman (dont le Goncourt des lycéens), Fisbach rencontre la comédienne, écrivaine, cinéaste, metteuse en scène et fondatrice de l’Espace – un lieu à Kigali dédié à la danse et au théâtre – Dida Nibagwire. Le dialogue se prolonge alors autant avec Gaël Faye qu’avec cette dernière, amenant le désir d’impulser une nouvelle adaptation du roman. Née en 2024 – année du trentième anniversaire du génocide survenu au Rwanda –, leur nouvelle création, Gahugu Gato (Petit Pays), signale par son intitulé en kinyarwanda, la langue nationale du pays, son ancrage rwandais. Répété à Kigali, porté, à l’exception de Frédéric Fisbach, par des interprètes rwandais·es, co-mis en scène par Fisbach et Dida Nibagwire, joué en 2024 dans la capitale rwandaise et dans des villages situés sur les collines où le génocide débuta en 1994, le spectacle est d’abord destiné à être donné à l’extérieur, dans des espaces naturels.
À vrai dire, et quoiqu’il faille toujours se défier d’une position d’attente – celle-ci étant le meilleur moyen de la déconvenue –, découvrir un spectacle dont on sait qu’il s’appuie sur une version précédente, qu’il se nourrit de collaborations multiples, qu’il s’ancre dans le pays sur lequel il porte, suscite un fort horizon d’espoir. Pour autant, Gahugu Gato (Petit Pays) laisse au soir de sa première avignonnaise un sentiment mitigé. Réunissant douze interprètes au plateau – dont Frédéric Fisbach et Dida Nibagwire –, l’adaptation mêle chant, danse et récit, distribuant avec intelligence – en ce que cela rappelle à quel point ce drame a été partagé – les mêmes rôles à plusieurs interprètes. Sur un plateau nu, sobrement occupé par des chaises sombres et des instruments de musique (inanga, flûte, guitare) auxquels recourront les deux musiciens, Jean-Patient Akayezu et Samuel Kamanzi, l’ensemble des artistes fait corps. C’est, d’ailleurs, l’une des qualités du spectacle : le travail choral de toute l’équipe d’artistes amenant avec une belle fluidité le passage de séquences jouées à d’autres, chantées ou chorégraphiées.
L’on suit ainsi le récit du jeune Gaby – qui a dix ans au début du roman, sa sœur étant elle âgée de sept ans. Car le livre se déplie à partir des souvenirs de Gaël Faye et raconte donc par le menu ce génocide à travers les yeux d’un enfant. Ou comment, par ce que capte patiemment le garçonnet et par les événements touchant ses proches, l’on voit se mettre en place l’extermination génocidaire. Lorsque le roman, comme le spectacle, débute, Gaby – né d’un père français et d’une mère rwandaise –, qui vit avec sa famille au Burundi, traverse un drame familial : la séparation de ses parents. Gahugu Gato suit ainsi chronologiquement les différentes étapes ayant jalonné l’enfance, qu’elles relèvent de la « petite » ou de la « grande » histoire. Il y a, notamment, le départ de sa mère, le coup d’État au Burundi de juin 1993, le déploiement de la Mission des Nations Unies au Rwanda (MINUAR) à l’automne 1993, le mariage de l’oncle Pacifique et de Jeanne au Rwanda, la circoncision des jumeaux, deux voisins métis, les tensions qui s’installent entre Hutus et Tutsis, les rumeurs de la catastrophe à venir, jusqu’à la recherche des proches et le décompte des morts à la fin du printemps 1994.
En débutant par une chanson, le spectacle affirme dès son ouverture un tempérament : celui d’une création faisant le choix d’en référer aux codes du conte – au risque du cliché exotisant –, du récit ponctué de chants et de danses. Un parti pris qui, au-delà de son caractère convenu, déplie mine de rien un positionnement se voulant rassurant. Cette tonalité domine toute la représentation. Fondé sur un montage textuel se recentrant sur la famille et étant plus elliptique que le roman sur le génocide, sur l’interprétation très appuyée des personnages des enfants – mimant l’enfance plus que l’incarnant – et sur une création lumières teintée de couleurs douces, l’ensemble produit une sorte de mollesse. En regard de la gravité du sujet, et du caractère déjà très aimable produit par le roman (par le point de vue de l’enfant comme de la langue), ce volontarisme surprend. Si l’on saisit l’infinie délicatesse que travailler cette histoire implique pour des artistes du Rwanda, tant les traumatismes sont prégnants, l’ensemble souffre ainsi d’un effet de neutralisation. Le spectacle se révèle lisse et sage, mais aussi lisible dans son travail d’écriture – conçu comme une succession de tableaux alternant différents moments de jeu collectifs avec d’autres, plus individuels. Alors que ce génocide fut le plus rapide de l’histoire en termes d’ampleur – en cent jours, plus de 800 000 personnes furent exterminées –, alors qu’un autre génocide se déroule sous nos yeux à Gaza, l’atmosphère générale fort pasteurisée, en maintenant à distance formellement toute évocation plus frontale de la violence, laisse circonspect.
caroline châtelet – www.sceneweb.fr
Gahugu Gato (Petit Pays)
d’après le roman Petit Pays de Gaël Faye (Éditions Grasset)
Mise en scène Frédéric Fisbach, Dida Nibagwire, avec la complicité de Gaël Faye
Avec Frédéric Fisbach, Olivier Hakizimana, Léon Mandali, Carine Maniraguha, Philipe Mirasano, Natacha Muziramakenga, Dida Nibagwire, Norbert Regero, Michael Sengazi, Jean-Patient Akayezu (inanga, flûte et chant), Kaya Byinshii (chant), Samuel Kamanzi (guitare et chant)
Traduction Emmanuel Munyarukumbunzi, basée sur l’adaptation française de Samuel Gallet
Lumière Eloé Level
Costumes Asantii, House of Tayo, Moshions
Surtitrage Patience Umutoni
Régie générale Eloé Level
Régie son Foucault de MaletProduction L’Ensemble Atopique II (Cannes) ; L’Espace (Kigali)
Coproduction Mixt terrain d’arts en Loire-Atlantique, Solstice Pôle international de production et de diffusion (Pays de la Loire), Fédération Wallonie-Bruxelles, Västra Götalandsregionen (Suède)
Avec le soutien de Institut français, CITF Commission internationale du théâtre francophone
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre NationalDurée : 1h45
Festival d’Avignon, Cloître des Célestins
du 17 au 22 juillet 2025, à 22hMIXT – Terrain d’arts en Loire-Atlantique, Nantes
du 18 au 20 mai 2026
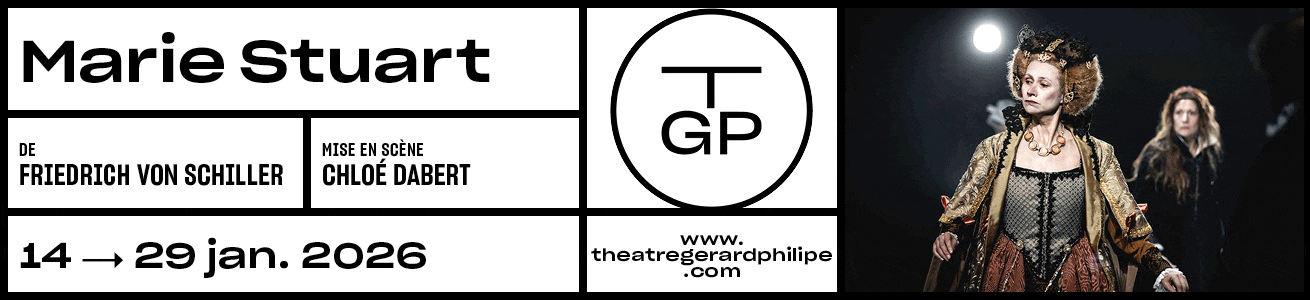

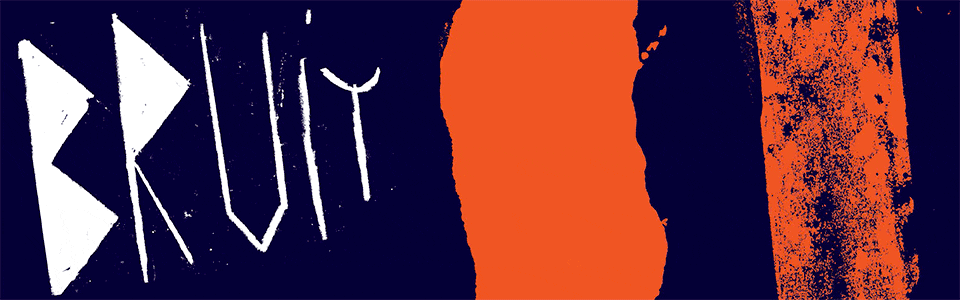


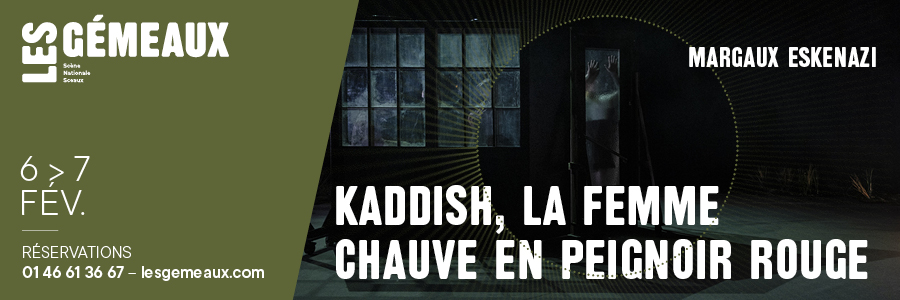






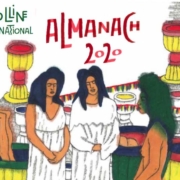

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !