Au Théâtre des Célestins, Claudia Stavisky peine à donner du relief et du mordant à la pièce trop convenue de David Hare.
Le projet Skylight tient son origine de l’autre côté du monde. A la demande des dirigeants du Shanghai Dramatic Arts Center, Claudia Stavisky avait monté une première fois, en juin 2019, cette pièce de David Hare avec la troupe de comédiens de cette institution. Les « réactions enthousiastes », à en croire la metteuse en scène, que le spectacle avait alors suscitées peuvent sans doute s’expliquer par les résonances de ce texte avec les préoccupations actuelles d’une partie de la population chinoise. Comme en témoignent les récentes décisions du dirigeant Xi Jinping – qui, depuis plusieurs semaines, ne cessent de pointer les riches du doigt au nom de la « prospérité commune » –, la lutte entre deux visions de société, celle de l’argent-roi, d’un côté, et du care, de l’autre, s’est accrue, en Chine, ces dernières années, jusqu’à devenir un thème central pour les responsables du PCC. Reste qu’en Occident, et tout particulièrement en France où la directrice des Célestins propose, en cette rentrée, une nouvelle version de cette pièce pour, dit-elle, « entendre Skylight en français ailleurs que dans [sa] tête », cette bataille entre l’ultra-capitalisme purement matérialiste et la quête de sens à visée sociale n’est pas des plus récentes, et s’est imposée comme un lieu commun artistiquement surtraité, ce qui n’est pas sans mettre à mal l’acuité de l’œuvre du dramaturge britannique, composée dans les années 1990.
Cette opposition frontale, David Hare l’incarne dans les personnages de Tom et Kyra. Il a y plusieurs années, ces deux-là se sont aimés et sont devenus des amants réguliers. Lui était déjà un self-made man en puissance, à la tête d’un restaurant cossu, tandis qu’elle, de vingt ans sa cadette, cherchait du travail pour financer ses études. Leur histoire longue de six ans a volé en éclats le jour où Alice, l’épouse de Tom, avec qui Kyra s’était liée d’amitié, a découvert le pot aux roses. La jeune femme s’est alors volatilisée, laissant derrière elle son amant déboussolé, son amie trahie et leur enfant, Edward, esseulé. Bien des années plus tard, à la suite du décès d’Alice, le fils et le père réapparaissent, à quelques heures d’intervalle, dans la vie de Kyra, chichement installée dans un quartier pauvre de Londres où elle donne des cours à des enfants défavorisés. L’un comme l’autre sont en souffrance, avouée par le premier, cachée derrière des rodomontades par le second, et les deux espèrent pouvoir comprendre la rupture passée et, qui sait, recoller les morceaux ; mais cet espoir méconnaît le gouffre idéologique qui sépare désormais Tom et Kyra, l’homme matérialiste à l’excès et la femme au service des plus démunis.
Problème, ces deux personnages apparaissent, quasiment d’entrée de jeu, archétypaux, voire caricaturaux. Lui figure le patron nouveau riche, forcément inconséquent avec le chauffeur de sa limousine, obnubilé par l’argent, et obsédé par l’appartement, à ses yeux miteux, dans lequel vit Kyra ; elle personnifie la professeure idéaliste et un rien Saint-Bernard, concentrée sur le sens à donner à sa vie qu’elle pense avoir trouvé en s’occupant de l’éducation des plus pauvres, y compris en dehors de ses heures de service. En somme, ce duo se situe tellement de part et d’autre de l’échiquier qu’il est difficile de croire, qu’un jour, ils aient pu se rencontrer et s’aimer. Surtout, ce qui aurait pu se transformer en duel radicalement politique, se borne à un surplace gentillet, où les deux anciens amants campent sur leur position et paraissent, toujours, ressasser les mêmes arguments aussi anecdotiques que convenus, comme si, finalement, dès les prémices de la pièce, tout était joué d’avance. Une impression renforcée par la construction dramaturgique même de l’œuvre. Plus proche du téléfilm que d’une pièce contemporaine, elle paraît, dans sa stricte linéarité, un rien datée, et loin, très loin, de ce que le théâtre britannique peut produire aujourd’hui, à l’image du travail frontalement engagé et brillant de pertinence d’Alexander Zeldin.
A ce substrat faiblard, Claudia Stavisky peine à donner un relief singulier et tout se passe comme si la metteuse en scène se contentait du rôle de passeuse de texte, sans lecture ni prise de risques particulières. Dans un décor ultra-réaliste, entre une plaque électrique, un matelas au sol, un vieux frigo, une baignoire, un four vétuste et un bureau qui sert de table à manger, elle fait tout reposer sur les épaules de ses trois comédiens, à qui revient la lourde charge de tenter de donner une épaisseur à ce qui en manque cruellement. Las, sans démériter totalement, les deux principaux, Marie Vialle et Patrick Catalifo, s’installent dans un échange monotone et ronronnant qui ne réussit pas à mettre en valeur les rares éléments substantiels du texte de David Hare. Au sortir, l’ensemble, qui aurait pu poser les bonnes questions avec un contenu plus dense et un soutien scénique plus affirmé, se résume à une tentative d’introspection lisse, rasoir et déjà vue.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Skylight
Texte David Hare
Mise en scène Claudia Stavisky
Texte français Dominique Hollier
Avec Patrick Catalifo, Sacha Ribeiro, Marie Vialle
Scénographie et costumes Barbara Kraft
Lumière Franck Thévenon
Son Jean-Louis Imbert
Assistanat à la mise en scène Alexandre ParadisProduction Célestins, Théâtre de Lyon
Avec le soutien de Grandlyon – la métropole, de la Fondation d’entreprise AG2R LA MONDIALE pour la vitalité artistique et du Grand café des NégociantsDavid Hare est représenté en Europe francophone par Marie Cécile Renauld, MCR Agence Littéraire en accord avec Casarotto Ramsay & Associates
Durée : 1h50
Les Célestins, Théâtre de Lyon
du 15 septembre au 3 octobre 2021Théâtre de l’Archipel, Scène nationale de Perpignan
les 26 et 27 mars 2022Théâtre du Rond-Point, Paris
du 11 au 29 mai


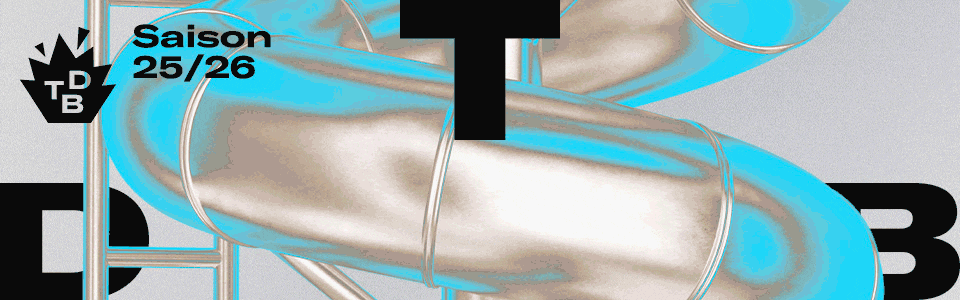


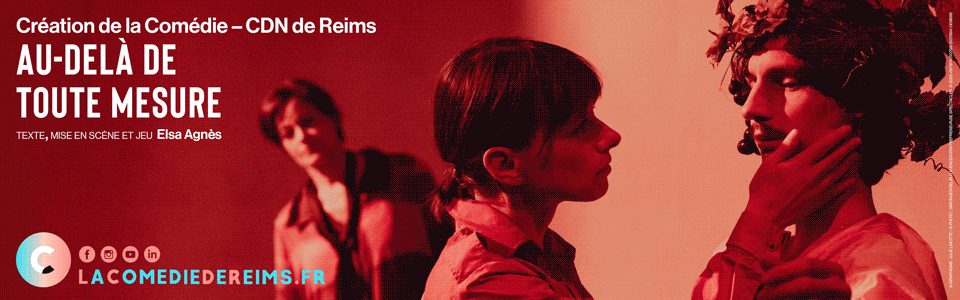








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !