
Photo Teatro La Plaza
Durant la 78e édition du Festival d’Avignon, la metteuse en scène péruvienne a présenté La gaviota. Une adaptation de La Mouette de Tchekhov portée par des comédiennes et des comédiens mal ou non-voyants encore peu représentés dans le monde du spectacle vivant.
Après Hamlet joué par des actrices et des acteurs porteurs du syndrome de Down (ou trisomie 21), la metteuse en scène péruvienne Chela De Ferrari a voulu faire se rencontrer deux univers, celui des voyants et celui des mal et non-voyants. À travers La gaviota, elle plonge les spectateurs dans la vision que les personnes atteintes de cécité portent sur le monde afin de réfléchir ensemble à la place du handicap dans le théâtre et dans la vie.
Comment avez-vous eu l’idée d’adapter La Mouette avec des comédiens mal ou non-voyants ?
Chela De Ferrari : Au départ, l’idée vient de la présentation que j’ai faite de Hamlet au Centre dramatique national espagnol. Ils m’ont alors invité à mettre en scène un autre projet, La gaviota. Quelques mois avant cette invitation, j’avais eu des contacts avec une troupe amateure de théâtre composée de comédiennes et comédiens mal ou non-voyants à Lima, au Pérou, qui s’appelle SinVERguenza [un jeu de mots entre « sin ver » qui veut dire « sans voir » et « sin vergüenza » qui signifie « sans honte », NDLR]. Ils m’avaient gentiment fait une critique de l’audiodescription qui avait été réalisée pour Hamlet. J’avais alors gardé en tête l’idée de travailler avec des gens qui pouvaient être aveugles ou mal-voyants. Une minute après y avoir pensé, j’ai pensé à Tchekhov ; puis trente secondes après, j’ai pensé à La Mouette.
Dans toutes ses œuvres, Tchekhov a des personnages qui cherchent un paradis perdu, qui sont totalement aveugles à la réalité qui est la leur. Cela m’a semblé intéressant que ces acteurs aveugles ou malvoyants proposent une autre « vision » de ces personnages. Ils ont su le faire avec humour, sincérité et aussi avec compassion. Comme les acteurs et les actrices qui souffrent de handicap s’interrogent sur leur place au sein du collectif théâtral, je trouvais cela très intéressant de les rapprocher du rapport que les personnages de Tchekhov entretiennent avec le théâtre. Konstantin, joué par Antonio Lancis, va par exemple jusqu’à se demander à quoi sert le théâtre.
Et selon vous, à quoi sert le théâtre ? À quoi sert votre théâtre ?
Je crois que le théâtre nous permet d’entrer en lien avec des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par notre travail. D’un point de vue social, Hamlet et La Mouette sont des textes qui ont une grande valeur. Ils sont intéressants à mettre en scène avec des personnes qui sont souvent laissées de côté. Le texte d’Hamlet avec ce grand monologue iconique, « Être ou ne pas être », récité par une personne porteuse du syndrome de Down, nous parle alors beaucoup plus, nous touche beaucoup plus. C’est un peu comme si on l’entendait pour la première fois. Avec La Mouette, c’est la question du regard, la question de se voir qui est très présente. Dans La gaviota, quand Belén Gonzalez del Amo joue le rôle de Nina, je trouve qu’elle a une manière de bouger son corps qui est différente. Je trouve qu’elle a une grande beauté expressive qu’une actrice voyante n’aurait jamais.
Pourquoi avoir choisi de mettre aussi des comédiennes et des comédiens voyants sur scène, tels que Boris ou Alicia, la régisseuse de la pièce ?
Initialement, j’avais pensé mettre en scène La gaviota uniquement avec des personnes mal ou non-voyantes. Mais, à un moment donné, je me suis dit qu’il était intéressant que Boris soit interprété par un acteur voyant car il est le seul personnage de la pièce qui voit vraiment la situation. Nina, elle, est incapable de voir grandir son émotion et ne sait pas non plus quand elle est regardée. Cette asymétrie, cette tension entre Nina et Boris me paraissait très intéressante et très forte. Comme je l’ai dit, j’ai travaillé avec une troupe de comédiens aveugles basée à Lima. J’y ai rencontré un couple, elle était aveugle et lui non. Cela crée une interdépendance entre les deux que j’ai voulu porter au théâtre.
Quant à Alicia, la régisseuse de la pièce, elle commence le spectacle en donnant aux acteurs une audiodescription du public. Quand les spectatrices et les spectateurs s’installent, la scénographie est très tchekhovienne, avec beaucoup de meubles anciens sur scène, mais ce décor va vite disparaître pour laisser place à un plateau nu. Elle le décrira plus tard pour mettre le spectateur dans la situation des personnes mal ou non-voyantes qui sont constamment obligées de faire appel à leurs souvenirs pour pouvoir « voir ». Il faut aussi noter que les acteurs mal ou non-voyants sont aussi demandeurs de ce mélange. Ils souhaitent travailler avec des comédiens voyants afin que ce travail soit inclusif.
Tout au long de la pièce, « Rendre l’invisible visible » apparaît comme votre leitmotiv, mais qu’essayez-vous exactement de dire aux spectateurs par le biais de cette phrase ?
Cette phrase, j’aimerais justement que le public l’interprète à sa propre manière. Dans la vie, il y a plein de choses qui ne se révèlent pas, qui restent dissimulées. C’est surtout le cas pour des personnes mal ou non-voyantes car elles ont du mal à nous faire saisir la réalité qu’ils et elles vivent au quotidien. J’ai aussi cherché à rendre visible ce que les personnes sans handicap ressentent face au handicap. Grâce à la rencontre des deux, il y a beaucoup de choses qui deviennent visibles alors qu’elles ne le sont pas en temps normal.
Sur quoi portera votre future création, tournera-t-elle aussi autour d’une forme de handicap ?
J’aimerais continuer à travailler avec des acteurs qui sont en situation de handicap, mais sans qu’il y ait une quelconque référence à leur handicap. Je les mêlerai avec des acteurs valides. Ce sera une adaptation de Beaucoup de bruit pour rien de William Shakespeare. J’insisterai sur la violence faite aux femmes et sur la violence que subissent encore aujourd’hui, dans beaucoup d’endroits du monde, les couples de même sexe. Je sais déjà que l’un des personnages principaux sera sourd. Dans la pièce, il s’exprimera en langue des signes et, s’il le peut, il pourra peut-être aussi dire quelques mots à voix haute. Les comédiens et comédiennes le comprendront. Dans le pire des cas, on pourra faire un surtitrage pour le public, mais je pense que cela ne sera pas forcément nécessaire. Le théâtre permet de toute façon d’imaginer bien des choses.
Propos recueillis par Candice Fleurance – www.sceneweb.fr




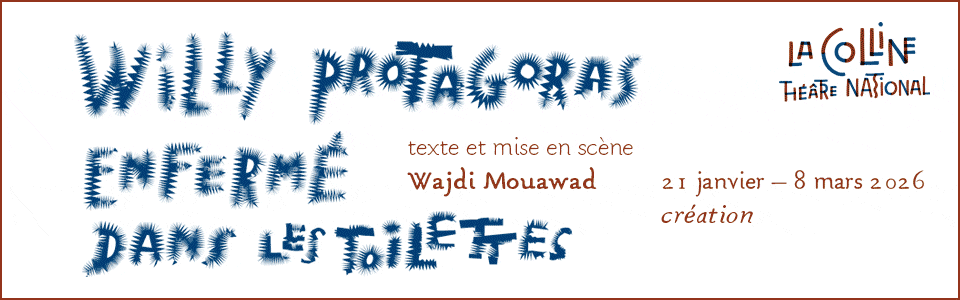



Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !