Agathe Charnet, Ambre Kahan, Noémie Rimbert, ce trio de femmes dans l’air du temps est aux commandes de ce spectacle épuré et musical, récit slamé ou concert théâtralisé enveloppé par la composition de M’Hamed Menjra à la guitare. Porté par ces élans réunis, Le Dieu des causes perdues est une histoire de perte et de libération qui se livre, palpitante, dans un geste intimiste et frontal.
Pour accéder à ce Dieu des causes perdues – au joli titre énigmatique -, il faut le mériter. Quatre étages à grimper à pied pour atteindre la minuscule et adorable salle Christian-Bérard de l’Athénée. Dans le dernier couloir qui y mène, la lumière tamisée et les murs aux teintes ocres et chaudes, invitent à un voyage dans le temps. Derrière nous, deux femmes chuchotent, « on se croirait à Rome » dit l’une d’elles. C’est vrai. Il y a quelque chose de l’Italie, de la beauté des fresques antiques, des temps anciens et des palais secrets, dans ce corridor patiné. La montée pour y arriver est un sas avec le dehors, avec le réel, avec le présent. Et pourtant. Les spectacles qui y sont présentés n’ont rien de daté, ils sont le reflet d’une jeune création ardente et prometteuse que la programmation fait le choix de mettre en lumière sur un plateau taillé à la mesure des premiers pas, des prises de risque, des propositions intimistes aussi. Beaucoup d’artistes femmes y sont passées par là, soulignons-le, que ce soit Marie Fortuit et Lucie Sansen avec La Vie en vrai, Raphaëlle Rousseau (Discussion avec DS), Mina Kavani (I’m deranged), le collectif Marthe (Rembobiner) ou Mélie Néel et son Méduses… Cette salle est tout autant l’opportunité des tentatives, des premières fois, que celle des pas de côté, des aventures de la marge, plus légères, des esquisses et des prémices. C’est d’ailleurs dans un partenariat fructueux avec Prémisses, office de production artistique et solidaire en faveur de la jeune création, que se construit cette saison d’émergence stimulante, propice aux découvertes et aux nouvelles têtes.
Le Dieu des causes perdues s’inscrit dans ce cycle et il en est éminemment représentatif. A l’écriture, Agathe Charnet à la tête de la compagnie La Vie Grande (avec Lillah Vial) qui s’est illustrée avec Ceci est mon corps et vient à peine de créer son deuxième spectacle, Nous étions la forêt. Sa plume est alerte, imagée et rythmée, musicale, généreuse en détails évocateurs, en impressions sensibles et punchlines obsédantes. En autrice branchée sur son cœur autant que sur ses valeurs, elle écrit depuis le point de vue de la sœur, à différents âges de sa vie, une histoire à cent à l’heure, frontale et radicale, trépidante, pétrie d’états d’âme. L’histoire d’une perte. D’une fraternité cabossée. D’un lien coupé. Que l’absence d’explications, de mots posés sur la situation, rend infernal, irrespirable, invivable. On ne dira jamais à quel point le silence vide la personne et creuse la souffrance. Agathe Charnet fait le choix clair et révélateur d’écrire depuis l’intérieur, depuis le regard, à différentes étapes de son cheminement, de celle qui observe et subit d’abord, dans une passivité imposée par l’enfance, puis s’arrache au foyer pour aller au-devant de celui qui a disparu sans laisser de traces ou si peu, et comprendre, enfin, la clé qui ouvre la porte à l’émancipation, à la réparation des traumas et souvenirs restés en travers de la gorge.
L’histoire débute in medias res, au beau milieu d’une nuit trouée par la sonnerie du téléphone fixe et le tambourinement à la porte de la police. Rythme haletant, suspense, on ne lâche pas d’une semelle la comédienne Noémie Rimbert qui nous plonge tête la première dans ce récit initiatique libérateur. On y entre par la porte de l’enfance mais les dates seront ensuite égrainées en allers-retours successifs, sans suivre la logique chronologique. La narration joue à saute-mouton entre le passé et le présent, l’enfance, l’adolescence, l’âge adulte, donnant à l’ensemble une dynamique palpitante. On ne sait pas grand-chose de notre héroïne, Anna, tant on est collé, comme elle, aux évènements et aux sensations qu’elle traverse. Peu importe. Ce qui compte justement, c’est d’entrer dans son cerveau d’enfant, aux premières loges des remous familiaux, des frasques de son grand frère, puis de suivre son parcours, au sein de ce lien rompu, de cette incompréhension première. Comment se construit-on quand son grand frère disparaît du jour au lendemain ? Comment colmater la brèche béante laissée par son absence ? Comment devient-on adulte quand une partie de soi est restée bloquée dans l’enfance ?
Avec une acuité qui tend à l’organique et une justesse délectable dans l’évocation de l’infime de ce qui nous traverse, des lames de fond et des mouvements de surface, Agathe Charnet écrit un monologue brûlant, scandé ou délié, habillé de musique. Nappes sonores, boucles et cordes de guitare, la composition, signée M’Hamed Menjra qui l’interprète en live, est électrique, connectée au pouls du texte, au souffle de la comédienne. De bout en bout, Noémie Rimbert, tantôt au micro tantôt voix à nue, suit la cadence du récit comme une vague. Avec un sens certain du dosage et de l’équilibre, à la fois fine et puissante, elle surfe sur la crète, émotions contenues ou déversées, elle fait corps avec la langue, se l’approprie dans sa musicalité intrinsèque pour mieux nous la livrer dans l’énergie fougueuse d’un concert. Et quand la colère se libère sous les peurs enfouies au prix d’une expérience chamanique à l’autre bout du monde et que l’héroïne foule aux pieds ses croyances passées, déboulonnant ce frère absent de son piédestal, on change d’éclairage et l’horizon se dégage. On pense souvent en l’écoutant à ce film de Philippe Lioret, Je vais bien ne t’en fais pas, lui-même adapté du roman éponyme d’Olivier Adam, sur un thème similaire traité différemment. Des réminiscences qui nous rappellent que si le motif de la disparition abreuve la littérature, c’est peut-être parce que nos vies sont tissées de deuils, au sens propre et figuré, tissées de silences qui hantent et de fantômes qui entravent. Apprendre à vivre avec le manque. Accepter nos ambivalences. Et oser l’espoir. Qu’avons-nous à perdre ?
Ambre Kahan, qui s’est illustrée récemment avec son ambitieuse adaptation scénique du roman fleuve de Goliarda Sapienza, L’Art de la joie, change ici de style et de format avec ce geste vif et resserré, ce spectacle-concert en duo créé pour un public adolescent dans le cadre du Festival Jeunes Créatrices initié par le Théâtre de Villefranche. Elle signe la mise en scène de cette petite forme épurée réduite à l’essentiel : le jeu, le texte et la musique, les trois pôles-piliers de cette création. Et cette frontalité percutante dans le rapport scène/salle lui confère sa force de frappe et de résonance immédiate.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
Le Dieu des causes perdues
Texte : Agathe Charnet
Mise en scène : Ambre Kahan
Jeu : Noémie Rimbert
Composition et interprétation musicale : M’Hamed Menjra
Assistanat : Tara Veyrunes
Création lumières : Zélie Champeau
Ce spectacle s’inscrit dans la saison Jeune Création de la Salle Christian-Bérard, en partenariat avec Prémisses.
Production déléguée : Compagnie Get Out
Coproduction : Théâtre de Villefranche-sur-Saône.Durée : 1h
Du 6 au 16 juin 2024
Théâtre de l’Athénée







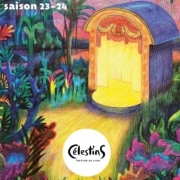






Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !