Dans le cadre d’une programmation qui fait la part belle à la langue anglaise, le public du Festival d’Avignon découvre l’écriture hypnotique d’Alistair McDowall. Un spectacle en trois parties, trois monologues comme des flux poétiques et intimes portés, sans ciller, par la comédienne Kate O’Flynn. Un travail d’une rigueur remarquable qui se met au service d’une langue captivante.
Quel serait le récit de nos vies si nous devions le dérouler d’une seule traite, le temps d’une longue logorrhée ininterrompue et sens dessus-dessous ? Avec all of it, ultime monologue des trois volets présentés d’affilée dans la boîte noire du Théâtre Benoît-XII, l’auteur britannique Alistair McDowall poursuit une exploration par l’écriture du récit de soi, abordé dans les deux premiers à une autre échelle et par d’autres prismes. all of it arrive en fin de parcours, il va au bout du geste, il tente d’englober une existence humaine, il fourre la vie dans les mots sans pour autant la ranger. Il la balance pêle-mêle, vertigineuse, éparpillée, répétitive, polyphonique, en flots, en saccades, en bégaiements, comme un flux mental qui aspire tout dans une voix intérieure insatiable que seule la mort fera taire. Tout prendre dans un enchevêtrement de phrases qui se démultiplient, se superposent, dégorgent jusqu’à satiété le trop plein de la vie qui afflue et conflue vers nos cerveaux jamais au repos. Difficile de décrire l’écriture à la fois nette et convulsive d’Alistair McDowall, mais ce qu’elle semble chercher en intégrant le tâtonnement comme une donnée inhérente à notre être au monde, c’est cette zone trouble et confuse entre ce que l’on vit et ce que l’on se raconte. Elle ne prend ni recul, ni hauteur, mais, au contraire, se plaque à notre conscience minimale, se niche dans l’en-deçà de la formulation claire, dans ce qui se joue entre soi et soi, en dehors de toute tentative de communication qui nécessairement l’appauvrit.
Vicky Featherstone et Sam Pritchard, tous deux associés au Royal Court Theatre de Londres, qui signent ici leur première collaboration artistique, ont imaginé un dispositif unique et évolutif, et bâti une mise en scène au cordeau au service de cette langue vivante qui échappe, envoûte et semble vivre sa vie en toute autonomie. Ils l’inscrivent dans une scénographie expressive et pénétrante, une boîte sans échappatoire, aux contours marqués, qui la contient dans son espace, comme pour mieux l’observer, tels des entomologistes du langage, en train d’advenir. Les symboliques possibles liées à l’enfermement se réveillent au fur et mesure qu’avance l’introspection diffractée. Le salon-boîte du début, tel une maison de poupée miniature, voit son mobilier disparaître dans le deuxième volet pour être remplacé par une autre boîte, le poste de télévision qui contient lui aussi le visage de l’actrice dédoublé, puis démultiplié. Le vertige identitaire à l’œuvre n’est pas sans rappeler le chef-d’œuvre de Bergman, Persona, mais la référence cinématographique s’arrête là. Car c’est aussi la cage de scène que matérialise en des dimensions resserrées ce cadre strict qui évolue vers l’épure totale et obscure. Le papier-peint du deuxième tableau dans lequel se fond cette femme-fantôme en un paysage qui l’englobe dans son chromatisme nuancé sera retiré pour laisser place à des panneaux noirs décontextualisés. L’idée pure de la boîte. Notre cercueil futur peut-être.
Du vert marécage qui tapisse le premier espace à la boîte évidée, dont il ne reste que la structure, Kate O’Flynn n’incarnera pas des personnages, mais trois possibilités d’une langue. Depuis cette lectrice qui s’échappe en lisant de son propre confinement quotidien dans Northleigh, 1940, le texte le plus concret et ancré de la trilogie, en passant par cette femme invisible qui s’extrait petit à petit de sa vie et devient mur, dans In Stereo, la langue glisse aux confins du sens, vrille elle aussi, se sépare en une cacophonie de mélodies, comme une partition à plusieurs lignes qui viendrait nous murmurer très fort notre incapacité à être un, unique et indivisible. C’est une femme dissociée, éparpillée, morcelée, psychotique peut-être, une femme insaisissable emmurée dans la folie et hors d’elle-même, littéralement fondue dans le décor qui s’exprime dans la partie centrale avant de laisser place à all of it, clou de la traversée, qui orchestre subrepticement la désagrégation du langage. Et les phrases, alors, de tourner en rond et en roue libre de plus en plus vite, et le rythme d’accélérer, décélérer pour reprendre de la vitesse, et le sens de se dérober et de faire éclater en même temps l’absurdité de tout ça. Une vie traversée, exposée comme on dissèquerait nos voix intérieures, volubiles, vaseuses ou vives, chaotiques et obsessionnelles.
Entre sobriété et inflexibilité, Kate O’Flynn suit sa ligne, implacable, elle avance dans ce flux prosodique comme un capitaine qui a le pied marin. Sa parole est droite, qu’elle soit assise, debout ou allongée sous son lit-cage ou sur sa chaise haute, son jeu est sans affect ni afféterie, parcouru sporadiquement de soubresauts de rire dans le dernier morceau. Et c’est comme si, en s’effaçant derrière la partition qu’elle suit pourtant sans démordre de son cap, Kate O’Flynn donnait libre accès à la langue pour la transpercer et, ce faisant, lui donner les moyens de nous parvenir.
Marie Plantin – www.sceneweb.fr
all of it
Texte Alistair McDowall
Mise en scène Vicky Featherstone, Sam Pritchard
Avec Kate O’Flynn
Conception Merle Hensel
Lumière Elliot Griggs
Musique et son Melanie Wilson
Vidéo Lewis den HertogProduction Royal Court Theatre (Londres)
Avec le soutien de Arts Council England et, pour la 77e édition du Festival d’Avignon, British CouncilDurée : 1h30
Festival d’Avignon 2023
Théâtre Benoît-XII
du 15 au 23 juillet, à 19h





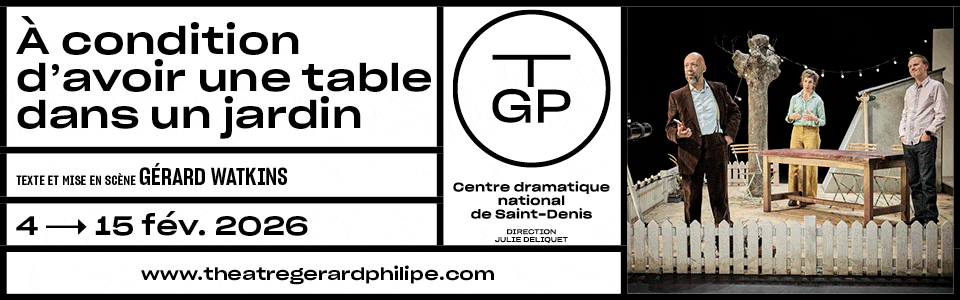

Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !