En isolant la nouvelle de l’auteur américain de son marathon Joueurs, Mao II, Les Noms, le metteur en scène lui redonne toute sa force de frappe, portée avec intensité par Joseph Drouet.
Il est de ces artistes capables de dénicher une pépite à l’intérieur de leur propre travail, et de transformer en spectacle à part entière ce qui ne devait rester, au départ, qu’un fragment d’un ensemble plus grand. Julien Gosselin fait, sans surprise, partie de ceux-là. A l’origine, Le Marteau et la Faucille n’était qu’un segment de Joueurs, Mao II, Les Noms, cette incroyable fresque théâtrale où le metteur en scène fonçait à tombeau ouvert dans l’univers de Don DeLillo. Avec la radicalité qu’on lui connaît, l’artiste avait alors décidé de ne laisser aucun répit aux spectateurs. Au long de ce marathon de dix heures, créé en 2018 au Festival d’Avignon, chacun pouvait aller et venir comme il le souhaitait, mais le torrent dramatique, lui, ne s’arrêtait jamais. Durant l’un des deux intermèdes de 45 minutes, le comédien Joseph Drouet prenait place, seul, devant une salle clairsemée – l’essentiel du public étant parti dîner –, pour s’emparer de cette nouvelle de l’auteur américain dont la force de frappe autant que l’étrangeté font l’effet d’une déflagration.
Aujourd’hui isolé, ce fragment gagne en force ce qu’il perd en contextualisation, et s’impose pour ce qu’il est réellement : une performance à l’intérieur de la performance. Puissant de son autonomie, solide en solitaire, il constitue l’un des derniers textes de Don DeLillo, inspiré par la crise financière de 2007-2008. D’emblée, un homme, Jerold Bradway, se souvient : « Nous traversions la passerelle au-dessus de l’autoroute, 39 hommes en survêtement et tennis, flanqués de surveillants par-devant, par-derrière, et sur les côtés, six en tout. » Après avoir devisé sur ces voitures qui, en contrebas, s’élancent à toute vitesse vers le nord ou vers le sud, il se retrouve happé par ce qui peut s’apparenter à un rêve, une réminiscence ou une prémonition. Bientôt, le voilà qui décrit l’intérieur d’un « camp » dont on comprend vite qu’il est réservé aux cols blancs, et plus précisément aux délinquants en col blanc. Comme Sylvan Telfair, « un banquier international qui avait pratiqué la manipulation des dangereux instruments de la finance offshore », et Feliks Zuber, condamné à 720 ans de réclusion pour avoir construit « un montage d’investissements qui avait impliqué quatre pays, causé la chute de deux gouvernements et la faillite de trois multinationales », Jerold Bradway fait partie de ces détenus mis à l’écart, en marge du reste d’un monde en pleine panique économique, politique, sociale et morale.
Cette panique, Julien Gosselin la matérialise scéniquement. Avec son habituelle maestria, il transforme le plateau en chaudron, et fait très rapidement monter le monologue en pression. Ce qui, a priori, pouvait passer pour une simple confession se meut en interrogatoire musclé ou en témoignage testamentaire. Tandis que la musique hypnotique de Guillaume Bachelé et Maxence Vandevelde ne cesse de s’amplifier, les néons rouges donnent à la scène des allures de chambre noire, capable de révéler la dureté du monde autant que les turpitudes des Hommes. Face à ce raz-de-marée qui n’en finit pas d’essayer de le submerger, Joseph Drouet, constamment épié par la caméra qui capture ses moindres faits et gestes, se montre toujours plus fébrile. Au long de son récit, ses gestes d’anxiété se font de plus en plus nombreux, son visage devient de moins en moins serein, tandis que sa parole est de moins en moins audible, progressivement recouverte par le vacarme d’un monde en ébullition.
La performance du comédien est d’autant plus remarquable qu’elle l’oblige, outre celle de Jerold Bradway, à endosser les voix de ses co-détenus, mais aussi celles de ces enfants aux commandes d’une émission de télévision qui a, semble-t-il, perdu la boussole. Tel un reflet de la cataplexie du corps social, y sont débités des mots vides de sens, et s’y croisent la chute des bourses mondiales, la capilotade économique de Dubaï et de la Grèce, mais aussi la révolte des citoyens qui, entre émeutes, grèves et manifestations, affichent de « nouvelles banderoles » et de « nouveaux drapeaux », avec le marteau et la faucille comme emblème, avant que le bulletin d’informations n’égrène une liste de noms : « Staline Khrouchtchev Castro Mao Lénine Brejnev Engels. » Terrifiante aux oreilles des détenus en col blanc, elle est, dans la bouche de Don DeLillo, le symptôme de l’écroulement d’une société où, alors que le grotesque fait la loi, plus rien n’a vraiment de sens. Entre extra-lucidité et folie intérieure, Jerold Bradway en vient alors à se dédoubler pour mieux se rassembler, à l’image de ce capitalisme qui, de crise en crise, n’en finit jamais de renaître. Quitte à sacrer, pour cela, de nouveaux rois d’un monde exsangue.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Le Marteau et la Faucille
Texte Don DeLillo
Traduction Marianne Véron
Adaptation et mise en scène Julien Gosselin
Avec Joseph Drouet
Scénographie Hubert Colas, assisté de Andréa Baglione
Assistant à la mise en scène Maxence Vandevelde
Création musicale Guillaume Bachelé et Maxence Vandevelde
Création lumières Nicolas Joubert
Création vidéo Pierre Martin
Création sonore Julien Feryn
Costumes Caroline TavernierProduction Si vous pouviez lécher mon coeur
Production déléguée Le Printemps des Comédiens
Coproduction Printemps des Comédiens Montpellier, Maison de la Culture de Bourges, CCAM Vandoeoeuvre-Les-Nancy, RomaeuropaDurée : 50 minutes
Théâtre Paris-Villette, dans le cadre du Festival Paris l’été
du 26 au 28 juillet 2022





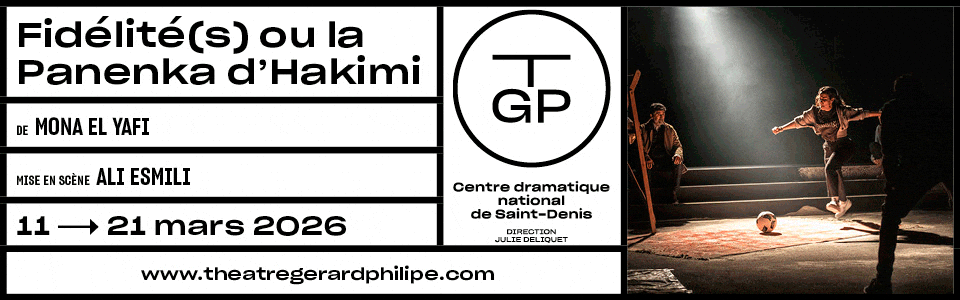








Joseph est exceptionnel comme tous les Drouet. bises. Martine Drouet
joseph est excellent comme tous les Drouet. bises. martine Drouet