Olivier Py est beaucoup plus détendu que l’année dernière à la même époque. Oubliées les tensions liées au conflit des intermittents, le directeur du Festival d’Avignon nous a ouvert le plateau de la cour d’honneur pour évoquer le Roi Lear de William Shakespeare qu’il met en scène avec Philippe Girard dans le rôle titre.
- J’imagine que ce début de festival est plus serein que celui de l’année dernier ?
Ce n’est jamais très serein et tranquille un début de festival mais c’est vrai que l’année dernière il était « intranquille » et douloureux. J’espère que l’on va retrouver la joie, la fête et le bonheur de penser, d’applaudir des artistes parce que c’est d’abord cela Avignon : une grande fête.
- Êtes-vous content en ce début de festival de parler surtout de théâtre ?
Je suis toujours content de parler de politique, de culture, de théâtre, d’art. Le festival d’Avignon c’est l’ouverture à toutes les paroles. Le festival ne m’intéresse que s’il a un dialogue avec la cité pour faire d’Avignon une cité exemplaire. Avignon est en état d’utopie pendant le festival. La ville est en danger politique même si les communautés vivent assez bien. C’est la ville la plus pauvre de la Région et avant tout c’est une ville de culture. Et là elle est exemplaire. Elle est même un projet pour la France.
- Mettre en scène le Roi Lear de Shakespeare est une envie très profonde chez vous ?
Je m’étais dis que dans mon premier mandant il fallait bien que je fasse une fois la cour d’honneur. Le Roi Lear s’est imposé car c’est la pièce de Shakespeare que je préfère, mais aussi dans tout le répertoire occidental. Elle est toujours contemporaine peut-être parce que l’on a traversé tant de chaos, tant de désastres, tant de violence au 20ème siècle en Europe. On revient toujours à Shakespeare, celui qui nous parle le mieux du désastre sans pour autant nous désespérer.
- Avez-vous peur de la Cour ?
Non je ne dirai pas cela. Je n’ai pas peur de ses dimensions, ni de son mythe et de sa force symbolique. C’est probablement le théâtre le plus mythique de tous les théâtres en France. Il faut jouer avec elle, avec le Mistral, avec le ciel, avec l’impossible. La Cour nous demande l’impossible. Alors quand l’on sait cela elle fait moins peur et devient moins exaltante.
- Est-ce qu’elle permet d’être plus inventif que dans un théâtre classique ?
Je l’espère. Vilar a vu dans le Cour qui n’est pas un théâtre, qui est un tréteau une possibilité d’en finir avec le théâtre bourgeois. C’est vrai que les canapés, les lustres, les rideaux, tout cela ne tient pas très longtemps, pas plus que le jeu psychologique. Il y a dans la Cour une invitation au grand lyrisme et au poème et d’ailleurs Vilar a ouvert avec la première française de Richard II.
- Pourquoi avoir retraduit le texte ?
Il y a des traductions très belles sur le plan littéraire mais qui ne me semblent pas très dramatiques. Nous sommes peu de traducteurs metteurs en scène, Arian Mnouchkine a aussi traduit Shakespeare, et nous avons envie de retrouver l’énergie du texte original. Le français ralentit le texte alors que c’est une course à l’abyme. C’est un gallot terrible. C’est une machine infernale, inéluctable. J’ai souhaité retrouver cette énergie tout en préservant la fulgurance poétique.
- Votre Lear, c’est Philippe Girard, c’était une évidence pour vous ?
Oui c’est un vieux rêve. Il fallait attendre d’avoir l’âge pour jouer le rôle. Il fallait aussi que j’assume ce rêve. On peut monter Shakespeare à tous les âges mais on le fait différemment. J’ai lu, j’ai fouillé autour de chaque vers pour essayer de comprendre l’esprit et le sens et puis je crois que j’ai été formé par Shakespeare et par la Cour avec l’idée que je rêvais d’un acteur fou et excessif. Philippe Girard et le Roi Lear du siècle, mais il y a aussi toute la troupe.
- La guerre est très présente dans la pièce. Est-ce qu’elle sera présente sur le plateau ?
Oui c’est une image de la guerre. On peut la représenter sur un tréteau différemment du journal télévisé. Shakespeare remonte aux origines de la souffrance qui figure dans le silence de Cordelia. Le silence ressemble à celui imposé à l’Europe après la découverte des camps de concentration.
- On a l’habitude de dire que Lear est fou mais ce n’est pas le seul dans la pièce ?
Ils sont tous fous. Lear est fou mais il est censé. Quand il parle au cœur de la folie, il dit les choses les plus importantes. Le fou est celui qui dit toujours la vérité chez Shakespeare.
- Propos recueillis par Stéphane CAPRON – www.sceneweb.fr


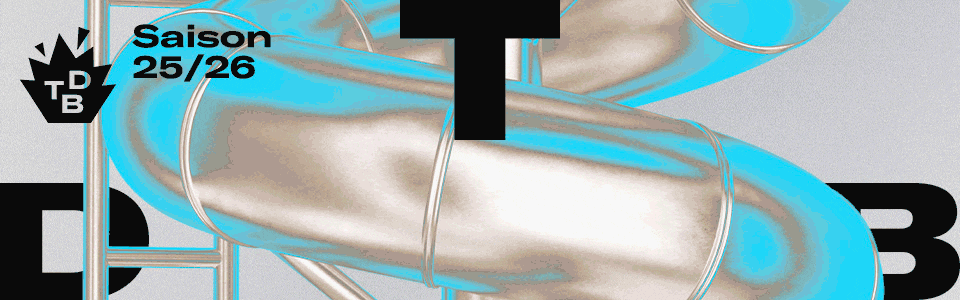


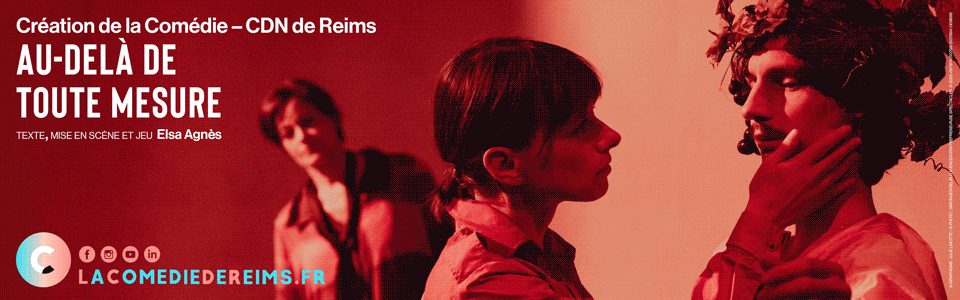








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !