Ils donnent vie depuis des décennies aux rêves des scénographes : à Sarcelles, les ateliers de fabrication des décors des pièces de la Comédie-Française ont été mis aux normes en s’engageant davantage pour l’environnement.
Au total, il se passe un an et demi entre la réception du projet et la première du spectacle, les décors étant transportés sur place, par camions, un mois avant le démarrage, tout comme les décors de répétition – des décors leurres qui simulent les volumes. Parmi les consignes : construire des décors légers. Montage et démontage doivent pouvoir se faire en une heure, afin de respecter le principe de l’alternance qui prévaut dans la salle Richelieu, poursuit Benoit Simon : des spectacles différents d’un soir à l’autre, qui alternent avec des répétitions l’après-midi. Ce jour de visite, un serrurier assemble des châssis en bois et en aluminium pour une pièce dont on ne peut encore révéler le nom, secret sur la saison oblige… Plus loin, l’énorme statue figurant une chienne, figure essentielle de la pièce Hécube, pas Hécube de Tiago Rodrigues (2024), vient d’être posée sur un nouveau plateau à roulettes, afin de pouvoir poursuivre sa tournée à Barcelone. L’un de ses concepteurs, Joseph Lapostolle, adjoint au service décoration, peinture, sculpture, est intarissable sur sa construction.
« Techniques anciennes »
Le sol de la salle de montage est horizontal, ce jour. Quand c’est nécessaire, un système de balançoire permet de reconstituer la pente à 4% du plancher de la salle Richelieu, qui « doit être prise en compte » à toutes les étapes de la construction. Sinon, « nos décors sont penchés et ne tiennent pas correctement », déroule Benoit Simon. Au fond, un peintre redonne un coup de pinceau sur une (fausse) façade blanche de maison, qui servira à nouveau pour une pièce de la saison prochaine, un recyclage qu’observe aussi d’autres théâtres ou maisons d’opéra ces dernières années. « Les décors d’un Malade imaginaire de 2001 tournent toujours depuis 24 ans », observe-t-il.
Affairées à reproduire les bords d’un faux miroir, les décoratrices Marion Dassonville et Elizabeth Leroy expliquent qu’elles laissent de côté la peinture acrylique pour revenir à « des techniques plus anciennes » et « plus naturelles », en fabriquant par exemple de la peinture à la caséine. Les lieux servent aussi de stockage d’anciens décors : dans le bâtiment avoisinant, Laurent Levasseur, machiniste, énumère le matériel de chaque pièce rangée dans de grandes caisses : « Là, c’est Cyrano de Bergerac, désigne-t-il du doigt. Là, Scapin; ici, Le Mariage forcé ; là, Tartuffe. »
Dans ces bâtiments métalliques qui datent des années 1980, une mise aux normes s’est révélée nécessaire, occasionnant des travaux de rénovation en 2024, pour un montant de 7,5 millions d’euros (hors taxes), dont 5,6 millions financés par le ministère de la Culture. « L’extérieur a été isolé avec des caissons en bois remplis de paille, dans un souci de développement durable et de performance de décarbonation », décrit Delphine Cedenot, qui a piloté l’organisation du chantier. À l’intérieur, pour respecter le volet sécurité et santé au travail, « le parc des machines-outils a été renouvelé et la totalité du réseau d’aspiration (des poussières) refait ». Prochain projet ? Un parc de 650 panneaux solaires photovoltaïques sur les toits, qui permettrait une autonomie du site en consommation électrique. Mais il faut encore trouver des financements.
Karine Perret © Agence France-Presse
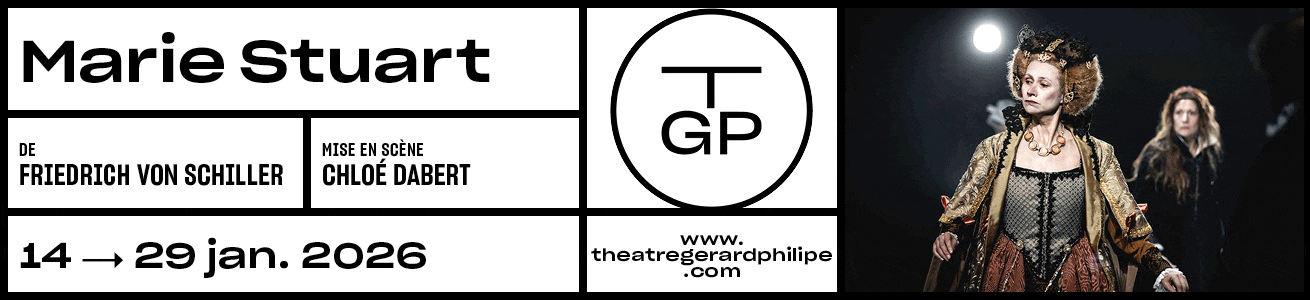

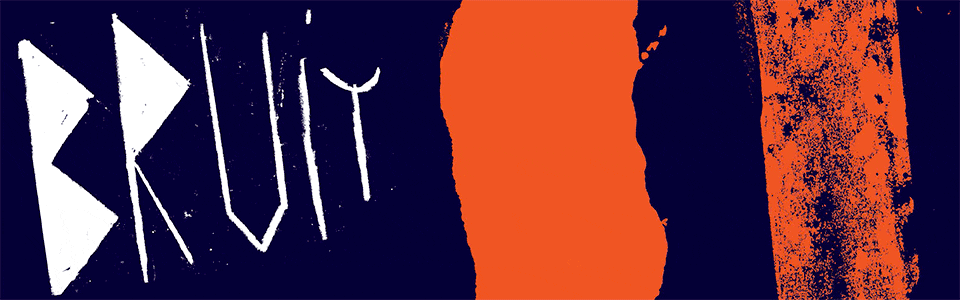


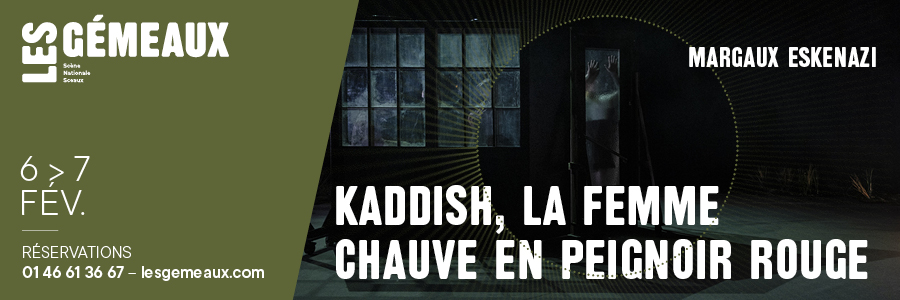







Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !