De L’Amant à Hiroshima mon amour, de La Douleur à La Maladie de la mort, en passant par Suzanna Andler, La Musica deuxième ou encore L’Amante anglaise, le metteur en scène orchestre, avec l’incroyable talent des élèves de la promotion 2025 du Conservatoire, une fascinante plongée dans douze textes de l’autrice, et prouve qu’il est au sommet de son art.
Faire mentir Marguerite Duras. Il fallait bien toute l’audace d’un Julien Gosselin pour s’y risquer et venir, par la bande, contredire l’autrice qui, dans La Vie matérielle, écrit, avec ce ton péremptoire à la fois crispant, savoureux et reconnaissable entre mille : « Le jeu enlève au texte, il ne lui apporte rien […] il enlève de la présence au texte, de la profondeur, des muscles, du sang ». La preuve du contraire, le metteur en scène la donne par douze, comme autant d’écrits durassiens où l’artiste plonge, s’insinue et s’immerge, pour mieux les pousser dans leurs retranchements, voire les dynamiter. Scindé en cinq parties d’environ deux heures chacune, qu’il est possible de voir séparément, mais que l’on ne peut que très fortement conseiller d’admirer en continu pour apprécier l’ampleur du geste, ce projet pharaonique – comme Julien Gosselin les affectionne tant –, par sa longueur autant que par le colossal travail d’adaptation et de mise en scène qu’il a supposé, profite d’un rythme habilement cadencé : entre chacune des onze performances – Le théâtre et L’Exposition de la peinture étant présentés dans un seul et même bloc –, d’une durée comprise entre trente minutes et une heure, un chrono de dix minutes se déclenche, donnant l’occasion aux spectatrices et spectateurs de prendre l’air, ou, à tout le moins, de reprendre leur souffle, bien souvent coupé par ce qu’ils ont pu voir, et qui relève, disons-le d’emblée, de l’oeuvre-monument, de celles, rares, qui restent en mémoire des années durant. Car, en ouvrant les portes de son Musée, entre 10h et 20h, Gosselin n’inaugure pas un poussiéreux mausolée à la gloire de Duras, mais orchestre une visite guidée bien vivante au contact des oeuvres de l’autrice, réactivées par une préhension radicale et innervées par le talent des élèves de la promotion 2025 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris – qui prouvent, une nouvelle fois, que les rencontres entre metteur·euses en scène de talent et aspirant·es comédien·nes donnent ces dernières années naissance à des spectacles qui font régulièrement partie des meilleurs de la saison. Tant et si bien qu’au sortir, ayant perdu la notion du temps, on repartirait bien pour un tour, pour quelques performances de plus – il reste d’ailleurs bon nombre de textes dans la copieuse bibliothèque durassienne, d’Un barrage contre le Pacifique au Ravissement de Lol V. Stein, en passant par Moderato cantabile, pour ne citer qu’eux –, tels des visiteurs qui, devenus accrocs, n’en auraient jamais assez vu.
Cette traversée, au préambule de laquelle, comme pour pénétrer dans un songe, il est demandé aux spectatrices et spectateurs de « fermer les yeux », Julien Gosselin l’ouvre et la clôt avec deux Hommes, L’Homme assis dans le couloir et L’Homme atlantique. Entre-temps, le metteur en scène se sera mesuré, dans l’ordre d’apparition, à Savannah Bay, L’Amant, Hiroshima mon amour, La Maladie de la mort, Suzanna Andler, Le théâtre, L’Exposition de la peinture, La Douleur, L’Amante anglaise et La Musica deuxième, soit un ensemble de textes de différentes natures – théâtrale, romanesque, cinématographique, critique – qui reflète l’étendue et la diversité de l’oeuvre de Marguerite Duras. Évidemment, l’artiste ne les livre pas in extenso, mais en propose tantôt une série de morceaux choisis, tantôt un extrait habilement sélectionné, tantôt encore une version retravaillée qui donne accès à la substantifique moelle de l’ouvrage d’origine, et prouve, une fois de plus, qu’il est l’un des meilleurs adaptateurs de sa génération. En même temps que le point de vue que Julien Gosselin porte, en tant que lecteur, sur l’oeuvre de Duras, se dessinent, se répètent et s’entrechoquent les obsessions, nombreuses, profondes et tumultueuses, de l’autrice, jusqu’à former un chaudron bouillonnant, tout à la fois sensuel, sulfureux et violent. Au coeur de ce bal de fantômes qui n’ont cessé de la hanter, et de se rappeler à elle, s’imposent alors, pêle-mêle, une collection de motifs thématiques et esthétiques : les villes et la mer, les fleuves et le sable, le temps et les souvenirs, les mensonges et l’infidélité, la vieillesse et l’alcool, le désir et la mort, mais aussi l’amour sous toutes ses coutures, surtout lorsqu’il est passionnel, en voie de disparition et/ou d’impossible retour, ou définitivement perdu. À chaque fois, le texte apparaît comme la plus précieuse des pierres angulaires, la clef de voûte d’un édifice qui, en le mettant au centre de tout, se plait à le sublimer, à le magnifier, mais aussi à le tordre – comme dans L’Amante anglaise où les interrogatoires de Claire et Pierre Lannes sont enchevêtrés et les indications de mise en scène à l’économie fournies par Duras passées par-dessus bord pour immerger l’action dans un commissariat, puis dans un tribunal –, à le malmener, voire à le mettre à l’épreuve – comme dans L’Homme atlantique où il se retrouve soumis au vocoder – pour voir s’il est en mesure de résister. Cette approche à l’os, en même temps que leur beauté et leurs fulgurances, révèle les contradictions de ces écrits, mais aussi leurs échos, parfois d’une justesse atemporelle, parfois beaucoup plus problématiques, avec notre temps présent.
À celles et ceux qui, notamment à l’occasion de ses deux derniers spectacles, Le Passé et Extinction, avaient pu (fallacieusement) lui reprocher de remplacer le théâtre par le cinéma, voire de faire disparaître ses actrices et ses acteurs, Julien Gosselin répond ici de la plus puissante et brillante des manières en orchestrant son Musée Duras, à l’image de performances dans une institution muséale, toujours à vue et sur un plateau le plus souvent quasiment nu. Tout en explosant les codes habituels de la représentation, en invitant le public, à intervalles réguliers, à quitter le gradin en bi-frontal pour investir le plateau – assis, debout et même allongé sur le sol –, il façonne, en même temps qu’une traversée de l’oeuvre de Duras, une exploration de différentes esthétiques théâtrales et prouve que, du seul en scène figé dans le clair-obscur de La Douleur au face-à-face sur écoute de La Maladie de la mort, en passant par les pas de deux tumultueux de Suzanna Andler et de La Musica deuxième, le naturalisme d’Hiroshima mon amour et les solos sous stéroïdes de L’Homme assis dans le couloir, L’Amant et L’Homme atlantique, il les maîtrise toutes avec la même maestria. Pour cela, le metteur en scène met à profit cette grammaire scénique qu’il manie avec une aisance déconcertante, portée par les lumières de Nicolas Joubert, l’utilisation toujours au plus juste de la vidéo – en collaboration avec Pierre Martin Oriol –, le rapport direct au texte – qui s’impose parfois en magnifique contexte de la parole qui s’exprime – et la musique électro-techno une nouvelle fois envoûtante de Maxence Vandevelde et Guillaume Bachelé, qui mixe en direct au plus près de la scène. Au diapason du texte, tout devient alors consubstantiel de tout, et, tout en créant des résonances avec des oeuvres de son propre musée théâtral – la table de dîner de Savannah Bay qui n’est pas sans rappeler celle de Joueurs, Mao II, Les Noms, la créature de L’Homme assis dans le couloir qui paraît cousine de celles de la fin de 2666… –, Julien Gosselin perfectionne certains de ses gestes parmi les plus récents – comme l’utilisation du vocoder qui, si elle était un peu hasardeuse dans Le Passé, se révèle bouleversante quand elle permet à la voix de Duras âgée de porter un regard sur la jeune femme qu’elle était – et ose même explorer de nouveaux champs, telles ces langues étrangères – jusqu’ici assez inusitées dans son travail – qu’il convoque avec une étonnante justesse, du japonais à l’anglais en passant par l’arabe – sublimement utilisé dans La Maladie de la mort –, pour faire reluire la dimension internationale de l’oeuvre de Marguerite Duras.
Habitué à travailler avec une troupe de fidèles comédiennes et comédiens, Julien Gosselin confirme également son statut de formidable directeur d’actrices et d’acteurs en dehors de ses sentiers battus. Offrant aux jeunes femmes de la promotion 2025 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris le devant de la scène et la plupart des rôles-clefs, l’artiste se montre capable, tout à la fois, de les pousser à se transcender, et à sans doute donner plus qu’elles-mêmes ne le pressentaient, et de se nourrir de leurs personnalités de jeu pour orienter sa propre appréhension des personnages, tant Juliette Cahon en Claire Lasnes prolétaire – malgré les réserves que l’on peut avoir sur un tel choix tant il frotte avec le texte d’origine – et Lucile Rose en Marguerite Duras devisante font preuve d’une facilité troublante. Toutes et tous remarquables d’engagement et d’intensité, y compris les jeunes hommes qui dépassent, et de loin, un simple rôle de faire-valoir, en particulier Yanis Doinel, subjuguant dans Hiroshima mon amour, et Louis Pencréac’h, émouvant de pudeur dans La Douleur, certaines franchissent des crans supplémentaires et en viennent à prendre aux tripes, à l’image de Alice Da Luz Gomes, irradiante de présence aux accents chorégraphiques dans L’Amante, Rita Benmannana, saisissante de rectitude tragique dans La Maladie de la mort et Jeanne Louis-Calixte, bouleversante en Suzanna Andler dont les moindres faits et mots sont pétris par ce mensonge qui a tout gangréné, et dont la folie grandissante la rapproche de la Ekatérina possédée du Passé. En solo, en duo, en trio ou en groupe plus large, épaulés par la présence discrète de Denis Eyriey, fidèle parmi les fidèles de Julien Gosselin, ces quatorze comédiennes et comédiens prouvent qu’ils n’ont, déjà, plus rien d’élèves, qu’ils sont en mesure, sans trembler, de souffler sur les braises durassiennes pour rallumer le feu qui couve sous la dureté de façade et ne s’était jamais réellement éteint. Dans le prolongement de Duras qui termine l’une de ses lettres, simplement datée « Juin 81 » et vraisemblablement adressée à Yann Andréa, en écrivant « La seule façon de se sortir d’une histoire personnelle, c’est de l’écrire », Julien Gosselin et sa troupe de jeunes comédiennes et comédiens prouvent alors qu’elle gagne aussi, et peut-être même plus, à être ainsi réactivée.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Musée Duras
d’après Marguerite Duras
Mise en scène et scénographie Julien Gosselin
Avec des élèves de la promotion 2025 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris : Mélodie Adda, Rita Benmannana, Juliette Cahon, Alice Da Luz Gomes, Yanis Doinel, Jules Finn, Violette Grimaud, Atefa Hesari, Jeanne Louis-Calixte, Yoann Thibaut Mathias, Clara Pacini, Louis Pencréac’h, Lucile Rose, Founémoussou Sissoko et la participation de Guillaume Bachelé, Denis Eyriey
Dramaturgie Eddy D’aranjo
Collaboration à la vidéo Pierre Martin Oriol
Musique Guillaume Bachelé, Maxence Vandevelde
Lumière Nicolas Joubert
Collaboration à la scénographie Lisetta Buccellato
Costumes Valérie Montagu
Assistante à la mise en scène Alice de la Bouillerie
Régie générale Loraine Mercier
Régie lumière Nicolas Joubert, Lou-Hanna Belet
Régie vidéo Raphaël Oriol, Baudouin Rencurel
Régie son Dominique Ehret, Julien Feryn
Machinerie/accessoires Nathalie Auvray
Habillement Nicolas DupuyProduction Odéon-Théâtre de l’Europe ; Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris ; Si vous pouviez lécher mon coeur
Avec le soutien artistique du Jeune théâtre nationalDurée : 10h (entractes compris), composé de cinq performances de 2h, à voir en continu ou séparément
Vu en juin 2025 au Domaine d’O, Théâtre Jean-Claude Carrière, Montpellier, dans le cadre du Printemps des Comédiens
Odéon-Théâtre de l’Europe, Ateliers Berthier, Paris
du 9 au 30 novembre
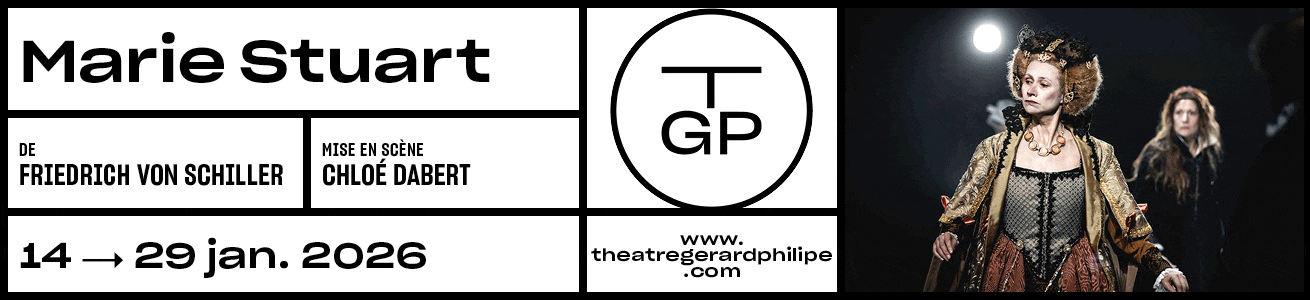

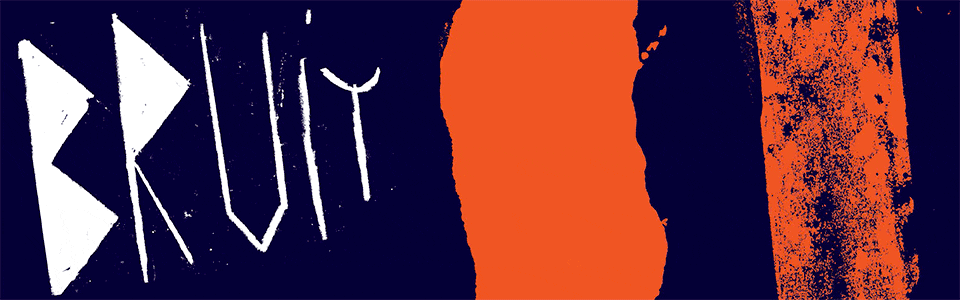


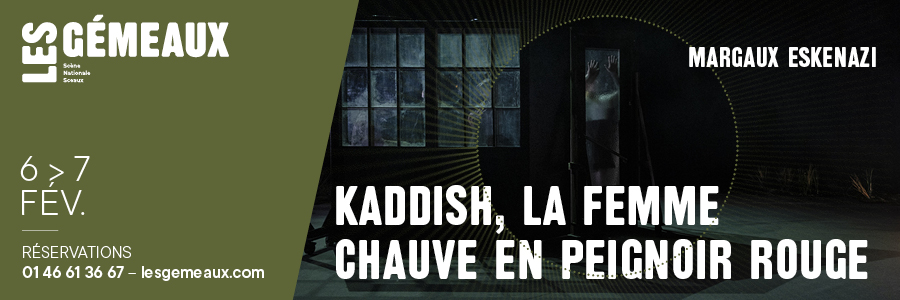



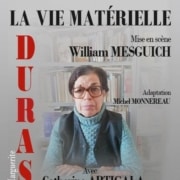
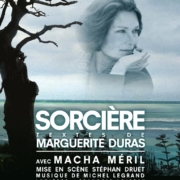



Monsieur,
Merci pour cet éclairage qui m’incite à revoir cette pièce exceptionnelle, dont j’ai cependant vite perçu la force et l’inventivité des mises en scène. Le travail de Julien Gosselin et de ses jeunes comédiens, des techniciens aussi, m’a fascinée et ce que vous en dites me permet d’apprécier ce travail et l’œuvre de Marguerite Duras encore plus profondément que je ne l’avais fait jusqu’à présent. Merci beaucoup.
Bien cordialement.
Claudie STOLTZ