Victoria Abril incarne une artiste dont l’éthique sera éreintée. Une pièce de boulevard classique – jusque dans son propos bien plus conservateur que progressiste – portée avec énergie par ses interprètes.
Quel est le rapport entre Marinella, la fameuse chanson de Tino Rossi – qui se retrouva être l’une des chansons politiques majeures du Front populaire – et… des sardines à l’huile ? Aucun. Tout comme il n’y a, a priori, aucun lien entre des sardines et… la peinture. Tous ces éléments sont pourtant reliés dans Marinella, et la pièce, mise en scène par Julien Alluguette, les articule autour de la question de la captation d’œuvres ou de références artistiques dans une visée mercantile. Si le texte écrit par Frank Buirod se saisit de cet enjeu, il ne produit pas pour autant une critique de ce système. Il se moque, plutôt, de celles et ceux qui prétendent s’en tenir éloignés. En cela, Marinella est bien stricto sensu un boulevard contemporain. Soit un spectacle qui ne fait pas de vagues, où la force satirique et où, parfois même, la dimension de critique politique – deux éléments qui prévalaient encore avant la Seconde Guerre mondiale dans le théâtre de boulevard – sont largement estompées. Demeure une assez ronronnante comédie qui vient plus prolonger que bousculer l’ordre établi. Mais reprenons. Marinella raconte l’histoire de Claudia, artiste-peintre oeuvrant tant et plus dans l’attente de la reconnaissance. Aimée, et même adorée, par son époux, un expert-comptable effacé, Claudia reçoit un jour la visite d’un client potentiel. Ce directeur d’une grande entreprise de sardines dénommée Marinella veut lui commander des peintures qui serviront de publicité à ses produits. Refusant d’abord ses avances et se drapant dans sa pureté éthique, Claudia, par l’entremise (très insistante) de sa sœur aînée et de son mari, va finalement accepter le marché.
L’histoire, qui se déroule dans l’atelier de Claudia – un atelier d’artiste baroque aux portes de guingois, aux couleurs chatoyantes et envahi de toiles figuratives comme abstraites –, repose sur des protagonistes qui sont plus des types que des personnages d’une grande profondeur : il y a le modèle posant pour Claudia, jeune homme musculeux sûr de son pouvoir de séduction et bête comme un balai ; il y a l’époux de Claudia, qui, en étant soumis à sa femme, serait de fait dénué de virilité ; il y a la grande sœur bourgeoise, « de droite » dixit elle-même, dont les décisions sont guidées par la vénalité et le consumérisme ; il y a le dirigeant de Marinella, un pragmatique laissant son bon sens le mener ; et, enfin, il y a Claudia, femme aussi fantasque que fantaisiste au tempérament impétueux et qui ne s’en laisse pas compter. Tout ce petit monde va défiler et se croiser dans l’atelier, jusqu’à se retrouver dans des manigances finales – tous unis, en dépit de leurs divergences initiales, par le même appât du gain.
Avec son écriture cherchant le bon mot et les punchlines, la pièce fait plus ou moins mouche. L’on voit bien dans l’écriture le souhait de l’auteur de jouer avec les références du vaudeville en les détournant. Il y a, ainsi, un homme nu, et également une personne (Claudia) dont il faudra à un moment cacher l’existence, mais cela sans suivre le schéma convenu du genre. De même, certains éléments parsemant la pièce sonnent comme une volonté de modernité : le féminisme farouche de Claudia, sa capacité à se consacrer à son art, tandis que son mari se sacrifie pour elle. Le revers de ce progressisme est pluriel. Outre que cette situation amène à présenter le mari comme obligatoirement faible (donc symboliquement émasculé), le choix de Claudia n’est présenté que sous l’angle d’une déconnexion de la réalité. L’artiste est donc dessinée comme une femme peu consciente des contingences matérielles. Ce faisant, le discours féministe de surface est étrillé au fur et à mesure qu’il se déplie. Pis, puisque, au final, c’est le personnage de Claudia qui se révèle la plus insatiable et cupide, proposant aux autres larrons une idée fondamentalement immorale et transgressive pour continuer à vendre ses toiles.
Partant, c’est, donc, la sincérité de la position radicale de l’artiste – type représentant ici une figure de gauche dédiée à son art et ses idées – qui est ici minée. Et toute sa défense initiale à refuser sa collaboration avec Marinella – vue comme un pacte avec le diable – résonne alors comme une posture creuse et hypocrite. En dépit de la gentille satire et des positions pour certaines progressistes, la pièce masque mal, on le voit, son discours un brin réac’. Reste l’équipe d’acteurs. Outre Victoria Abril, aussi sincère que directe, l’ensemble des interprètes portent la pièce avec franchise et engagement. Si le jeu est ici dénué de psychologie, c’est pour laisser la mécanique du rire fonctionner le plus directement possible. Et quoique certes naturellement pris dans leur stéréotype respectif, toutes et tous – le trio composé par Claudia, son mari et sa sœur en tête – maîtrisent leur partition.
caroline châtelet – www.sceneweb.fr
Marinella
de Franck Buirod
Mise en scène Julien Alluguette
Avec Victoria Abril, Didier Brice, Isabelle De Botton, Christophe Canard, Philippe Touzel, Loïs Vial
Assistante à la mise en scène Agathe Jolivet
Scénographie Citronelle Dufay
Lumières Moïse Hill
Costumes Lola Mercier
Musique Stéphane Corbin
Peintre Carlos TorresProduction Ki M’aime Me Suive ; Théâtre de la Madeleine
Durée : 1h40
Théâtre de la Madeleine, Paris
à partir du 13 février 2025
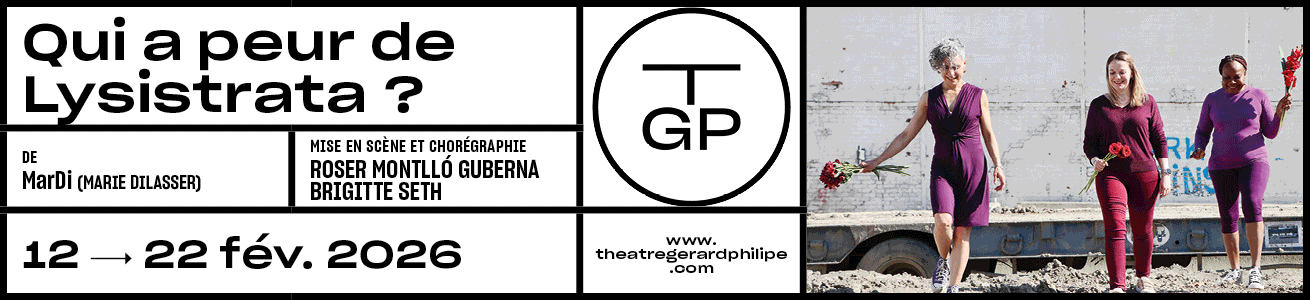











 Fabienne Rappeneau
Fabienne Rappeneau
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !