
Photo Anthony Devaux
Avec Je n’ai pas le don de parler, la jeune metteuse en scène grimpe sur les épaules du poète suisse Robert Walser et fracture le conte des frères Grimm autant que l’art du théâtre.
Avec leur allure un peu gauche, deux êtres s’avancent, sans autre forme de procès, pour rejoindre, dans un silence de cathédrale, le coeur du proscenium. Engoncés dans des costumes faits de bric et de broc qui, pour l’heure, ne disent rien de leur identité, cette femme et cet homme, tous deux mutiques, scrutent le public avec un regard malicieux et un léger sourire en coin, comme s’ils ne le découvraient pas tout à fait pour la première fois. Sont-ils déjà des personnages ou encore des comédiens ? Nul ne le sait vraiment. Et c’est dans cet interstice trouble, dans cet espace où les ambiguïtés font recette, qu’Agathe Paysant trouve la source de son théâtre expérimental. Alors qu’en fond de scène un jeune homme dort, couché sur le flanc, l’un des deux individus s’empare du programme de salle de Je n’ai pas le don de parler et se met à lire, dans un geste aussi hésitant qu’intimement guidé, Le paysage de Robert Walser. « C’était l’épouvante. Pas un morceau de ciel et la terre était mouillée. J’allais, et tandis que j’allais, je me posais la question de savoir si je ne ferais pas mieux de rebrousser chemin et de rentrer chez moi. (…) Il me sembla qu’il était désormais impossible d’espérer encore quoi que ce fût. Puis, à l’inverse, il me semble qu’un doux bonheur, exquis, indicible bonheur, s’insinuait dans le paysage endeuillé (…) ». Ces mots, l’homme ne les saisit pas, ne les empoigne pas, mais les accueille, en toute humilité, se laisse traverser par eux et transcender par leur pouvoir, jusqu’à faire de l’espoir de guérison, inexpliqué autant qu’inexplicable, d’un monde apparemment condamné son imperturbable force motrice, celle qui, justement, irrigue le Blanche-Neige du même Robert Walser auquel il ne tarde pas, avec la femme qui l’accompagne, à prendre part.
Sorte de suite offerte par l’écrivain et poète suisse à l’œuvre des frères Grimm, ce Blanche-Neige là se plaît à décomposer et à recomposer le conte d’origine pour mieux le fracturer. Pour ce faire, Walser ne reprend pas exactement là où les frères Grimm s’étaient arrêtés. La Reine n’a, visiblement, pas eu le droit à son ultime châtiment – cette danse à mort avec des chaussures en fer chauffées à blanc aux pieds –, et se retrouve en compagnie de Blanche-Neige, du Prince et même du Chasseur, élevé au rang de personnage principal. Revenue saine et sauve, quoique traumatisée, de la maisonnette des sept nains, extirpée de son cercueil de verre, la jeune Blanche-Neige est prête à demander des explications à la Reine, devenue sa « mère », sur la tentative d’homicide dont elle a été victime. Sans égard particulier pour le Prince, ce « petit garçon », dit-elle, qui « n’a pas de poil au menton », et qui, dans une versatilité extrême, se laisse séduire par les feux de la monarque plutôt que par la froideur de la jeune femme, elle met au jour la relation adultère entre le Chasseur, qui a finalement renoncé à la tuer, et la Reine, commanditaire de cette tentative d’assassinat. Au lieu de se venger, Blanche-Neige cherche alors une issue de secours, une voie de sortie plus féconde que celle, stérile, dans laquelle l’enfermait le conte, et qui va progressivement conduire tout ce beau monde vers le chemin, aussi sinueux que joyeux, de la réconciliation.
À travers ce « dramolet », tel qu’il le décrivait lui-même, Robert Walser fait du conte d’origine l’objet du discours et de la parole la clef pour sortir de l’impasse définitive à laquelle ce genre littéraire condamne traditionnellement ses personnages. À cet égard, l’auteur opère deux transmutations : celle du conte en drame et celle de la prose en vers. Car c’est bien par l’entremise singulière de la poésie, et sa capacité transcendantale, qu’il opère une fracturation de l’oeuvre des frères Grimm. Par touches successives, on l’observe, avec facétie et un brin de religiosité, remettre à l’heure les pendules du Bien et du Mal, renverser la charge du « pêché » et emprunter la voie d’une réconciliation aussi soudaine qu’improbable. En réinterrogeant les actes qu’ils ont perpétrés, en sondant le halo moralisateur qu’ils ont produit – ce « mensonge empoisonné / qui s’emplit de ses propres dires », écrit Walser –, tout se passe comme si les personnages se débarrassaient de leurs oripeaux, se libéraient du carcan du conte, et de ses codes, et trouvaient les moyens de s’émanciper du crime originel pour permettre l’avénement d’une guérison collective, fondée sur une humanité retrouvée, y compris dans ses facettes les plus sombres.
Humaine, trop humaine, cette tentative d’infiltration du conte en vue de son implosion sert de fil rouge à Agathe Paysant pour mener une étonnante recherche théâtrale, où les fragilités assumées se mêlent à une profonde et prometteuse acuité. Dans les pas de Robert Walser qui ne cesse de reconfigurer l’oeuvre d’origine – à commencer par le leitmotiv du baiser salvateur qui revient tel une antienne alors qu’il n’a jamais eu lieu chez les frères Grimm, mais reste bien présent dans l’imaginaire populaire –, Agathe Paysant ose jouer avec l’art théâtral pour mieux en interroger les capacités, et bousculer les attendus. Consciente que les personnages de Walser sont bel et bien des figures, la jeune metteuse en scène s’adonne à une forme de pantomime, qui sied parfaitement à leur esprit et à leur fonction littéraire. Aux commandes d’une direction d’acteurs aux accents clownesques dans sa manière de grossir les traits de personnages, elle déstabilise son monde, s’enferme sans doute un peu trop dans le système qu’elle instaure, mais parvient, malgré tout, à faire reluire la beauté de l’esprit walserien, et sa formidable capacité à réenvisager le monde, aussi fictif soit-il, pour en expurger le mal. Loin de faire ronfler la poésie de Walser, elle se plaît, à la manière de l’auteur suisse, à faire preuve d’une économie de moyens à toute épreuve. En peu de signes, comme l’auteur le fait en peu de mots, elle instaure une ambiance à part, où la scène tendue de noir est le lieu de tous les possibles, et de l’audace sans coups d’éclat.
Vincent Bouquet – www.sceneweb.fr
Je n’ai pas le don de parler
d’Agathe Paysant
d’après les textes de Robert Walser
Traduction Hans Hartje, Claude Mouchard, Nicole Taube
Avec Marc Bertin, Camille Duquesne, Alban Gérôme, Nathalie Pivain, Marc-Antoine Vaugeois
Scénographie Simon Restino
Lumières Philippe Ulysse
Regard costumes Elise Garraud
Création sonore Camille Lacroix
Regard dramaturgie Juliette de Beauchamp
Regard chorégraphique Vincent Dupuy
Couture décor Valentine CalotProduction Compagnie de la Décision
Coproduction Studio-Théâtre de Vitry-sur-Seine, La Commune – CDN d’Aubervilliers
Soutiens Théâtre de l’Echangeur de Bagnolet, Collectif 12 de Mantes-la-Jolie, Théâtre Antoine Vitez d’Ivry-sur-Seine, CDN des Quartiers d’Ivry, Nouveau-Gare au Théâtre à Vitry-sur-Seine
Projet soutenu par le ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et financé par la Région Île-de-France
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre NationalDurée : 1h40
La Commune – CDN d’Aubervilliers
du 6 au 9 décembre 2023Théâtre L’Échangeur, Bagnolet
du 18 au 23 mars 2024




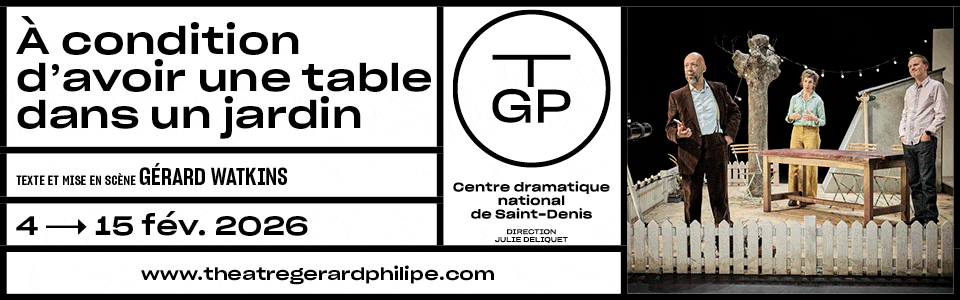








Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !